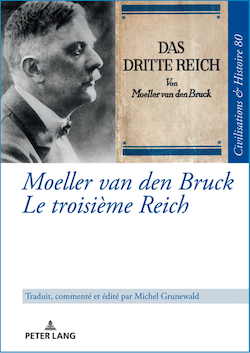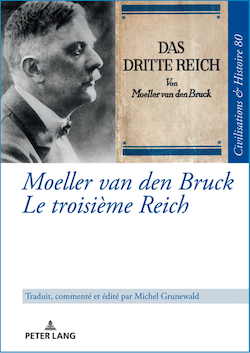D’Arthur Moeller van den Bruck nous avions la traduction de son Troisième Reich parue en 1933 – dix ans après l’édition allemande et huit ans après la mort de l’auteur –, avec une préface de Thierry Maulnier. Mais cette édition se basait sur une version tronquée datant de 1930 qui en modifiait la perspective – surjouant notamment le rapport à ce national-socialisme qui reprend la formule de Troisième Reich –, et la traduction amputait encore le texte. C’est donc à une redécouverte que nous convie Michel Grunewald, universitaire spécialiste de la « révolution-conservatrice » allemande : nouvelle traduction par ses soins, longue introduction, appareil de notes expliquant des références historiques oubliées. On regrettera une seule chose, mais il s’agit sans doute d’une question de droits : que l’on n’ait pas mis en annexe les préfaces de Maulnier et de Hans Schwarz, toutes deux présentes dans l’édition Sorlot.
Le lecteur sera peut-être surpris du plan de l’ouvrage, divisé en grandes thématiques – révolution, socialisme, libéralisme, démocratie, prolétariat, réaction, conservatisme –, et plus encore quand l’auteur les croise au fil de sa démonstration. On pourra aussi trouver longs certains développements, le style parfois un peu lourd – à côté de formules éblouissantes –, mais ce Troisième Reich est un texte majeur de l’histoire des idées politiques. Parce qu’il fait partie du corpus de la « révolution-conservatrice » allemande et permet de comprendre les mentalités et les débats de l’époque sans rester obnubilé par la montée en puissance du national-socialisme. Mais, surtout, parce que ses analyses nous renvoient à notre actualité par leur intemporalité. Suivons-en quelques-unes.
L’état d’esprit national
« On peut perdre une guerre. En revanche, une révolution, il faut la gagner » lance d’entrée Moeller pour qui toute révolution est une « affaire nationale, qui place le peuple concerné face à lui-même, et dont l’issue conditionne l’orientation qu’il saura en toute liberté, imprimer à sa destinée ». Il évoque alors la double révolution qui se produit en Allemagne après l’effondrement du Reich – l’arrivée de la République parlementaire et la tentative de soulèvement marxiste –, deux révolutions dont le personnel politique le déçoit. Mais il se pose surtout la question de l’après-révolution, et, parce que, selon lui, toute révolution « modifie la façon de penser d’un peuple jusqu’à la fin des temps », considère que seul le réactionnaire, qu’il critique, croit pouvoir tirer un trait sur elles et revenir à l’état précédent de la société : question fondamentale à laquelle en France, Napoléon d’abord, Louis XVIII ensuite, apporteront leurs réponses. Au-delà, la révolution qu’évoque l’auteur c’est aussi la révolution future qu’il souhaite pour sortir le pays de son marasme, une révolution qui cette fois constituerait « un processus spirituel » bien différent de la simple révolte. Mais pour qu’elle advienne, pour que l’on puisse agir politiquement de manière efficace, nos nouveaux révolutionnaires devront selon lui avoir derrière eux « une nation politisée », et on sait que, de Maurras à Gramsci, on retrouve cette même question : comment modifier l’état d’esprit d’une population pour qu’elle accepte comme légitime cette action révolutionnaire, « coup de force » royaliste ou coup d’État marxiste ?
Quant à savoir si le socialisme peut être la base de cette révolution, Moeller analyse les théories socialistes utopiques ou marxistes et formule, entre autres, deux reproches. Le premier est que Marx ferait fond sur les faiblesses humaines plutôt que sur ce qui porte l’homme au-delà de lui-même. Le second est que, dans la pratique, derrière le verbe, ressurgissent les constantes nationales, et que c’est bien l’esprit national des peuples qui façonne des socialismes différents et non leur stade économique. Pour Moeller, en effet, l’économie n’est pas une « infrastructure », et ce sont au contraire « les concepts de pouvoir, de droit, d’État [qui] sont l’infrastructure qui constitue le socle de l’économie ». Il reproche enfin au marxisme de s’appuyer sur une idée d’avenir mythifié d’où découle cette fuite en avant que nous connaissons dans toute dérive progressiste. Pour autant, et puisque « chaque peuple à son propre modèle de socialisme », Moeller défend face au marxisme un socialisme allemand reposant sur une conception organiciste et corporatiste, révolutionnaire en ce qu’il s’oppose au libéralisme, mais conservateur en ce qu’il retrouve des formes anciennes d’organisation sociale.
Le parti des parvenus
Car le libéralisme, qui « conduit les peuples à la ruine », est l’ennemi principal. En imposant à l’Allemagne vaincue sa conception de la politique qui repose sur l’individualisme, il permet la victoire d’un « parti des parvenus » qui « correspond à une couche intermédiaire de la nation, qui a compris comment elle pouvait s’intercaler entre le peuple et l’élite ». Pour rester au pouvoir, ce même libéralisme utilise « les partisans des droits de l’homme [pour] maintenir aux yeux du monde l’illusion que la justice est toujours à l’ordre du jour », « et on peut dire, ajoute Moeller, que comme crétins au service du libéralisme […] ils remplissent ce rôle à merveille, consciemment ou non ». Face donc à ce libéral individualiste et jouisseur qui ne vit que dans l’instant, et qui, « pour masquer qu’il est obnubilé par le présent […] a inventé l’idée de progrès », ce n’est pas tant le socialiste marxiste qui se dresse, mais le conservateur, celui qui se refuse à croire « que nous suffirait le bref laps de temps, l’instant, le moment fugitif que dure notre existence afin d’atteindre le but de celle-ci ».
Notre auteur définissant la démocratie comme « la participation d’un peuple à son destin » en même temps qu’à « la vie de l’État », on comprend que l’existence de cette dernière ne soit pas une question de régime politique mais, comme en matière économique, repose sur l’existence de liens organiques, souvent d’homme à homme. Ce qui nous emmène loin d’une pseudo-démocratie dans laquelle des élites oublieuses de la notion de devoir ont fait sécession. Notons aussi que cette « participation » ne passe pas nécessairement par une participation politique directe, et que le référendum n’est jamais pour notre auteur qu’une solution partielle, complétant au mieux l’organicisme qu’il promeut. Enfin, même organiques – ou parce qu’organiques –, les masses auraient conscience de leurs limites et aspireraient non pas à une auto-organisation mais à pouvoir adhérer au programme d’un chef spontanément reconnu comme tel et mis en œuvre par des élites légitimes.
Assumer la fonction monarchique
Dans son analyse de la crise politique, Moeller insiste sur la notion de déclassement. « Nous sommes en train de devenir une nation prolétaire – écrit-il. Et à présent, ce sont nos compatriotes diplômés qui connaissent une détérioration de leurs conditions de vie spécifique. » C’est le refus – ou non – de ce déclassement qui pèsera sur les choix à venir, quand « certains non seulement ne veulent personnellement pas devenir des prolétaires, mais ne supportent pas non plus l’idée de faire partie d’une nation désormais prolétarisée ».
Comment s’en sortir ? Individuellement, par le refus du nivellement imposé. « Est prolétaire quiconque a la volonté d’être prolétaire. Ce n’est pas la machine, ni la mécanisation, ni le salariat découlant du mode de production capitaliste qui transforme l’individu en prolétaire, mais sa conscience de prolétaire. » L’individu doit alors se donner ce « bagage culturel [qui] confère une plus grande mobilité intellectuelle, une vision plus large et plus distancée des choses ». Et cette approche devrait selon lui mener naturellement toute une part de la jeunesse, frappée par ce déclassement, à retrouver le sens de la nation : « C’est au nom du lien qui les unit au destin de l’Allemagne que ces Allemands de la jeune génération qui ne souhaitent pas être des prolétaires sont des nationalistes ».
Reste à savoir de quelle nation dressée face aux internationalismes marxiste et libéral on parle. Pas celle du réactionnaire, qui croit pouvoir rétablir des structures anciennes, mais celle du conservateur, qui veut, lui, conserver des valeurs en les projetant politiquement dans une forme différente. Dubitatif sur une éventuelle restauration, car « il n’y a pas de monarque sans qu’existe dans le pays une conscience monarchique qui fait que le terrain soit favorable au symbole que représente la monarchie », Moeller penche pour l’arrivée au pouvoir d’un « chef investi par le peuple pour assumer la fonction monarchique et en assurer la continuité pour le bien de notre nation » – et c’est plus de Gaulle qu’Hitler qui vient à l’esprit du lecteur un siècle plus tard. « On désigne cette aspiration schématiquement en parlant de poussée vers la droite – écrit Moeller. Mais en réalité cette aspiration est commune à tous ceux qui se rendent compte que la vie n’est pas possible dans la désorganisation », qu’ils soient donc « de droite » ou « de gauche ».
Moeller conclut en écrivant d’ailleurs que cette volonté d’ordre social « aujourd’hui, on ne la qualifie pas de conservatrice. On la qualifie de nationaliste » dans un dépassement des clivages. Mais nationalisme et conservatisme lui semblent indissolublement liés : « Vivre en ayant conscience d’appartenir à sa nation, c’est vivre en ayant conscience des valeurs qu’elle représente. […] Une nation est une communauté créatrice de valeurs. Et le nationalisme est l’expression de la conscience de créer des valeurs. » Nous espérons l’avoir montré, nombre d’analyses de Moeller van den Bruck sont au cœur des débats de nos sociétés. Il faut relire Le Troisième Reich.
Arthur Moeller van den Bruck, Le Troisième Reich, traduction et édition de Michel Grunewald. Peter Lang, 2024, 476 p., 79,40 €