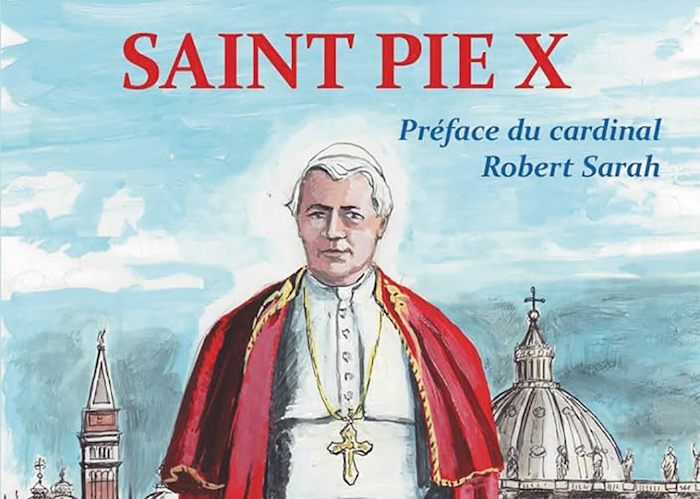La victoire acquise en 1918 est surtout le fruit d’une alliance militaire stratégique et opérationnelle C’est cette unité politique et morale qui a permis de démultiplier les forces alliées. Une homogénéité des buts et des moyens qui peut servir de modèle.
Novembre 2018.
La victoire alliée de 1918 fut la conséquence de nombreux facteurs : la supériorité numérique et matérielle des Alliés, le courage et les sacrifices des combattants, une meilleure utilisation des moyens de combat modernes apparus justement pendant la guerre. Mais un facteur essentiel fut la mise au point, au printemps 1918, pratiquement à la fin du conflit, d’une alliance efficace.
Rappelons quelques faits : en 1914, il existait une alliance en bonne et due forme entre la France et la Russie, mais rien de semblable avec la Grande-Bretagne, en dehors de simples accords d’état-major qui n’étaient nullement des engagements formels. L’accord conclu le 5 septembre 1914 entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg était un engagement à ne pas conclure de paix séparée et à s’entendre le moment venu sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne. Mais ce n’était pas une véritable alliance, pas plus que le Traité de Londres signé en avril 1915 pour encourager l’Italie à rejoindre ce que l’on appelait, en fait à tort, les Alliés (traité secret, par ailleurs, comme la plupart des traités de l’époque, et contradictoire aux accords passés avec les Serbes et les Roumains en 1915 et 1916). Quant aux États-Unis, ils entrent bien en guerre en avril 1917, mais ils se proclament « Associés » et non pas « Alliés », et il n’existe là aucun texte. Quant Wilson proclame ses Quatorze Points en janvier 1918 pour tracer les grandes lignes de la paix future, il n’engage que lui, et d’ailleurs il s’adresse beaucoup plus aux opinions publiques de ses co-belligérants qu’à leurs gouvernements.
D’autre part, il n’existe pas de réelle coordination politique permanente entre les Alliés, sauf des conférences qui sont largement des parlotes, en tout cas pas avant l’automne 1917. En novembre 1917, on crée bien un Conseil de guerre suprême allié permanent, mais il n’est pas vraiment efficace. Et il n’y a pas non plus de réelle coordination militaire et stratégique : des conférences d’état-major assez académiques se tiennent à partir de la fin 1915, mais il n’y a pas de réelle coordination entre le front occidental et le front russe. À l’Ouest, Belges, Britanniques et Français occupent des secteurs du front qui résultent largement, encore en 1918, des positions occupées initialement en 1914. L’intervention franco-britannique à Gallipoli puis à Salonique en 1915 se fait dans le plus grand désordre politique et militaire. Certes, l’offensive franco-britannique sur la Somme à partir de juillet 1916 est relativement coordonnée. Mais seules pendant longtemps les marines françaises et britanniques collaborent réellement, tout au moins pour protéger les routes maritimes.
Les efficaces suggestions de Foch
Les choses vont changer en 1918 : d’abord l’unité morale entre les Alliés est enfin établie à la suite des traités très durs de Brest-Litovsk (mars) et Bucarest (mai), que les Puissances centrales imposent à la Russie et à la Roumanie. Il est désormais entendu que toute paix négociée est hors de question, et que les monarchies impérialistes allemande et austro-hongroise devront disparaître. Bien des arrière-pensées plus modérées chez les Américains et les Britanniques (et même chez certains responsables français) disparaissent alors : on ira au « knock-out », comme disait le Premier ministre britannique Lloyd George.
Ensuite l’offensive allemande « Michel », à partir du 21 mars, à la jonction des lignes britanniques et françaises, ouvre un vide béant de 80 kilomètres dans les défenses alliées. Le manque de coordination stratégique est patent : les Anglais reculent vers les ports, les Français, durement repoussés, n’arrivent pas à refermer la brèche, et le commandant en chef français, Pétain, pense d’abord au danger d’une seconde attaque allemande en Champagne (il s’agit en fait d’une habile désinformation allemande). Le général Foch, alors président du comité militaire du Conseil suprême, parvient à convaincre Clemenceau et Lloyd George qu’il faut à tout prix refermer cette brèche. Pour cela il faut une autorité coiffant les commandements nationaux. À Doullens, le 26 mars, l’unité de commandement est enfin réalisée. Comme le déclara un jour un général américain commandant les forces de l’OTAN en Europe (SACEUR) au CEMA français : le Maréchal Foch fut « le premier SACEUR » ! C’est-à-dire le premier commandant en chef de l’Alliance atlantique (c’est d’ailleurs ainsi que dès 1918, dans des notes internes, certains responsables français désignaient l’alliance entre Paris, Londres et Washington).
Les raisons profondes du succès de Foch furent qu’il était acceptable pour tous : il avait établi des liens étroits avec l’état-major britannique dès avant 1914, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider les Italiens après le désastre de Caporetto, il avait facilité les choses à l’Armée américaine lors de son arrivée en France. Et avant tout il avait su établir des relations de confiance avec Clemenceau et Lloyd George, qui, à la différence de ce qui s’était passé souvent les années précédentes, suivirent de près les affaires stratégiques mais n’intervinrent pas de façon tatillonne dans la conduite des opérations.
Mais Foch avait su construire son rôle au-delà des textes : d’après ceux-ci, il n’était chargé que de « coordonner » les armées alliées (le titre de commandant en chef ne lui fut même pas attribué tout de suite) et les commandants alliés conservaient le droit d’en appeler de ses décisions à leurs gouvernements respectifs. Il trouva cependant la bonne formule. Il ne donnait pas des ordres, mais faisait des suggestions. Selon lui, des suggestions bien fondées étaient plus efficaces, dans cette situation, que des ordres qui pourraient être contestés. Il rendait visite aux chefs alliés, leur parlait, et si la discussion faisait apparaître un désaccord, il n’insistait pas mais leur laissait une note argumentée, qui produisait ensuite son effet. D’après lui, son rôle était plus important que celui qu’avait prévu l’accord de Doullens.
Une alliance doit être résolument politique
En même temps il ne perdit jamais de vue les nécessités politiques de l’Alliance : son objectif était certes de parvenir à une victoire complète, avec le contrôle militaire du Rhin, par une série d’offensives, mais en tenant compte des préoccupations de chacun des Alliés, même au prix du principe de la concentration des forces et d’une stratégie sous-optimale. Il fallait en effet assurer de cette façon le plein engagement des Alliés, ainsi que le maintien de l’alliance après la guerre pour garantir à long terme la sécurité de la France. Pour Foch, l’alliance impliquait que la grande stratégie était prioritaire par rapport aux problèmes opérationnels à plus court terme.
Ajoutons qu’en 1918 la coopération interalliée se renforça dans tous les domaines : en particulier dans le domaine économique, par la création des « Exécutifs » interalliés pour les matières premières et le fret, qui assurèrent un ravitaillement efficace géré par des experts dépassant les égoïsmes nationaux. De même le blocus de l’Allemagne devint enfin efficace, les Alliés s’entendant et collaborant pour en combler toutes les nombreuses brèches encore subsistantes, en particulier par les pays neutres.
La coopération s’étendit également aux armements (les forces américaines en France furent fournies en canons, tanks et avions pour l’essentiel par l’industrie française) et à leurs concepts d’emploi. En 1918 en effet les Britanniques et les Français testèrent l’usage en grand des tanks et de l’aviation dans son rôle d’appui tactique, ainsi que le transport motorisé de l’infanterie. On prévoyait pour 1919 une guerre mécanisée annonciatrice de 1940. Un comité interallié des tanks coordonna le développement de la nouvelle arme blindée, tandis qu’un « Centre interallié de l’Artillerie d’assaut » établissait ses concepts d’emploi, et parvenait à un degré d’ « interopérabilité » entre Alliés que l’OTAN ne connaît pas toujours aujourd’hui.
Tout cela comporte des leçons toujours actuelles : une alliance doit être efficace sur tous les plans, y compris politique et économique et pas seulement militaire. Elle doit être résolument politique et faire toute sa place à la grande stratégie, qui ne doit pas être subordonnée à des considérations opérationnelles immédiates. Elle doit concilier, et c’est le plus difficile, les nécessités de lignes de commandement claires, ainsi que de la plus grande harmonisation tactique et technique possible, avec le respect indispensable des intérêts et objectifs des pays qui la composent.