Editoriaux

Organisations Négligemment Gavées
À Gaza, le Hamas détourne l’argent des subventions, d’où qu’elles viennent, pour construire un réseau souterrain et de petites manufactures d’armes.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
La grande leçon d’Étienne de La Boétie.
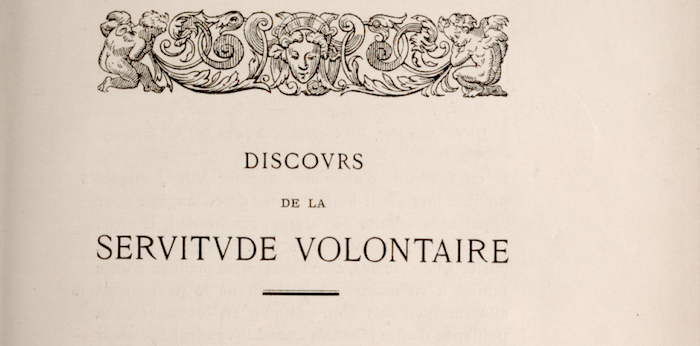
Toute réflexion sur la tyrannie est d’essence dialectique. Elle suppose une relation, qui n’est certes pas toujours conflictuelle, mais jamais en repos, entre l’asservi et le despote. Sur le plan hégélien, cette relation implique un dépassement de la tyrannie par l’avènement d’un meilleur gouvernement. Sur le plan aristotélicien, la tension entre les deux termes doit se résoudre par leur accommodement, lequel, bien loin de leur conciliation, suppose leur compréhension, soit, littéralement, l’action de saisir ensemble ces deux oppositions. C’est ce à quoi nous invite le jeune Etienne de La Boétie (1530-1563) qui, selon les mots de son cher Montaigne, « vécut en Caton et mourut en Socrate ». Cet humaniste, pétri d’Antiquités grecques et romaines, a laissé à la postérité le texte le plus lumineux sur la liberté ainsi que sur son négatif obligé, la tyrannie. Connu pour cet aphorisme qui en résume la lettre et l’esprit, « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres », le Discours de la servitude volontaire (1576) inaugure à lui seul les grands textes qui jalonneront la tradition antitotalitaire, jusqu’à Georges Orwell et Hannah Arendt. En ces temps funestes de laissez-passer sanitaires, féroces tigres de papier, promesses factices de libertés à l’expression désormais inoxydablement suspendue, non plus seulement à la non-nuisance à autrui – la « non-nocense » de Renaud Camus – mais étranglée dans un étouffant faisceau policier et bureaucratique de sûretés hygiénistes dont, par ailleurs, la pandémie covidienne n’a cessé de démontrer, au fil des jours et des mesures – dont l’autoritarisme et l’arbitraire se sont avérés inversement proportionnels à leurs finalités prophylactiques –, l’inutilité, l’inanité sinon l’insanité, en ces temps maussades et obscurcis, donc, la lecture de ce Discours, apparaît comme le premier acte de résistance à un pouvoir politique aveuglément gagné par l’hubris de sa toute-puissance.
Le Périgourdin, à la manière du Stagyrite affirmant la socialité politique de cet animal qu’est l’homme, constate, comme marque d’une prédisposition générale, cet enchâssement naturel de la liberté en tout animal, attendu que « tous les êtres qui ont la faculté de sentir sentent systématiquement le mal de la sujétion, et courent après la liberté ». Mais alors, par quel singulier paradoxe les peuples en viennent-ils à considérer les tyrans, « non seulement avec obéissance et servitude, mais encore avec dévotion » ? De ce docile assentiment aux chaînes, qu’il conçoit comme un « si profond oubli de liberté », La Boétie ne se lasse pas de faire un sujet d’étonnement philosophique. Et de dérouler l’écheveau de cette curieuse propension à l’assujettissement. À l’accoutumance dès la naissance au harnachement, s’ajoute la crédulité en les mérites du despote à laquelle ce dernier annexe bien volontiers, pour gage de sa pérennité sur le trône, quelques jeux, hochets et distractions, corrupteurs de l’âme et corrodeurs abrutissant des volitions. L’aboulie se conjugue à la veulerie et à l’effémination des mœurs. Tout un peuple, d’abord par sections et bataillons puis ensuite par régiments entiers, communie à la gloire du tyran. Ce sont ces milliers de serviteurs serviles, parfois obséquieux, souvent zélés, qui constituent « le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie » ; « tous ceux-là s’amassent autour de lui pour avoir leur part du butin et être, sous le grand tyran, tyranneaux eux-mêmes ». Une fois encore, pour notre auteur, la cause paraît entendue : c’est de n’avoir pas connu la liberté dès ses premiers vagissements, que l’homme ne se cabre plus devant son absence.
Toutefois, le monde moderne est sans commune comparaison avec la société du temps de La Boétie. La tyrannie a changé son point d’appui. Ce n’est plus l’inhabitude à la liberté qui la fonde mais, bien au contraire, sa satiété, son trop-plein, sa saturation. Certes, ignorant de la liberté, les hommes peuvent d’autant plus consentir aisément au despotisme qu’ils ne connaissent rien qui les dissuaderait de s’immoler dans le feu ardent d’un régime qui en serait, par définition, la négation même. Mais, omniscients sinon omnipotents d’icelle, demeurent-ils tout autant insensibles à ses étrécissements progressifs, à ses privations par étapes successives. Ayant exhérédé la mémoire des époques où les libertés – d’autant plus rares, d’une manière générale, qu’elles apparaissaient comme la contrepartie de devoirs que les individus devaient à la communauté – se monnayaient parfois au prix de la vie, nos modernes en sacrifient d’autant plus volontiers des pans entiers qu’ils en méconnaissent la valeur. En d’autres temps, Hipparque, tyran d’Athènes, fut assassiné, les derniers Tarquins répudiés et Denys de Syracuse destitué. Au XVIe siècle, d’aucuns dénommés « monarchomaques » (de monos : seul, archè : pouvoir, makè : dispute), tels, par exemple, Théodore de Bèze ou François Hotman, dans le sillon du De Regno de Thomas d’Aquin, en appelaient au renversement du tyran au nom de la supériorité naturelle des gouvernés sur le gouvernant auquel il revient de servir sans asservir. Il reste, nonobstant, que le tyran doit mériter de déchoir et le peuple le pouvoir de faire choir : « Plus l’oppresseur est vil, plus l’esclave est infâme » disait Jean-François de La Harpe, cité par Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe.