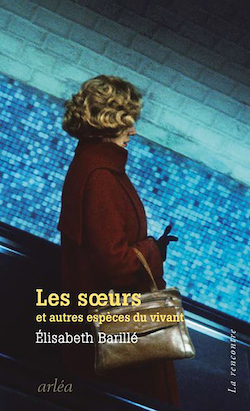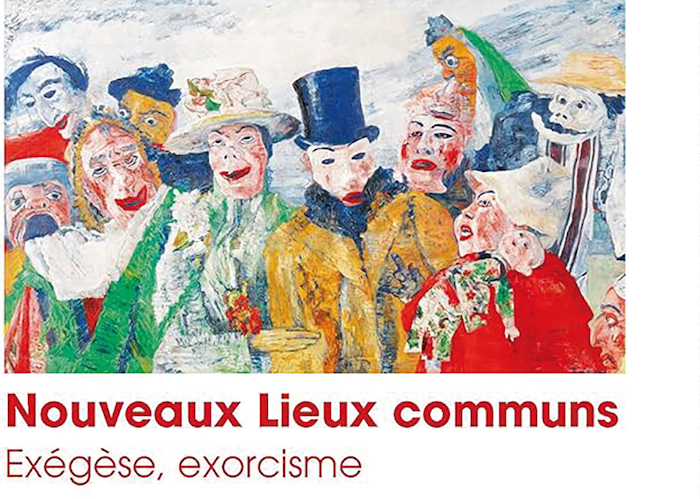Deux livres récents affrontent ce mystère avec une anxiété douloureuse ; car s’il nous faut aimer les hommes, les aimer comme on doit s’aimer soi-même, la conscience de cette monstruosité suspend toute espérance d’y parvenir, à quoi s’ajoute l’effrayante étrangeté de tous ces autres, si lointains. La souffrance devant soi domine dans le tome V du Journal de Richard Millet (éd. Les Provinciales), celle qui nous éloigne du plus proche déchire Elisabeth Barillé, qui s’en plaint dans Les sœurs et autres espèces du vivant (éd. Arléa).
Elisabeth Barillé n’en peut plus de ne pas comprendre sa sœur Lucie, donc de ne pas pouvoir simplement l’aimer, et en être aimée. Alors, pour se soulager, elle raconte, tentant de circonscrire ce puits noir qui les sépare tout en les attirant l’une vers l’autre. « Lucie me désarme, elle m’effraie. Nous n’avons que vingt mois d’écart, nous avons été élevées ensemble, dans les mêmes lieux, nous avons partagé les mêmes vêtements, les mêmes jeux, la même chambre. Aujourd’hui, tout nous sépare. » Comme la lâcheté les a séparées quand l’oncle Igor maltraitait la petite Lucie sans que sa sœur osât lui manifester son amour en s’interposant. Cette défaillance pourrait être la source originelle, se dit-elle, parce qu’on voudrait qu’il y eût des origines à tout, surtout à l’incompréhensible, afin que ce qui nous échappe dans les êtres qu’on aime ne soit pas sans explications. Et puisque, d’autre part, on ne veut pas croire à la perte définitive, on espère avec obstination, parce qu’on préfère espérer dans l’horreur plutôt que de s’éloigner sans recours de ceux qui nous tiennent malgré tout enchaînés, ne serait-ce que par les questions sans réponses qu’ils nous obligent à nous poser. L’amour, vécu dans cet impossible arrachement, n’est qu’une torture sans fin.
Lucie est en voyage, elle est partie, à l’aventure ; il n’importe : elle est toujours ailleurs. L’auteur attend que sa sœur lui revienne, qu’elle se manifeste de manière moins énigmatique. Elle tente d’interpréter les photos reçues de loin en loin, elle voudrait comprendre de l’intérieur ce qui fait agir sa sœur, alors qu’elle sait que c’est impossible, parce qu’elle est une autre, qu’elle a vécu des histoires qui l’ont éloignée, toujours plus. « Nous vivons d’histoires, elles vivent en nous, qu’elles soient réelles ou inventées, transmises ou vécues, n’altère pas leur empire sur nous. » L’auteur raconte ses histoires dans des livres que Lucie ne lit sans doute pas, ou bien elle essaie de se raconter les histoires vécues par sa sœur, sans jamais y parvenir sûrement. Alors, pour oublier la quête impossible, elle se lance dans une enquête sur une femme remarquable du XVIIIe siècle, Madeleine-Françoise Basseporte, dessinatrice au Jardin du Roy. Elle se donne ainsi l’occasion de rencontres stupéfiantes autant qu’éclairantes, comme avec cet animal encagé de l’actuel Jardin des plantes : « Confondue par la grâce d’un kangourou captif, ne m’étais-je pas transformée sous ses grands yeux pensifs en bête moi-même ? » Tous en cage, en somme. Alors, oui, « tout n’est que métamorphose, consolation, réparation, pour qui n’en peut plus d’espérer et d’attendre. » On veut raconter la vie d’une autre, mais « la vie étrangère nous échappe », comme « apparaît un soir une bête à la lisière d’une forêt, s’évanouit » … – « cette bête, […] c’était Lucie. » Une bête libre, elle…
Un être aussi proche qu’une sœur peut devenir aussi lointain qu’un animal sauvage. Une bête qui pourtant nous touche, nous émeut. Lucie est perdue, le souvenir de sa voix s’estompe. « Un jour viendra l’effacement. Quel trait surnagera alors, la résumant toute entière, dans tous ses âges ? Quel détail, quel os à ronger ? Ses yeux, évidemment, ses yeux d’or et d’orages, ses merveilleux yeux de louve. » Cette dernière phrase clôt le tombeau écrit à celle qui n’est pas encore morte, elle sert de fermoir précieux à ce très beau livre, vibrant d’émotions et de mystères vainement remués.
Richard Millet, lui, nous dit au fil de son journal qu’il ne se comprend pas, qu’il est écrivain et ne sait pas vraiment ce que c’est qu’être écrivain, que c’est peut-être une illusion, à moins que ce ne soit une manière de ne pas vouloir regarder en face sa maladie. Il ne sait pas plus ce qu’il est en tant qu’homme de désir, en tant que mari qui découche, ou renverse la table, en tant que père incapable, follement attachée à ses filles, et qui n’a avec elles aucune relation profonde, parce qu’il ne les comprend pas, pas plus qu’il ne comprend ces femmes qu’il désire, qu’il plaint, à qui il se donne par habitude, ou manie, ou encore pour d’autres raisons ignorées, qui le piègent cependant. Quel sens donner à cette vie, qui soudain va basculer ? Car ce tome du journal, qui couvre les années 2011-2019, inclut « l’affaire Millet », cet hallali des gardiens du temple pour abattre celui qui dérange parce qu’il dit la vérité, qui prennent prétexte d’un texte à propos de l’extrémiste Anders Breivik, texte qu’ils n’ont pas lu, ou pas compris pour les rares qui l’ont parcouru, afin de jeter à terre celui qui a donné à la maison Gallimard deux prix Goncourt, en fabriquant les livres de Littell (Les bienveillantes en 2006), et de Jenni (L’art de la guerre en 2011) : « le roman de Littell a été grandement retravaillé, et j’ai fait dégraisser celui de Jenni pour qu’il soit acceptable selon les critères contemporains. » Le travail d’un éditeur – non pas le marchand, ici Gallimard – qui est de choisir, conseiller, soutenir ses auteurs, le contraint aujourd’hui, pour obtenir le succès, de se prostituer à la doxa dominante ; il n’y a donc plus de littérature, mais une cuisine, un système fondé sur la non-culture, le mépris de la langue, la mise en condition d’un public d’ilotes, gavés de propagande, un public de consommateurs incultes.
De plus, cet éditeur, mué en spécialiste du calibrage de produits commercialisables, ne doit surtout pas déranger ses collègues de la boutique. Richard Millet dérange, il rend jaloux parce qu’il réussit quelques bons coups, mais surtout, il est insupportable parce qu’il est lui-même écrivain, et qu’il se sent obligé, au moins dans ses livres, de dire la vérité sur l’état pitoyable de la littérature française, qui est le signe de l’état pitoyable de la France, submergée par une immigration communautariste à la mode anglo-saxonne. Dieu sait s’il eût aimé que les immigrés devinssent français de bon cœur ! Or il doit constater qu’il n’en est rien. Pourrait-on dire les raisons, expliquer « pourquoi votre fille est muette », notre langue mise à mort, notre vie brisée avec notre patrie ? Non, il faut se taire, car il s’agit d’une volonté arrêtée de détruire, non d’un accident qu’on devrait signaler, afin de le corriger. « C’est la vérité qui fait scandale, aujourd’hui, car quotidiennement blessée. » Volontairement blessée par des sataniques.
Contraint de se replier, sur sa foi catholique et sur sa vocation d’écrivain, Richard Millet sombre dans une nuit obscure, où, dit-il, « j’avance comme une taupe. » Il découvre sa misère : « je pleure presque de ne rien savoir vraiment. » Il ne sait plus s’il est un écrivain, il croit ne pas savoir écrire, n’avoir jamais rien fait que se tromper. Cependant, il lit saint Augustin, Pascal, et il comprend que cette misère est un chemin mystérieusement nécessaire : « Tu ne sais plus où tu en es : c’est que tu n’es pas encore assez perdu. » La solitude, le silence, la souffrance sont des exercices mystiques.
Terrible torture pour un écrivain que de ne plus savoir ce que cela veut dire : être écrivain. Il faut écrire pourtant, car c’est la vocation acceptée qui sauve. La planche de salut de l’écrivain, c’est l’amour de la langue, le travail auquel il s’astreint pour la faire resplendir. Alors, il s’émerveille de découvrir dans le texte d’un auteur fraternel que la beauté ne fait pas connaître l’invisible, ou on ne sait quel mystère, quel au-delà, mais « que la beauté [rend visible] le visible lui-même », qu’elle nous rend voyant de ce que nos yeux voient. Il reconnaît, dans le fil de cette révélation, que « Dieu se manifeste en se cachant. » Il n’est pas loin de comprendre que « tout est grâce », comme le reconnaissait le curé de campagne de Bernanos en citant la petite Thérèse, et il peut affirmer que l’écrivain écrit « pour n’avoir pas à s’expliquer », mais pour s’accepter. Puisque ce mystère est au cœur de la littérature, comment voulez-vous que notre clergé littéraire de marionnettes y comprenne quelque chose, lui qui pratique « l’écrivaillerie contemporaine : démocratie et falsification ; perte du réel ; propagande en faveur d’un Bien qui marque le triomphe du Mal » ?
Ce journal, ce chemin de croix, est aussi bourré de choses vues, de tableaux peints à l’acide, de trouvailles de style si heureuses qu’elles sont de vraies pensées, de portraits incisifs de pseudo-écrivains, de révélations sur le monde littéraire, d’analyses percutantes et géniales de Giono, de Montherlant, sans oublier l’admirable La Fontaine, à propos de qui jaillit cette fulgurance : « ce que lui doit notre langue est incommensurable », ni le merveilleux Molière, dont la langue apparaît soudain, dans la magie d’une représentation réussie, éminemment belle.
Les Sœurs et autres espèces du vivant, Elisabeth Barillé, Arléa, 2024, 196 p., 20 €
Journal – 2011-2019 – Tome V, Richard Millet, Les Provinciales, 2024, 608 p., 32 €