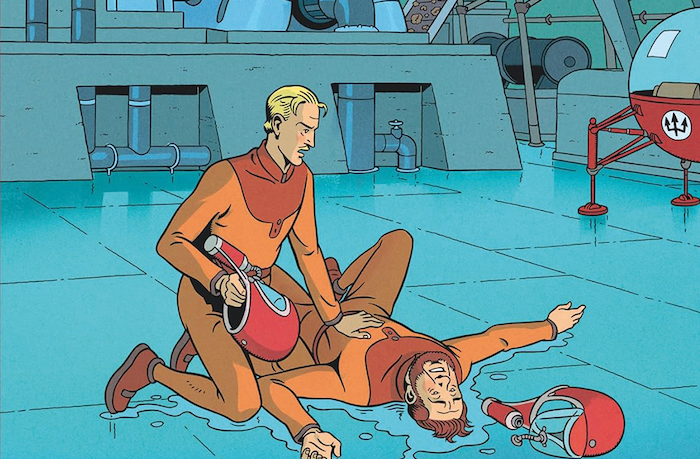Les méditations d’Allan Bloom.
Dans l’éternelle opposition entre l’esprit et la matière, gageons qu’à la fin le premier l’emporte. Conjecturons même que l’esprit est à l’origine de tout. Il est cet archè, à la fois commencement et, surtout, commandement – sans quoi rien ne tient autrement que par le jeu aléatoire des volontés contradictoires – qui fonde toute autorité, quelle qu’elle soit, sans laquelle une société, fût-elle passionnément matérialiste, ne pourrait prétendre valablement demeurer – et encore moins aspirer à être – une civilisation. Les grandes œuvres de l’histoire, celles qui, quelquefois, ont paru toucher au sublime, n’auraient pu accéder à cette qualité, sans que l’âme y fût la cause primordiale, essentielle. Mais si elle semble se situer au faîte de l’édifice, si elle paraît même s’apparenter à cette singularité initiale chère aux astrophysiciens, elle n’en est pas moins consubstantielle à la cause d’Aristote : elle est principe du tout, moteur de l’ensemble, elle l’habite (au sens étymologique du terme, soit au sens fréquentatif de « habere », signifiant posséder, avoir) littéralement, elle le hante (l’on observera d’ailleurs comment la racine de ce mot, provenant de l’ancien scandinave heimta, « conduire à la maison », lui-même dérivé de heim, « maison », nous ramène imperceptiblement au sens actuel d’habiter ; au surplus, que l’esprit entretienne un commerce si particulier avec l’univers spectral et parfois effrayant des revenants ne doit probablement rien au hasard…). Qu’en est-il, cependant, en nos temps actuels ? L’âme et l’esprit s’y épanouissent-ils, comme jadis, non pas de manière désordonnée, au gré de leurs dilections voire des modes ou opinions du moment, mais tendus vers la quête incessante et exigeante de la vérité, foin des relativismes, des scepticismes et des chronocentrismes ? Car telle est bien la prétention infatuée de nos contemporains se prenant pour des géants lorsqu’ils ont mis à bas tout ce qui élevait leurs aïeux. Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des paradoxes, à l’heure de l’ouverture inconditionnelle à l’Autre, de les voir se fermer à ces autres du passé considérés comme archaïques.
Ouverture à l’autre ou fermeture à nous-même ?
Si les Anciens étaient les héritiers culturels d’une nature commune, constatons que les Modernes sont des thuriféraires puritains des cultures diverses, tout en refusant que celles-ci puissent mener à la connaissance d’une nature indivise propre à chaque peuple. Disciple de Leo Strauss, intellectuel méconnu, dont la vie fut entièrement consacrée à l’étude méditative, voire contemplative des grands auteurs (il traduisit Platon), autant qu’à leur transmission à des générations d’étudiants, Allan Bloom (1930-1992) fut probablement le premier à s’élever philosophiquement contre ce relativisme axiomatique de l’ouverture nécessaire et bienfaisante. Il considérait que toute ouverture, loin de faire accéder mécaniquement à la connaissance de l’Autre, nous ramenait, au contraire, à une fermeture à nous-mêmes. Au prétexte relativiste (toutes les cultures se valent) de combattre prétendument notre ethnocentrisme, nous favorisons l’émergence d’ethnocentrismes concurrents qui, une fois élevés au statut de cultures égales en dignité et en intérêt à la nôtre (statut établi selon nos propres canons, ce qui n’est pas la moindre de nos poussées de fièvre ethnocentrique), détiendront ce pouvoir aussi arbitraire que discrétionnaire de se ranger à notre relativisme (autre nom de l’ethnocentrisme occidental) ou de s’en affranchir et d’affirmer leur supériorité conquérante. L’ouverture consiste avant tout à enrichir sa propre culture pour mieux avancer dans la connaissance de sa nature ; Bloom affirmait, en platonicien, que « la nature devrait être la norme selon laquelle nous jugeons nos vies et celles des peuples » (L’Âme désarmée. Essai sur le déclin de la culture générale, 1987).
Le paradoxe des conséquences
En bref, convient-il de faire preuve de discernement dans l’ouverture, celle-ci pouvant déboucher sur une haine de soi pathologique, soit le comble de l’ethnocentrisme (celui-ci consistant à une autodépréciation méthodique et systématique qui n’est que le masque d’une supériorité non avouée, de sa bonté désintéressée et de sa propension généreuse à l’expiation publique de ses fautes supposées). « L’ouverture était naguère la vertu qui permettait de rechercher le bien en se servant de la raison : voici qu’elle équivaut maintenant à l’acceptation de tout et à la négation du pouvoir de la raison ! », s’insurgeait très justement Bloom (L’Âme désarmée). Ce faisant, cette ouverture sans limites et déraisonnée produit ce que Max Weber appelait le paradoxe des conséquences : l’Autre, se situant davantage dans une optique de survalorisation présomptueuse de lui-même que de philanthropie énamourée et d’adhésion inconditionnelle à des valeurs fades (telles que les droits de l’homme ou le principe de non-discrimination), nous condamne à la surenchère perpétuelle dans l’autoflagellation et le cilice culpabilisant : « la raison pour laquelle les non-Occidentaux sont fermés sur eux-mêmes et sont ethnocentristes est claire. Pour préserver leur existence et leur identité, les hommes doivent aimer leurs familles et leurs peuples, et leur être loyaux. Et c’est seulement s’ils pensent que ce qu’ils ont est bon qu’ils peuvent s’en satisfaire. Un père doit préférer son enfant aux autres enfants, un citoyen son pays aux autres. C’est pour cela qu’existent les mythes : pour justifier ces attachements. ». Nos élites gagneraient à méditer Allan Bloom pour le plus grand bénéfice de leurs peuples.