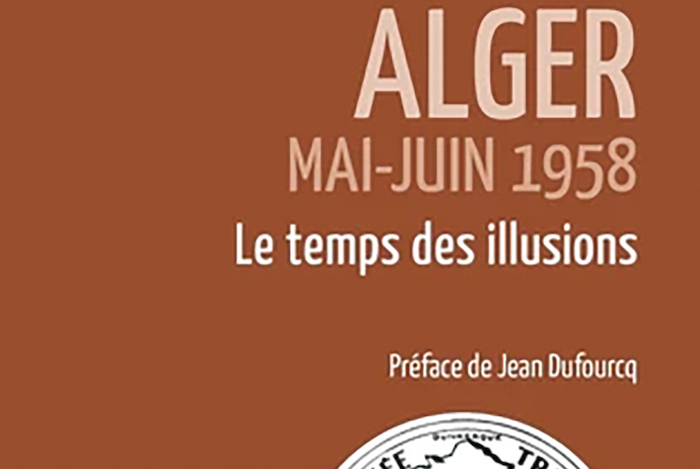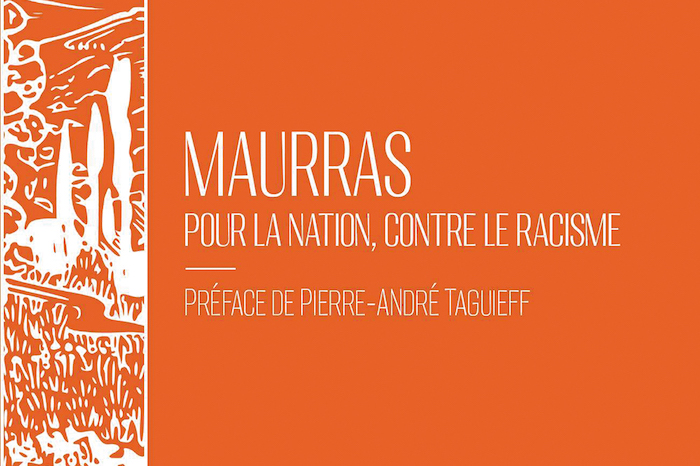Sorte de chronique westernienne mélodramatique, La Dernière séance brosse le portrait sans concession, mais non sans une certaine tendresse désabusée et néanmoins nostalgique, d’une petite ville texane de l’Amérique profonde aux allures fantomatiques, dans laquelle se démènent des jeunes gens, aux fortunes diverses, faisant l’apprentissage social et amoureux de leur future vie d’adulte.
Adapté de The Last Picture Show, roman de Larry McMurtry paru en 1966, le film de Peter Bogdanovich est un coup de maître par sa description esthétique – bien qu’épurée et sans artifice – d’une communauté soudée par l’esprit de camaraderie, sous le regard sévère et sans complaisance des adultes qui ne valent pas mieux qu’eux et n’ignorent rien, qui plus est, des turpitudes et vices de leurs voisins. L’hypocrisie y est une loi assumée et tacitement entretenue par tous. Sam « le lion », superbement campé par Ben Johnson (clin d’œil fordien volontairement appuyé de Bogdanovich), visiblement affaibli par une vie brûlée par les deux bouts, tente de maintenir à flot cette petite bourgade défavorisée de l’Amérique périphérique, abandonnée des grandes métropoles, en gérant le cinéma, la miteuse salle de billards et le café-restaurant, uniques lieux de convivialité, où deux adolescents, Sonny (Timothy Bottoms) et Duane (Jeff Bridges), se retrouvent pour tromper leur ennui, sous son regard bourru et paternel. Certes, bien sûr, il y a les filles, de beauté et d’extraction moyenne et à l’éducation relativement conventionnelle, qui attendent, sans illusion, comme leur mère avant elle, le mariage, les enfants et un mari qui les délaissera pour s’adonner à la boisson, au jeu, au sport, parfois à la bagarre… Un quotidien long et terne que certains évènements (les fêtes rituelles) parviennent à rehausser d’un éphémère éclat d’intérêt, afin de ne pas sombrer dans la déprime, à l’instar de Ruth Popper (Cloris Leachman). Cette dernière symbolise parfaitement cette déchéance affective qui l’a gangrenée par petites touches corrosives et irréversibles. Parce que Sonny, qui vient de rompre avec une de ces saintes-nitouches velléitaires et sans attraits, s’intéresse accidentellement à cette quadragénaire prématurément fanée et à l’existence tristement rangée, celle-ci retrouve, sous les yeux sincères et naïfs et les caresses maladroites de son jeune amant, le piment oublié de la passion amoureuse.
Une vie d’adolescent qui bascule dans l’âge adulte
Mais la figure angélique et sensuelle de Jacy Farrow (Cybill Shepherd, dont Bogdanovich s’éprendra follement sur le plateau, au point de divorcer d’avec Polly Platt, directrice artistique et costumière qui l’avait repérée… avant de la présenter à son mari), la plus belle fille (et la plus riche, aussi) de la ville, manquera de renverser ce petit ordonnancement social établi. Ardemment désireuse de perdre sa virginité (que Duane lui ravira) pour prix de son émancipation sociale, elle s’offre sans compter aux mauvais garçons (notamment le contremaître de son père et amant de sa mère), jusqu’à mettre en péril l’ancienne amitié de Sonny et Duane. Cette tempête une fois dissipée, ne restent que les ruines d’une vie d’adolescent qui bascule rapidement dans l’âge adulte : Duane s’engage dans l’armée et part combattre en Corée, Jacy est partie pour Dallas, Sam est mort subitement, ainsi que son dernier fils, handicapé mental renversé par un camion, le cinéma ferme définitivement ses portes (on gagerait qu’Eddie Mitchell se soit directement inspiré du film pour composer sa célèbre chanson éponyme…). Piteusement, Sonny revient alors auprès de Ruth, dernier vestige d’un monde qui s’efface. La suite, guère brillante, dans Texasville, tourné en 1991… Vingt ans auparavant, Bogdanovich signait ce manifeste du Nouvel Hollywood – équivalent moins pompeux de la Nouvelle Vague, chez nous – par un usage maîtrisé (et inhabituel pour l’époque) du noir et blanc et des plans dignes d’Orson Welles (son mentor). Les références à des films comme Le Père de la Mariée, Winchester 73, La Rivière rouge, Sands of Iwo Jima, sont autant de jalons révélant le parti-pris résolument classique de Bogdanovich. Un brillant testament d’un certain cinéma qui rend hommage aux vieux maîtres…
Politique Magazine existe uniquement car il est payé intégralement par ses lecteurs, sans aucun financement public. Dans la situation financière de la France, alors que tous les prix explosent, face à la concurrence des titres subventionnés par l’État républicain (des millions et des millions à des titres comme Libération, Le Monde, Télérama…), Politique Magazine, comme tous les médias dissidents, ne peut continuer à publier que grâce aux abonnements et aux dons de ses lecteurs, si modestes soient-ils. La rédaction vous remercie par avance.