Civilisation
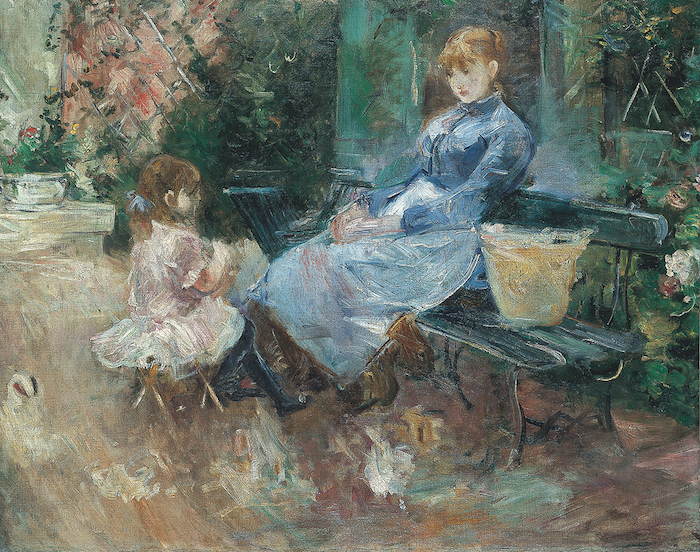
À la recherche du XVIIIe siècle
Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Les experts sont formels : nous mourrons. La chose est vérifiée depuis assez longtemps, sous tous les cieux. Après plusieurs tâtonnements, l’humanité a décidé d’inventer les rites funéraires, les pompes funèbres et les vanités.

Les premiers rassurent, les secondes donnent à nos tristesses tout l’éclat possible – on attend avec impatience qu’Elizabeth II assure le spectacle –, les troisièmes nous font réfléchir. Fut un temps où contempler dans son salon, son cabinet ou son oratoire un bouquet que dévore une chenille ou un crâne grimaçant et véreux faisait partie des saines occupations de l’honnête homme. Aujourd’hui, on regarde les actualités, qui nous abreuvent de morts fugaces, désolantes et sans talent. Ou l’on va à Lyon, admirer une exposition autour des « Vanités d’hier et d’aujourd’hui ».
Car les vanités ont cette qualité d’être faites pour être longuement contemplées, à la faveur d’un rapide regard quotidien ou d’une vraie méditation, en s’abîmant comme saint Jérôme dans un dialogue avec un crâne bruni qui paraît plus loquace que le vif (Hendrick de Somer, Saint Jérôme, 1654) : la Contre-Réforme insistait sur les fins dernières. Comme la chose pouvait être rude, on prisait aussi les natures mortes (ou « vies coites »), avec leur répertoire de bulles de savon, de sabliers et de fumées, signes mélancoliques que la vie nous fuit insensiblement. Willem Claesz Heda, maître du genre, en donne en 1642 une exquise variation avec cette petite table surchargée de vaisselle précieuse où un citron qu’on n’a pas fini d’éplucher et un pâté à la croûte crevée, à peine entamé, semblent avoir épuisé en une bouchée tous les appétits du mangeur, qu’on imagine presque gisant inanimé à terre devant la table, son poids entraînant la nappe : « tout beau dimanche a sa rançon, comme les fêtes ces taches sur les tables où le jour nous inquiète » écrivait Jaccottet. Ces vies silencieuses sont pleines de la présence de la Mort, message assourdi par la beauté des accessoires comme un son entendu derrière une tenture.
La mort se dissimule encore mieux parfois, comme dans cette ricotta attaquée à la cuillère par une joyeuse compagnie (Vincenzo Campi, Les Mangeurs de Ricotta, 1580) : les bouchées ont creusé dans la masse blanche comme deux orbites et une bouche édentée, et on a l’impression que les gloutons inconscients, bien portés sur toutes les chairs, mangent et boivent leur propre condamnation. Le crâne inconsciemment esquissé dans le fromage renvoie au crâne embryonnaire de Chattaway (2000), lui aussi simplifié à l’extrême (que l’on songe au crâne du Bernin récemment redécouvert à Dresde) mais très efficace, moins terrible pour n’être pas vériste mais assez métaphysique quand même. Les squelettes, ou plutôt les écorchés d’Erró (sans titre, série Sur-Atom, 1957), avec leur face trop souriante et leur danse macabre, n’inclinent pas à la réflexion mais au rire grinçant. Les Faces de Philippe Bazin (1985), gros plans très serrés sur des visages de vieillard sans noblesse, miroirs différés du spectateur, disent plus sûrement la déchéance et ont une charge méditative, pour ainsi dire, bien plus élevée. Louis Janmot et sa Fleur des champs (1845) nous en offre une vision plus aimable, avec une mélancolique jeune femme perdue dans ses pensées, entourée de fleurs sauvages dont on sait qu’elles se fanent le temps d’une journée.
L’exposition embrasse ainsi quelques siècles de représentations obliques ou directes de la mort. Il faut avouer que les squelettes nonchalants, comme ceux de Vésale, qui n’ont l’air que d’étourdis ayant oublié leurs chairs, ou les morts plus actives et insistantes, comme celle qui s’agite derrière une jeune femme à sa toilette, lassent un peu : le squelette gravé a perdu de sa force et trop d’images horrifiques nous ont abreuvés (quand bien même le vrai spectacle de la mort échappe désormais à beaucoup) pour que nous frissonnions. En revanche, la caricature est parfaite avec le très contre-révolutionnaire Le Socialisme, nouvelle danse des morts (1850) de Collette, d’après Rethel. Mais enfin, on s’amuse de la dérision plus qu’on ne médite. Les animaux morts, pendus par une patte, ont ce degré de vérité nécessaire pour déclencher la méditation. Mais rien n’égale les bouquets, sombres ou lumineux, fleurs éclatantes ou feuillages humides comme les Plantes, insectes et reptiles dans un sous-bois, de Charles William de Hamilton. La vie y paraît toute résumée, du germe au terme, dans la fragilité des papillons un peu ternes et la vigueur du lézard, le luisant de l’escargot et la mollesse des champignons. Au ras du sol, la vie grouille, sur un humus fait de tout ce qui a péri. Voilà qui nous sort de nous-mêmes.
Illustration : Vincenzo Campi, Les Mangeurs de Ricotta, vers 1580. Huile sur toile. Lyon, musée des Beaux-Arts. Image © Lyon MBA – Photo Martial Couderette.

Willem Claesz Heda, Nature morte, 1642. Huile sur bois. Lyon, musée des Beaux-Arts. Dépôt du musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Image © Lyon MBA – Photo Martial Couderette.