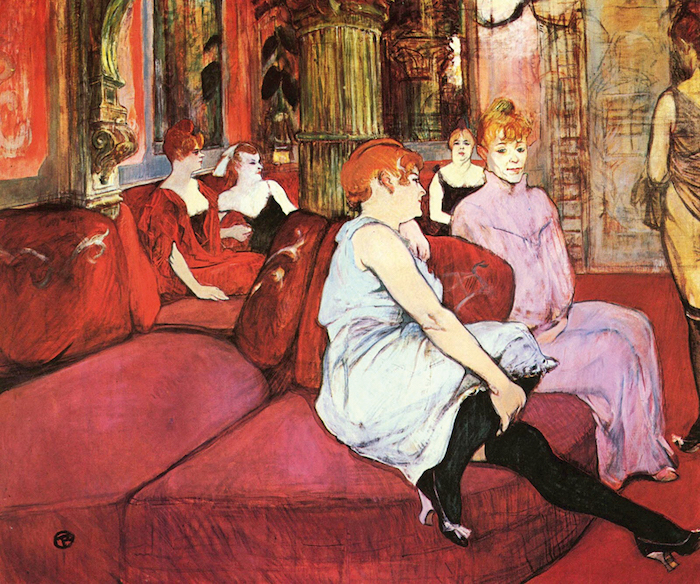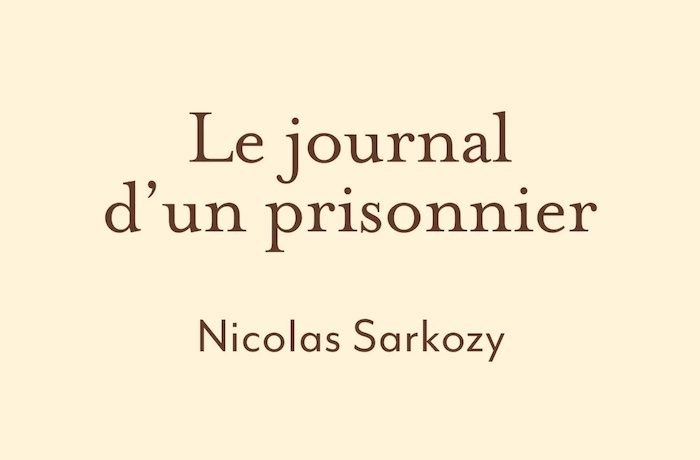Angela Merkel a poursuivi sa politique en s’affranchissant de tout contrôle démocratique. Forte de ses succès d’alors, elle a fait école auprès de Christine Lagarde et d’Ursula von der Leyen. Persuadées elles aussi que les peuples ont tort, elles construisent l’Union européenne en l’entraînant vers un modèle de plus en plus autoritaire.
À partir de 1948, l’Allemagne fédérale s’était reconstruite sur la base de l’« économie sociale de marché ». C’est-à-dire le respect des lois du marché, du droit de propriété qui le soutient et des normes politiques et juridiques libérales qui l’encadrent, la politique monétaire se contentant d’assurer la stabilité de la monnaie et l’intervention de l’État se limitant à soutenir par une législation sociale appropriée ceux qui seraient victimes des à-coups du système. Il s’agissait évidemment de réagir contre l’économie étroitement dirigée et autarcique de la période nazie, où la monnaie n’avait plus de sens, et la propriété non plus.
Dès le début de la construction européenne, la RFA œuvra sans relâche pour que ce modèle, qui était non seulement économique mais aussi juridique et politique, fût élargi à l’ensemble de l’Europe communautaire. Ce fut chose faite avec le traité de Maastricht de 1992 et la création de l’euro, monnaie commune gérée pour garantir sa stabilité. Tandis que la Cour de justice de l’Union européenne de Luxembourg veillait au maintien des normes libérales.
Mais Angela Merkel, chancelière fédérale de 2005 à 2021, pendant 16 ans, a tout changé. Formée en RDA, et programmée pour y faire carrière, elle est montée en grade, après la réunification, dans le parti CDU grâce au soutien du chancelier Kohl, avant de l’évincer à la direction du parti en 1999. Mais elle n’a jamais adhéré profondément aux valeurs de la CDU et de l’économie sociale de marché et a présidé des coalitions avec les socialistes ou avec les libéraux, en fonction des résultats électoraux, sans état d’âme – et en menant de toute façon une politique très personnelle.
Un monde globalisé, postnational, au profit des GAFA
Rappelons à sa décharge que l’« économie sociale de marché » ne fonctionnait plus correctement en Allemagne depuis les années 1990, à cause des charges énormes que comportait la réunification. En outre, la crise mondiale des subprimes en 2008 remit en cause le bénéfice des réformes du chancelier Schröder en 2004 (comme le passage de la semaine de travail dans la fonction publique de 40 à 42 heures…). Mais Angela Merkel réagit en transformant complètement les paramètres de la politique et de l’économie allemandes, en particulier en se soustrayant de fait au contrôle parlementaire et en remettant en cause le droit de propriété. Une donnée statistique le confirme : le taux des prélèvements obligatoires était en 2008 de 39,3 %, à peu près stable depuis des années, il était en 2024 de 45 %.
Une économiste connue, Gertrud Höhler, a expliqué dans un livre paru en 2019 (Angela Merkel – Das Requiem) comment réagit alors la chancelière. Elle engagea une rupture avec l’économie de marché, en particulier en décidant subitement en 2011 de sortir du nucléaire sans égard pour le droit de propriété des sociétés privées à qui appartenaient les centrales et en réglementant totalement le marché de l’énergie. Et en 2015 elle décida unilatéralement d’ouvrir l’Allemagne aux réfugiés, sans contrôle, en faisant fi de la législation allemande et européenne dans ce domaine et donc en s’abstrayant des règles légales. Cette décision a bouleversé la société allemande, et de façon irréversible. Dans les deux cas le parlement a entériné les choses, mais après coup. En fait, l’univers mental de Mme Merkel est celui d’un monde globalisé, postnational, où les individus n’ont plus de personnalité culturelle ou nationale réelle mais ne sont plus que des paquets de données dans un monde digitalisé, au profit des GAFA.
Mais Angela Merkel élargit son action au niveau de l’Union européenne. Cela commença avec la crise grecque en 2010, quand Berlin fit imposer à la Grèce, via Bruxelles, une cure de cheval pour qu’elle reste dans l’euro (alors que beaucoup plaidaient, y compris à Berlin, pour que la Grèce puisse sortir d’une zone euro trop pesante pour elle). Il est vrai que l’année précédente Berlin avait adopté une réforme constitutionnelle limitant à 0,35 % du PIB le déficit admissible, renchérissant même sur le pacte de stabilité européen qui depuis 1997 limitait les déficits des pays de la zone euro à 3 %. Il s’agissait de rassurer l’opinion allemande, très méfiante à l’égard des « Südländer » et craignant que l’union monétaire ne se transforme en « union des dettes »… Mais ce 0,35 % était le dernier obstacle à un abandon complet de l’économie sociale de marché.
Passage de l’économie de marché à une économie planifiée
Cependant l’érosion de ce dernier rempart commença avec Mario Draghi qui, devenu président de la Banque centrale européenne en 2012, engagea celle-ci dans une politique d’interventions sur les marchés financiers visant à racheter massivement des titres de dette publique (« quoi qu’il en coûte », proclama-t-il fameusement). Cette politique, poursuivie par Christine Lagarde, successeur de Draghi en 2019, avec l’appui d’Ursula von der Leyen, nommée au même moment présidente de la Commission européenne, a été encore développée, avec un premier endettement commun des pays de la zone euro au moment de la crise du Covid en 2020. La BCE est complètement sortie de son rôle statutaire, copié au départ sur celui de la Banque fédérale allemande, reposant sur la priorité de la stabilité monétaire, qui était un pilier essentiel de l’économie de marché.
On notera que Mme Merkel joua un rôle essentiel pour faire nommer Mme von der Leyen (alors que le candidat majoritaire pour ce poste au parlement européen était le chrétien-démocrate Weber) et Catherine Lagarde, venue du FMI avec un problème judiciaire en suspens. Le trio, on s’en rend compte avec le recul, joua un rôle essentiel dans le passage de Bruxelles de l’économie de marché à une économie de plus en plus réglementée, voire planifiée, on le voit particulièrement clairement dans le domaine-clé de l’énergie.
Mais Bruxelles, en outre, s’ingérait de plus en plus dans la vie politique des pays membres : Walter Schüssel, chancelier autrichien, avait été soumis en 2000 à un « cordon sanitaire » à cause de son alliance avec l’extrême-droite, Viktor Orban a fait l’objet de fréquentes critiques et de retenues de crédits européens, le candidat de droite à l’élection présidentielle roumaine arrivé en tête au premier tour en novembre 2024, Călin Georgescu, a été écarté par les juges constitutionnels roumains aux applaudissements de Bruxelles (cf. Christophe Boutin dans Politique magazine n°245).
Limitation de la liberté d’expression
Dans le cas de Marine Le Pen, la correspondante à Paris de la FAZ, Michaela Wiegel, a rapporté le 30 mars que l’accusation de détournement de fonds de Bruxelles était sans doute partie du président du parlement européen de 2012 à 2017, le socialiste Martin Schulz, qui aurait attiré l’attention de ses amis politiques à Paris. On verra. Mais il est évident que dans tous les domaines Bruxelles sort de son rôle.
On ne voit pas de changement de cap à l’horizon : à Berlin, une réforme constitutionnelle vient de faire tomber très largement la limite du 0,35 % de déficit, tandis que les Verts ont obtenu que l’Allemagne atteigne, de par sa constitution, la neutralité climatique en 2040 ! La voie est ouverte à un démontage définitif de l’économie de marché, à la remise en cause accrue du droit de propriété, à la planification, tandis que le contrat de gouvernement en cours de négociation entre CDU et SPD prévoit la limitation de la liberté d’expression, au nom bien sûr de la lutte contre les « fake news ».
Cependant deux obstacles se présentent : toute cette politique, du point de vue allemand, ne pouvait fonctionner que si l’on continuait à recevoir de l’énergie russe à bon marché ; c’est fini depuis le 24 février 2022. Et si l’Amérique continuait de son côté dans la voie qu’elle avait choisie dès les années 1960 pour contrer l’Europe en construction : le libre-échange généralisé, dans un contexte de globalisation économique et civilisationnelle, perspective à laquelle au fond Berlin et Bruxelles s’étaient ralliés. Or ça, c’est fini depuis le 2 avril… Qu’est-ce qui reste ? La perspective d’une dépendance toujours croissante envers Pékin ?