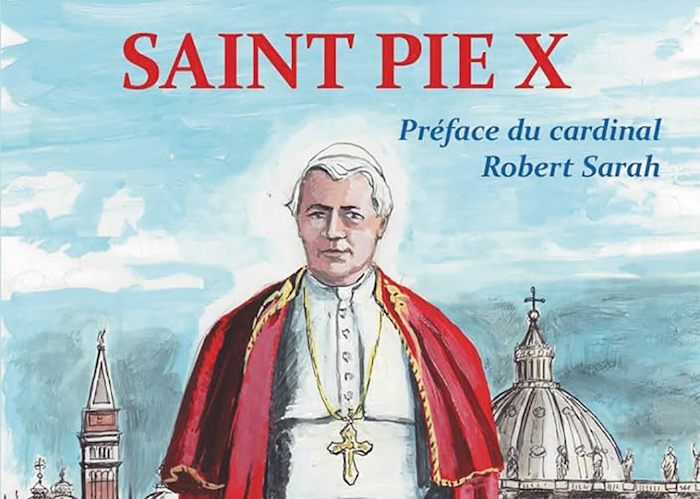Les empires de ce monde sont mortels, nul ne l’ignore. Mais ne disparaissent-ils point par dégoût d’eux-mêmes ? La question semble faire peur à nos politiques. Elle vaut pourtant la peine d’être posée.
[groups_non_member group= »Abonné »]
[/groups_non_member]
[groups_member group= »Abonné »]
Les vieux manuels d’histoire résumaient l’affaire en quelques mots et une date : en 476, Odoacre déposa Romulus Augustule et renvoya les insignes impériaux à Constantinople. Les optimistes interprétaient l’événement comme une réunification de facto de l’empire, coupé en deux à la mort de Théodose en 395. Les autres y voyaient à raison la fin du modèle impérial, drame dont l’Occident ne se remettrait jamais tout à fait. Comment en était-on arrivé là ?
Les explications avancées par les historiens pour expliquer ce désastre sont si nombreuses qu’un universitaire allemand en fit un dictionnaire aux entrées parfois surréalistes. Selon les époques, les partis pris, les humeurs, chacun avançait sa vision exclusive du drame : la faute aux Chrétiens, aux païens, aux homosexuels, aux moines, à l’excès de richesses, à la crise économique …
L’hypothèse : hiver 405
Au vrai, ces hypothèses tournent toutes autour d’un point central : l’hiver 405, la barrière du limes céda soudain, laissant déferler sur les provinces romaines des hordes barbares plus ou moins sanguinaires qui ravagèrent tout, ou peu s’en fallait, sur leur passage. Incapable de leur opposer une résistance militaire efficace, l’empereur Honorius, définitivement en position de faiblesse au lendemain du sac de Rome, en août 410, fut contraint de négocier avec les principaux chefs germaniques et de leur concéder les territoires qu’ils contrôlaient déjà. Si l’empire d’Occident survécut, en tout cas officiellement, plus d’un demi-siècle à ce désastre, ce fut au prix de concessions honteuses et de bricolages habiles. Puis l’Europe s’enfonça peu à peu dans une nuit dont elle tarderait longtemps à sortir.
L’on prendra garde que cette thèse, pourtant incontestable, devient aujourd’hui, d’après certains, indéfendable. Attribuer à l’arrivée massive d’étrangers les cataclysmes qui aboutirent, à moyenne échéance, à la disparition du pays d’accueil et de sa civilisation pourrait, extrapolé à des situations actuelles, conduire à des conclusions non-conformes au discours officiel…
En réalité, la grande invasion de l’hiver 405-406, si elle a déstabilisé définitivement l’empire romain d’Occident, n’a fait que mettre en évidence une série de facteurs de destruction bien antérieurs à l’événement.
Le premier, et l’essentiel, est d’ordre politique. L’impérialisme de la Rome républicaine, en repoussant toujours plus loin les limites des provinces soumises à la Ville, interdisait, sous peine de dislocation rapide, de conserver des institutions conçues à la mesure d’une Cité-État. César l’avait compris mais n’avait pas su faire partager sa vision à ses contemporains ; il en était mort. Octave, son petit-neveu, fut plus habile ; profitant de l’épuisement consécutif à trop de guerres civiles, il imposa un pouvoir fort de type monarchique mais se garda de prendre le titre royal et ne s’affirma que « princeps », prince, autrement dit « premier » parmi ses égaux. Cette astuce sémantique sauvait les apparences, en même temps que les grasses prébendes d’un Sénat moins soucieux de ses pouvoirs législatifs que de ses privilèges.

Empire romain sous Trajan, en 117 ap. J.-C.
Cependant, et ce fut l’incontestable malheur de l’empire romain, il lui manqua, pour s’établir sur des bases solides et durables, la stabilité assurée par une succession dynastique, et un frein à la toute-puissance d’un prince, parfois éphémère et dépourvu de vraie légitimité mais prompt, cependant, à se muer en tyran. Ni les Julio-claudiens, minés par une consanguinité porteuse de tares héréditaires, ni les Flaviens, ni les Antonins, ni les Sévères ni les Constantiniens ni les Valentiniens ne parvinrent à s’imposer durablement à la tête de l’empire et leurs dynasties disparurent en deux ou trois générations, provocant des vacances du pouvoir suivies d’usurpations et de guerres civiles dont la répétition épuisait les ressources humaines et économiques de l’Empire. Cette fragilité, fruit de postérités peu nombreuses et d’une mortalité infantile écrasante, tenait aussi aux disparitions brutales et prématurées de nombre de détenteurs de la pourpre, au point que l’on a pu qualifier le Principat de « tyrannie tempérée par l’assassinat ».
La toute-puissance d’un seul homme provoquait en effet souvent ce que les Grecs appelaient « ubris », la démesure, par définition interdite aux mortels. Il fallait un contre-pouvoir à opposer au Prince, une puissance au dessus de la sienne, capable de lui imposer des limites. Seule la christianisation de l’empire et de ses détenteurs le permit. En contraignant Théodose à s’agenouiller devant lui dans la basilique de Milan, le soir de Noël 390, et à demander pardon à Dieu du sanglant massacre de Thessalonique, l’évêque Ambroise arrachait le pouvoir monarchique à ses dérives possibles et donnait aux souverains chrétiens leur légitimité, en les soumettant à une loi divine plus haute que leurs caprices. Ce cap décisif survint trop tard et les amateurs d’uchronie ont loisir de rêver en se demandant ce qu’il serait advenu si, vers l’an 100, Domitien, au lieu de les faire supplicier pour « crime d’athéisme », avait cédé la pourpre, comme il l’avait envisagé, à ses cousins convertis au Christ …
La grande invasion
Cette faiblesse du pouvoir politique s’est communiquée au reste de la société. Dans un monde où rien n’est stable, la recherche du bien public cède la place à un égoïsme et un matérialisme forcenés. Dénatalité, prévarications, concussions, fraude fiscale, refus du service militaire se multiplient, chacun ne pensant qu’à jouir de ses biens sans se soucier du reste. C’est parce que les Barbares, fascinés par les richesses, à portée de main, de l’Empire, commencent, dès le milieu du IIe siècle, à passer le Rhin. Ils viennent piller les provinces belges ou gauloises mal défendues faute de troupes, car les Césars, à défaut de soldats issus du monde romain, engagent toujours plus de supplétifs germaniques. Avant la grande invasion, massive, violente, qui se solda par un bain de sang et la destruction de provinces entières, il y a, pendant plus d’un siècle, l’entrée lente, acceptée avant d’être subie, de populations étrangères que Rome assimilera. Certains de ces chefs de guerre deviendront incontestablement plus romains que les Romains. Jusqu’au moment où le modèle ne fonctionnera plus, empêchant l’assimilation de nouveaux arrivants trop nombreux…
Car, si le confort et la richesse entrevus ont attiré ces populations, elles ont aussi subi, du moins parmi leurs élites, l’attraction du modèle romain. Elles se sont voulues romaines parce que ce mot recouvrait des vertus, des comportements, un code d’honneur, un dévouement à la chose publique auxquels ces gens se montraient sensibles. Dès l’instant où les Romains cessèrent de pratiquer les vertus qui avaient fait leur force et leur grandeur, ils ne furent plus pour les Barbares un modèle à imiter mais un repoussoir ; il devenait même nécessaire de les éradiquer afin d’imposer un ordre différent, que les nouveaux venus – parfois écoeurés comme l’avaient été les Goths pénétrant pour la première fois dans les dèmes balkaniques au spectacle des turpitudes et débauches des prétendus « civilisés » – jugeaient finalement supérieur. L’affrontement devenait inévitable dès lors que les Barbares se sentiraient en force.
Rien d’étonnant, alors, si les dernières digues opposées à leur domination le furent par des personnalités restées obstinément fidèles – tel le patrice Ætius, vainqueur d’Attila aux champs catalauniques, surnommé « le dernier des Romains », ou les grands évêques gaulois et italiens – aux vertus de la Rome éternelle. Ætius finira assassiné en 454 par Valentinien III, qui ne lui arrivait pas à la cheville… « L’empereur s’est coupé la main droite avec la gauche. » commenteront les contemporains effarés.
Oui, il arrive que les empires se suicident…
[/groups_member]


![Y eut-il un suicide romain ? [PM]](https://politiquemagazine.fr/wp-content/uploads/2015/03/Bernet1138.jpg)