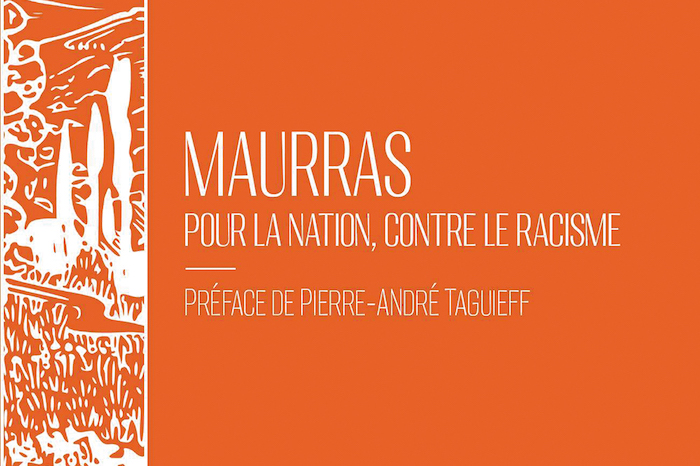Les méditations de Curzio Malaparte. Il ne paraît pas exagéré d’affirmer que nous vivons des temps de troubles.
Nos démocraties modernes traversent incontestablement des zones de turbulence – ce qui ne prélude pas nécessairement à leur disparition prochaine. Nihil novi sub sole rétorqueraient vraisemblablement les plus doctes des commentateurs, sociologues, journalistes ou historiens – par surcroît, éminemment assurés de la victoire, in fine, de l’État de droit et de la démocratie libérale. En un certain sens, n’auraient-ils d’ailleurs pas tort. Si la prise du Capitole par « les partisans de Donald Trump » ou celle des principaux lieux de pouvoir au Brésil par ceux de Jaïr Bolsonaro ont échoué, n’est-ce pas avant tout parce qu’il a manqué aux insurgés une indestructible foi insurrectionnelle, qu’une longue accoutumance aux institutions démocratiques, conjuguée à la préoccupation incoercible et intériorisée du légalisme, a empêché d’éclore jusqu’à l’embrasement des cœurs et des esprits. Doit-on en conclure que tout pronunciamiento est voué à l’échec face à des démocraties dévoyées qui ne perdureraient que par le simple souvenir artificiellement entretenu de l’apparat d’un éclat originel qui se serait pourtant terni à mesure des alternances et des mandatures ? Il convient de relire Curzio Malaparte (1898-1957), auteur essentiel pour appréhender un phénomène aussi protéiforme que la prise du pouvoir en dehors des voies constitutionnelles normales. Sa Technique du coup d’État – qui connut un vif succès lors de sa parution en 1931 et lui valut d’être persécuté par Mussolini qui le mit en résidence forcée durant cinq années – demeure encore aujourd’hui un livre qui sent la poudre. Nulle apologie du golpe, mais dissection au scalpel d’expériences historiques diverses (du coup d’État du 18 Brumaire à l’accession au pouvoir d’Hitler – qui, paradoxalement, le conquit par les urnes) de cette voie parallèle jugée, par principe, aussi illégale qu’illégitime – à plus forte raison si elle échoue. Dans son essai, Malaparte met précisément l’accent sur la dimension « libérale » du coup d’État moderne tel qu’inauguré par Bonaparte.
Se préoccuper de l’éventualité d’un coup d’État
Le talon d’Achille des démocraties actuelles réside, en effet, dans la confiance quasi aveugle qu’elles mettent à la fois dans la défense et la promotion des libertés publiques comme dans leur Parlement – voire, depuis 1945, leur juge constitutionnel. Il est certes tragique que cette faiblesse soit en même temps ce qui constitue le noyau atomique des démocraties qualifiées de libérales, en raison du rang éminent accordé à la Liberté, mais il est un fait que, sans cette marque du destin, elles ne pourraient s’afficher ès-qualités. Or, « dans les pays où l’ordre est fondé sur la liberté, l’opinion publique a tort de ne pas se préoccuper de l’éventualité d’un coup d’État », écrit l’Italien. Les gouvernants partagent également ce tort et les peuples, devant des démocraties essoufflées, intumescentes et nominales, ne devraient pas moins oser méditer cette voie de conquête du pouvoir comme une opportunité salvatrice. Cette « éventualité » devrait sonner comme une sommation aux oreilles des premiers, avant exécution par les seconds. Malaparte prévient : « Il est clair que ni les gouvernements, ni les catilinaires, ne se sont encore posé la question de savoir s’il y a une technique moderne du coup d’État, et quelles en peuvent être les règles fondamentales ». En premier lieu, nous savons, avec Maurras, que le coup de force advient comme la conséquence logique d’une « conspiration à déterminer un état d’esprit » (Si le coup de force est possible, 1910).
Neutraliser les organes techniques vitaux de l’État
Par une malice de l’histoire, il s’avère que les opinions publiques n’ont dû leur préparation mentale et psychologique qu’aux errements impolitiques de leurs élites dirigeantes qui ont instillé en celles-là ce virus populiste, dont l’incubation leur est méprisamment et continument reprochée par celles-ci. Le populisme serait donc cet esprit public particulier d’hostilité radicale à la « démocratie sans le peuple » confisquée au seul bénéfice de ces dernières. Cependant, instruit notamment par Trotsky qu’il considère comme un orfèvre dans « l’art insurrectionnel », l’auteur de La Peau estime que cette « circonstance spécifique », pour favorable qu’elle apparaîtrait, ne serait pourtant, ni nécessaire – dans le cadre d’une sédition militaire – ni suffisante – dans le cadre d’une stratégie révolutionnaire. Il cite Trotsky pour qui l’important est de « s’en tenir à la tactique, agir avec peu de gens sur un terrain limité, concentrer ses efforts sur les objectifs principaux, frapper droit et dur. [… ] Les choses dangereuses sont toujours extrêmement simples ». Point n’est besoin de s’attaquer – en vain – aux organes politiques, attendu qu’il est plus efficace de neutraliser les organes techniques vitaux de l’État (transports, énergies, communications, services publics, etc.). En face, la tactique insurrectionnelle ne rencontrera que les traditionnelles méthodes policières de l’État – d’autant plus inadaptées, qu’à une guérilla il convient d’opposer la soldatesque. In fine, toutefois, seul – et c’est considérable – peut manquer le désir ardent des conséquences (le renversement du Pouvoir) quand la volonté de départ a enflammé les causes (insurrectionnelles). Ainsi est-il frappant de constater, nonobstant quelques foyers d’agitations sporadiques, combien les peuples sont devenus dociles et abouliques, anesthésiés par le confort émollient du capitalisme de la séduction.