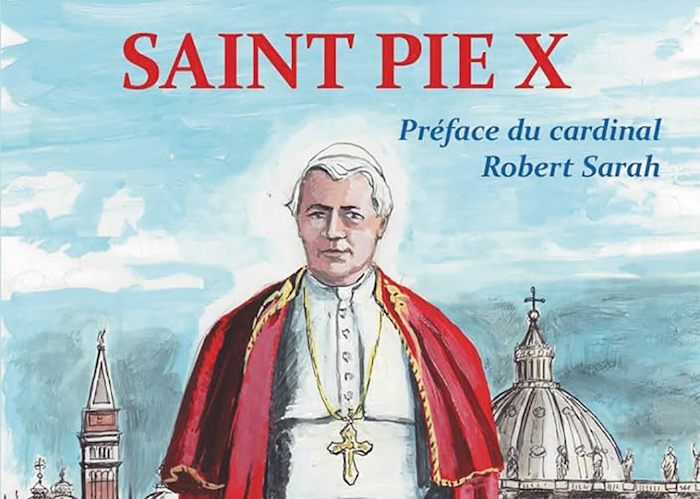Le 150e anniversaire de la Commune nous semble constituer l’occasion de revenir sur ce foyer de l’action politique et administrative qu’est, précisément, la commune. La Commune de Paris représente cette expérience unique, en France, de gouvernement local autonome. Il convient de saisir l’essence philosophique profonde de ce mouvement communal – sinon communaliste – singulier. Une démarche d’autant plus louable, à l’heure où, depuis quelques années, déjà, ce vivier authentique de la démocratie ne cesse d’être affaibli, pris en tenaille entre une euro-régionalisation par le haut et un supra-municipalisme intercommunal par le bas – les deux tendances concourant à l’instauration d’un jacobinisme, déconcentré d’un côté, décentralisé de l’autre.
L’on doit à Alexis de Tocqueville (1805-1859), alors qu’il parcourait la jeune Amérique nouvellement indépendante, d’avoir tenté de théoriser précisément cette forme si particulière de l’organisation politique qui entretient un rapport étroit avec la liberté, comme son histoire et son étymologie nous l’enseignent. Dès le XIIe siècle, les seigneurs féodaux, par souci de réalisme, devant la montée en puissance, économique et commerciale, de ces entités locales issues autant des municipiums romains que des anciens schwörtag germaniques – ou serments de solidarité unissant les tribus –, leur octroient des chartes de franchise ou, mieux, les établissent en « communes » dotées de prérogatives élargies. C’est dire que le terme, par métonymie, prend rapidement son sens de « ville affranchie » (dont les nombreuses « Villefranche » au sud de la Loire, demeurent les vestiges les plus vivaces). Dans son fameux traité De la démocratie en Amérique (1835-1840), Tocqueville souligne cette ancienneté de la commune qu’il impute presque à un fait de nature : « La commune est la seule association qui soit si bien dans la nature, que partout où il y a des hommes réunis, il se forme de soi-même une commune. » Sur les pas d’Aristote, le Normand insinue donc que la commune serait l’expression la plus complète de la socialité politique de l’homme. Mieux, écrit-il, « la commune paraît sortir directement des mains de Dieu ». Toutefois, « la liberté communale est chose rare et fragile », en ce sens que, « parmi toutes les libertés, celle des communes, qui s’établit si difficilement, est aussi la plus exposée aux invasions du pouvoir ». Pour obvier à cet obstacle, il est impératif que les institutions communales aient durablement imprimé leur marque dans les « idées et […] les habitudes nationales ». L’apport de Tocqueville, à ce stade, devient précieux en ce qu’il loue, partant de ses observations in situ (il décrit, en l’espèce, la Nouvelle-Angleterre, dont les institutions lui paraissent exercer « une influence prodigieuse sur la société entière »), « l’esprit communal » qui soutient et vivifie le pouvoir local. Ainsi, le citoyen communal « s’attache à sa commune, non pas tant parce qu’il y est né que parce qu’il voit dans cette commune une corporation libre et forte dont il fait partie, et qui mérite la peine qu’on cherche à la diriger ». Proudhon nous aide à expliciter le propos : « vraie base de toute république (…), la commune est, par essence, comme l’homme, comme la famille, comme toute individualité ou collectivité intelligente et morale, un être souverain. » En d’autres termes, la commune, comme organisation politique naturelle, est un corps dont les parties ne peuvent souffrir nulle entrave, sauf à le blesser ontologiquement. Il va même jusqu’à faire de la commune l’allégorie politique et collective de « la vie [qui] ne connaît de limite qu’elle-même ; toute coercition du dehors lui est antipathique et mortelle » (Théorie du mouvement constitutionnel au XIXe siècle, 1870). En dépit des griefs « contractualistes » qu’il adressera au fédéralisme anarchiste du Bisontin, Charles Maurras, en subsidiariste intégral, n’en tiendra pas moins que ce dernier, et à l’instar de Tocqueville, pour les « libertés communales », la commune étant « le seul groupe à la fois naturel, historique et légal » (L’Idée de décentralisation, 1898).
Mais la lecture de L’Ancien régime et la Révolution (1856), du même Tocqueville, s’avère bien plus instructive sur les motifs de cette ardeur communaliste. En substance, il y est écrit, en effet, que le centralisme de Louis le Grand, renforcé par la Révolution, avait été lui-même « le commencement de cette révolution et son signe ». Si les libertés municipales avaient survécu sur les ruines de la féodalité, l’abolition des chartes, à la fin du XVIIe siècle, introduira le germe de la contestation dans un pays où les peuples étaient enclins à ne respecter aucune loi, sauf, d’abord, celles qu’ils se fussent données à eux-mêmes dans leurs états paroissiaux et communaux. Or, prévient-il, les « menteuses apparences » de la liberté sont, pour le pouvoir, une lourde gageure à relever. Il finit, tôt ou tard, par s’y rompre les reins, jusqu’à choir et déchoir. Une leçon que devraient méditer nos maîtres actuels, en ces temps de tyrannie médicale directement importés de l’île des Morticoles de Léon Daudet.