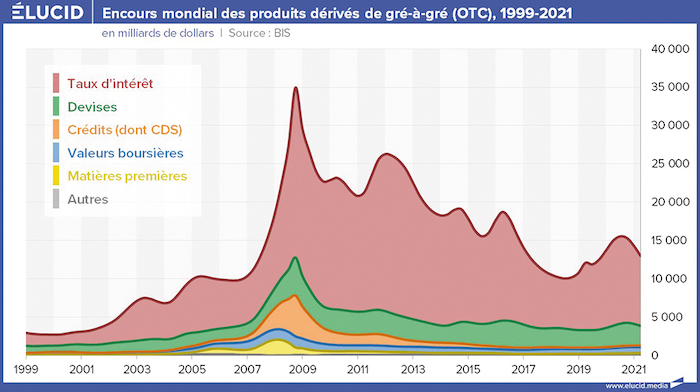Une fois de plus, une grève monstre paralyse le pays, suivant une habitude devenue une tradition nationale. Les Français sont prisonniers de deux travers :
- d’une part, d’une tradition révolutionnaire de soulèvement du peuple contre la « tyrannie », et de lutte des classes opposant les travailleurs aux patrons et à l’État, les pauvres aux riches, et qui implique, en vertu d’une sorte de loi de la morale et de l’histoire, la capitulation des seconds devant les premiers ;
- d’autre part, d’une conception naïve de la politique, consubstantielle à la démocratie républicaine, suivant laquelle le destin de la nation dépend uniquement des élections, et qu’un peuple peut, à tout moment, décider de son destin, de son organisation économique et sociale, et opter, à son gré, pour le progressisme, le conservatisme, le socialisme, le libéralisme, voire la démocratie ou la dictature.
Un monde libéral destructeur de la liberté
Les choses, aujourd’hui, ne sont pas si simples. Le monde actuel, aggloméré, compact, mondial, total, autoconstruit et autorégulé, régi par le nomos plus que par la thesis, rend caducs ces deux éléments de notre tradition démocratique. Ni les personnes ni les peuples ne décident en toute indépendance de leur destin, nonobstant le règne officiel de la liberté et le libre cours insolent de l’individualisme débridé. La liberté sans frein des sociétés ouest-européenne et nord-américaine a engendré son contraire, la servitude. Elle s’est dévorée elle-même, tel Jörmungand, le serpent monstrueux de la mythologie scandinave qui embouche sa queue, et elle a dévoré ses enfants, à la manière de Saturne. Notre monde matérialiste et amoral, réduit aux dimensions du village planétaire cher à McLuhan, ce monde aux parties mutuellement enchaînées et totalement interconnectées, dont le marché est tout à la fois le carburant, le moteur, la seule règle de fonctionnement et le succédané d’âme, rend paradoxalement impossible toute manifestation tant soit peu sérieuse d’indépendance des peuples et des individus. Alors même qu’il érige la liberté et les droits des peuples, de la personne et de l’homme, en principes inviolables et en étendard.
De l’offensive à la défensive
C’est évident, mais nos compatriotes semblent ne pas le comprendre. Ils s’accrochent au mythe révolutionnaire et républicain. Celui-ci fausse leur jugement et les empêche d’admettre qu’ils n’ont plus le choix, qu’ils vivent en un moment de l’histoire où ils ne peuvent plus imputer leurs difficultés à des ennemis de classe égoïstes et malveillants, ou à un mauvais choix politique auquel un bon scrutin ou de grandes grèves et manifestations peuvent remédier. Le mythe révolutionnaire a d’abord joué le rôle d’un facteur de progrès sur le chemin de la liberté, de la démocratie et du bien-être. Puis, à partir des années 1970, il a servi à éluder les nécessaires réformes de notre système de protection sociale. Réformes rendues indispensables par l’inadaptation de ce système à l’évolution de notre situation économique, de notre évolution démographique, et de la mondialisation d’un capitalisme financier sans aucun frein, et que nulle politique et nulle morale ne pouvait plus borner, contenir ou contrarier. Nous n’étions plus une très grande puissance, notre équilibre démographique devenait précaire, nos charges sociales obéraient la compétitivité de notre économie. Et la morale chrétienne d’une part, les idéaux socialistes d’autre part, avaient perdu toute prise sérieuse sur nos élites, donc toute efficacité sociale et politique ; la première se diluait dans le culte des droits de l’homme, tandis que les seconds cédaient la place à l’individualisme, à la désolidarisation des parcours et des destins personnels, à la dissolution des liens socioprofessionnels, et à la recherche hédoniste et égoïste du confort privé.
En un tel contexte, il n’était (il n’est) d’autre choix que de mettre notre système de protection au diapason du néolibéralisme de notre temps, afin de le préserver au mieux. Or, ce néolibéralisme représente le contraire absolu, antipodique, de l’idéal révolutionnaire, démocratique et social sous-tendant l’ethos de la France contemporaine. D’où le refus radical de notre peuple de consentir à cette sorte de contre-révolution libérale. Le peuple français freine des quatre fers et se cabre en une raideur d’acier trempé. Et, ainsi, alors que jusqu’à la fin des années 1960, il luttait pour de nouvelles conquêtes sociales visant l’accroissement de son bien-être, il cherche désespérément, depuis plus de quarante ans, à conserver ses acquis, remis en question par le néocapitalisme actuel et notre situation économique et démographique. Il ne s’agit plus d’une offensive, comme autrefois, ni même d’une contre-offensive, mais d’une défensive, voire d’un repli, d’une retraite (sans mauvais jeu de mots) du genre de celle de la Marne, destinée à stabiliser le front et à éviter de reculer davantage. Notre peuple a, depuis les deux dernières décennies du siècle précédent, perdu un certain nombre d’avantages sociaux dans le domaine de la santé et des retraites, tout en ayant quelquefois résisté victorieusement à certains plans de réforme audacieux (tel celui de Juppé en décembre 1995).
L’absence totale d’alternative
Et il semble condamné à subir continuellement des amputations ou des modifications drastiques de son système de protection sociale. Il semble condamné à subir, oui, car moralement, il n’accepte pas ce sacrifice, ou alors il s’y résout la mort dans l’âme. Et un peuple désespéré n’a plus d’avenir.
Mais il n’a pas le choix. Le monde actuel ne lui ménage aucune solution alternative. Il est d’ailleurs significatif que les opposants à la présente réforme ne présentent à celle-ci aucune autre solution convaincante. La demande de référendum du Rassemblement national ne fait qu’ajourner la question. Le contre-projet des Républicains se démarque mal de celui du gouvernement. Les écologistes, par la voix de Yannick Jadot, donnent dans l’utopisme en préconisant la taxation des capitaux et en affirmant que la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), créée en 1996, aura remboursé la dette de la Sécurité sociale en 2024. Cela est faux, et tout le monde le sait. Yannick Jadot oublie délibérément que la CADES – instituée précisément à la suite de l’enterrement du projet Juppé de réforme des retraites – est financée essentiellement par la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), un impôt, que sa mission, qui devait prendre fin en 2014, a été prolongée jusqu’en 2024, le délai initial se révélant intenable, et qu’il n’est pas certain qu’elle aura remboursé la dette sociale d’ici cinq ans. Quant à Olivier Faure, le patron du PS, il nie purement et simplement le problème en déclarant que « le système des retraites n’est absolument pas en péril » et que « ses déficits [amenés à passer de 7,9 milliards d’euros à 17,2 en 2025, si rien n’est fait] sont le résultat de la politique conduite par le gouvernement. La France insoumise (LFI), le parti communiste et la CGT, eux, tapent à coups redoublés sur tout projet de réforme des retraites, prétendant n’accepter que celui qui ne changera rien aux conditions actuelles de cessation d’activité et aux régimes spéciaux ; soit la quadrature du cercle.
En vérité tout le monde sait (au moins intuitivement) que la réforme de notre système de retraites est inévitable, que ne rien faire de sérieux mène à sa disparition ou à sa marginalisation (les fonds de pensions et systèmes privés de retraites par capitalisation prenant peu à peu le relais), à la diminution continuelle des pensions, donc à la misère assurée de leurs titulaires. Et tout le monde perçoit également que la réforme du gouvernement (ou toute autre) imposera des sacrifices et des renoncements pour les futurs retraités (il n’est que de considérer la situation des retraités dans les pays européens ayant réformé leur système de protection sociale, pour s’en rendre compte), les conséquences en étant cependant moins sérieuses que celles de l’inaction et de l’immobilisme. Mais nos compatriotes ne veulent pas l’admettre, arc-boutés qu’ils sont sur leur mythe républicain et socialiste. C’est ce qui explique que, selon les sondages, les Français jugent indispensable la réforme des retraites, mais se défient du projet du gouvernement et approuvent les grévistes. Ils veulent d’une réforme qui ne change rien, d’une évolution dans l’immobilité. La réforme inutile, ou mieux, l’initiative réformatrice non suivie d’effet, est devenue une spécialité française. Il n’est qu’à considérer le domaine de l’enseignement : depuis des décennies, on accumule les rapports, les « livres blancs », les colloques, les « états généraux de l’éducation », les lois d’orientation, les lois tout court, et les décrets, pour rien, le marasme de notre système scolaire et universitaire subsistant dans toute son ampleur et toute sa tragédie. On ajourne les réformes inévitables, on tire des traites sur l’avenir, on gonfle la dette publique en la mettant sur le dos des générations futures, on accroît la pression fiscale et toutes les charges. Mais arrive le moment où le paiement de l’échéance ne souffre plus de report. C’est le cas présentement.
Des sacrifices qui auraient pu être allégés
Le temps des sacrifices nécessaires est venu, et pas seulement en France. Il reste que, tout de même, ces sacrifices douloureux auraient pu être allégés. Il auraient pu l’être, au plan international, si, en Occident, nous n’avions laissé dériver notre civilisation – et très volontiers, du reste – en un ordre mondial amoral et immoral, régi par la seule loi du marché, dénué d’autres valeurs que celles cotées en bourse, sans âme, miné et corrompu par tous les délices, poisons et nectars toxiques et addictogènes de l’individualisme et de l’hédonisme du plus bas étage. Ils auraient pu l’être également en France si nous n’avions pas abandonné notre système de protection sociale à un mode de gestion semi-étatique, source de gabegie, d’irresponsabilité généralisée et de féodalisme syndical : c’est le dernier avatar de notre fameux « pacte républicain » ou « modèle républicain », mâtiné de tradition révolutionnaire et de mythe socialiste.
Aujourd’hui, le recul, le report des échéances n’est plus possible, et il n’existe ni alternative politique, ni alternative économique et sociale. À l’évidence, nous sommes au bout du bout de notre démocratie républicaine.