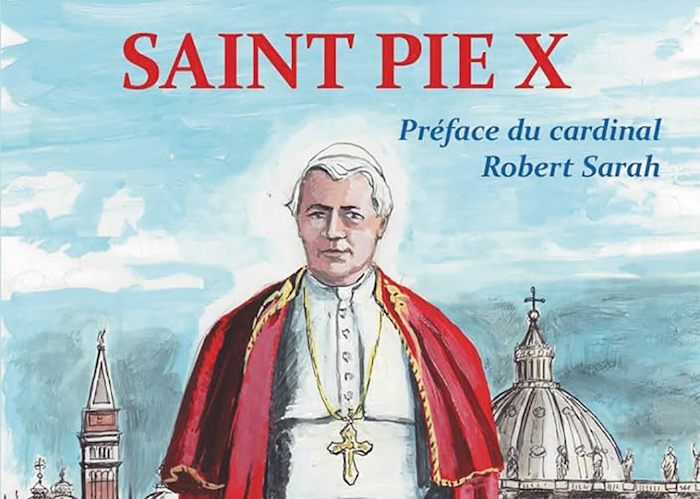Heureusement que l’école a changé. C’est en tous cas ce qu’explique Michel Bouvier dont on retrouvera la critique du dernier livre, un polar, en fin d’article…
On m’a mis à l’école à la rentrée 1946, en un temps de profonde barbarie. Et comme mes parents n’étaient que de misérables abrutis, ils m’ont mis à l’école libre. J’ai compris plus tard que les curés exploitaient en ces lieux malsains de pauvres bougres qu’ils payaient à peine. Ces gens, qui s’affublaient du titre de « maître » et portaient de longues blouses grises, n’avaient même pas les diplômes qui auraient pu leur permettre d’enseigner dans la véritable école, celle qui n’était pas libre. Ma mère, épuisée par les privations de la guerre et par une nouvelle maternité, devait se reposer ; elle avait obtenu du directeur d’école où mes frères aînés étudiaient déjà de me placer en garderie au fond de la petite classe, sous l’œil d’une vieille fille en tablier bleu, qui était chargé d’enseigner les rudiments à des gamins hébétés. Elle le faisait avec des méthodes archaïques, dont je n’ai su que bien plus tard qu’on les appelait « syllabiques », dans des livres d’un autre âge, moyennant quoi la moitié de la classe savait lire à Noël, et l’autre moitié avant Pâques. Quant à moi, qui était là en toute illégalité (il fallait être dans une école libre pour voir de telles horreurs !), supposé jouer avec mon ours quand je ne somnolais pas en suçant mon pouce, manifestant dès 4 ans la curiosité malsaine qui est restée un trait déplorable de ma nature, je suivais si passionnément les criailleries de la vieille fille que je me mis à lire le journal de mon père dès le début du mois de décembre. Le pauvre homme me surprit, un soir qu’il rentrait épuisé par son dur labeur, en train de parcourir son canard. Il me demanda ce que je faisais là.
La sévérité de mon père…
– Je lis les nouvelles, lui répondis-je sans honte (un autre trait de mon caractère : l’insolence naturelle, qui me fait trouver normal de faire ce que je fais).
Il se prit à rire, appela ma mère et mes frères à témoin et, puisque j’avais la sottise de prétendre lire, il m’ordonna de lire à haute voix un article qu’il m’indiqua. Je le fis sans presque hésiter. Tout le monde était bouche bée. Mon père me demanda sévèrement de lui dire de quoi parlait ce que je venais de lire. J’obtempérai avec succès. Alors ma mère me prit dans ses bras avec effusion, mes frères poussèrent des cris de Sioux victorieux. Seul, mon père restait silencieux, craignant ce que ces capacités dangereuses, acquises par espionnage, accumuleraient de malheurs sur ma tête.
J’appris ensuite le calcul et les belles histoires de mon pays. J’étais étonné que nous ayons eu tant de héros, que nous soyons encore un peuple tellement admirable (la maîtresse était une patriote sans malices, qui aimait la France encore plus que le général de Gaulle, parce que elle, elle ne l’aurait jamais abandonnée à des politiciens braillards). Mon étonnement venait de ce que nous manquions de beaucoup de choses, alors qu’il suffisait de passer la frontière belge pour trouver dans les magasins de nos aimables voisins tout ce dont nous manquions. Était-ce parce qu’ils vivaient sous un roi ? Je comprenais encore moins pourquoi les douaniers français nous empêchaient de ramener ces produits dont nous avions besoin, nous traitant de fraudeurs et obligeant ma mère et ma grand-mère à revenir de Belgique en traversant les pâtures et les fossés pour ne pas se faire prendre. On me disait par ailleurs qu’il fallait respecter les agents de police, mais qu’il était juste, et même héroïque, de berner les douaniers, qui, pour moi, appartenaient à la même catégorie que les policiers. Ce qui me permettait de dépasser ces contradictions et de « tenir les deux bouts de la chaîne », selon la recommandation de Bossuet, c’est que ma grand-mère connaissait quelques douaniers bien braves, qui lui donnaient des conseils avisés pour éviter plus sûrement les patrouilles de leurs collègues serviles. Comme par ailleurs je lisais maintenant de nombreuses histoires de résistants, je commençais à comprendre qu’on a le droit de ne pas obéir à la loi injuste, et aussi qu’il y a des bons et des méchants, et que ces couleurs de l’âme ne dépendent pas de l’uniforme qu’on porte.
Le spécialiste…
Il y avait dans notre école un maître qui était particulièrement craint. Les autres lui confiaient les élèves dont ils ne venaient pas à bout, et lui les rendait doux comme des moutons par de sévères dérouillées. Je crus d’abord qu’il était propre à l’école libre d’avoir un tel spécialiste, mais j’appris plus tard qu’il y avait l’identique à l’école publique. J’en conclus que, école libre ou pas, les méthodes qui font régner l’ordre dans ces lieux d’études sont partout les mêmes. Pour moi, qui préférais l’étude aux sournoiseries des chenapans, je ne risquais pas d’avoir affaire à ces justiciers vigoureux, aussi trouvais-je – j’ai honte de l’avouer – leur fonction bienfaisante, et même admirable.
Un autre trait de la sauvagerie de ces temps-là, c’était les récompenses qu’on donnait aux enfants qui avaient bien travaillé. Tout était bon pour nous transformer en esclaves ! Il y avait les bons-points, de triste mémoire, mais aussi les félicitations publiques, les livres de prix, le droit de lire de grands livres illustrés de la collection Hetzel, de dessiner quand les autres suaient sur leurs exercices qu’ils n’arrivaient pas à terminer, de sortir en récréation avant les paresseux, etc. L’inventivité était incroyable, autant que pour les punitions : sermons humiliants, retenues, mises en pénitence, mots aux parents, lesquels étaient toujours d’accord avec les maîtres ! Cette complicité entre grandes personnes ne nous indignait pas, nous la trouvions normale puisqu’ils étaient du même âge, comme sur la cour de récréation nous jouions avec les gamins de notre âge. Je dis toujours les gamins, parce que, autre forme odieuse de ségrégation, les filles avaient leurs écoles – ce qui avait un avantage que je découvris un peu plus tard : nous pouvions aller attendre notre amoureuse à la sortie de son école, puisque les filles sortaient un peu plus tard, pour je n’ai jamais su quelle raison mystérieuse.
Un maître admirable…
Peut-être l’explication se trouve-t-elle dans la liberté de l’école, parce que les maîtres et les maîtresses pouvaient faire un peu ce qu’ils voulaient. Ainsi, j’ai eu un maître admirable qui consacrait les après-midi à nous apprendre la musique et le dessin, qui étaient ses passions. Je lui dois d’avoir découvert les infinis plaisirs de l’art, non pas par des cours ennuyeux, mais par la pratique. Quand il ne nous faisait pas chanter, il sortait ses cartons, ses gouaches, et se mettait à peindre, après avoir distribué le même matériel à chaque élève. Il disait : dessinez, peignez ce que vous voulez. Si vous rencontrez une difficulté, venez à mon bureau, je vous expliquerai. Je montais sur l’estrade très haute comme si j’étais monté à l’autel pour servir la messe. Pédagogue surprenant, il nous montrait les gestes efficaces, les procédés sûrs, redressait les lignes tordus, transformait les couleurs les plus laides en éclats sublimes, déchirait aussi sans pitié les feuilles irrémédiablement perdues pour les remplacer par d’autres, où il plaçait quelques points à partir desquels tout redevenait possible.
Aujourd’hui que l’école est devenue merveilleusement moderne, les enfants s’ennuient, y apprennent l’arrogance et le mépris, si ce n’est la brutalité pure ; ils en sortent parfaitement incultes et souvent illettrés, dégoûtés de toute curiosité, de toute étude, de tout savoir. Ils sont près pour les nombreuses élections où ils pourront exprimer leurs avis en élisant le plus bête, le plus ignorant, le plus semblable à ce qu’on a fait d’eux. Et jamais ils ne leur viendra à l’esprit de penser quelque chose d’original et de personnel.
Heureusement qu’il y a le progrès, quand même, n’en déplaise à ce sot de Baudelaire !
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Polar en nord
La critique d’Hilaire de Crémiers sur le dernier roman de Michel Bouvier
Michel Bouvier est un maître en littérature française – n’est-il pas professeur agrégé ? – mais le voilà qui écrit son troisième roman policier où il se révèle un maître du « polar ». Polar en Nord, puisque tout se passe dans le pays qu’il aime plus que tout et qu’il décrit si bien, dans ses paysages, ses atmosphères, ses villes, ses populations. L’intrigue ou plutôt l’enquête du flic est menée de main de maître avec cette incertitude qui sollicite la curiosité et donne l’occasion de décrire toute une société, des psychologies d’une banale et cruelle réalité ; l’intérêt rebondit d’autant mieux que l’enquête est doublée par les réflexions de la fille de la victime, une fille un peu « pommée » mais qui sent les choses. En quelque sorte une partition. L’écrivain sait en tirer parti. Car Michel Bouvier est un écrivain et il joue de son art, indéfiniment varié, avec un talent amusé et, au fond, très amusant. Un roman à lire pendant l’été.
Sous les ponts. Dans les locaux de la « Lilloise », Michel Bouvier, Editions Ravet-Anceau, 220 p., 10,50 euros