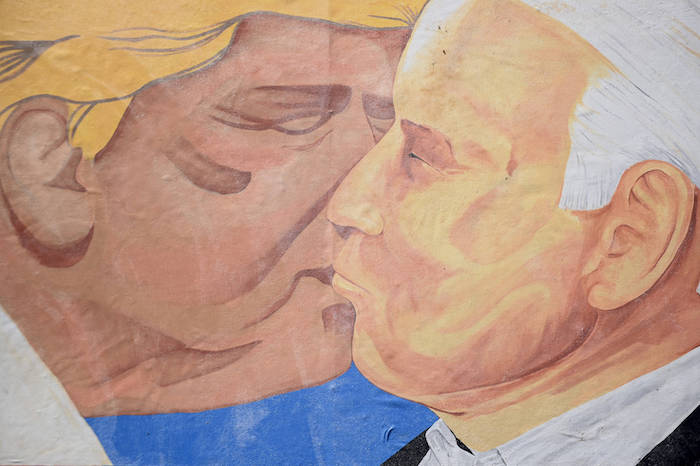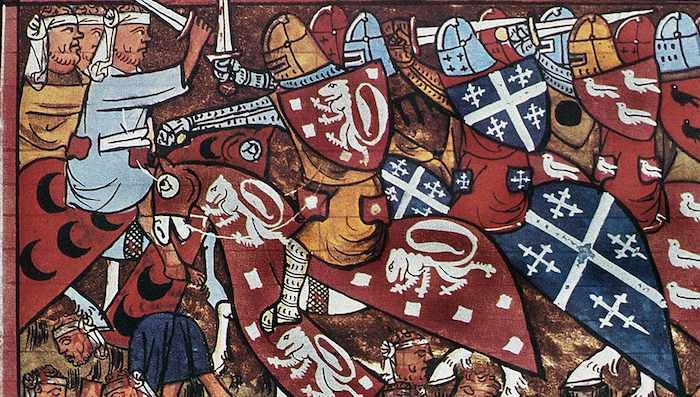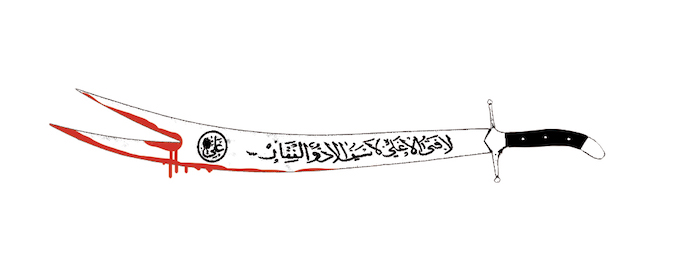Le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan et l’image des gens accrochés aux avions à l’aéroport de Kaboul vont avoir des conséquences immédiates considérables : la crédibilité des États-Unis et du président Joe Biden s’effondre ; la RFA, qui s’était engagée dans ce pays de façon importante et où on osait à nouveau poser le problème de la puissance, va retourner à son pacifisme foncier, tandis qu’une crise politique majeure se prépare à la veille des élections, qui en deviennent encore plus imprévisibles ; nos militaires (70 000 ont servi en Afghanistan entre 2001 et 2014, 90 y sont morts), qui avaient cru faire œuvre utile là-bas, malgré les difficultés, vont ressentir amèrement le poids de leurs sacrifices inutiles ; et on peut s’attendre à un nouveau flux migratoire : toutes les femmes afghanes et beaucoup d’hommes, étant donné la définition actuelle très large du droit d’asile, vont pouvoir en théorie demander à en bénéficier.
Tout cela, on le sait. Mais je voudrais souligner qu’encore le 14 août les services américains pensaient que les Talibans n’« entreraient » pas dans Kaboul avant des semaines. On décrivait les manœuvres dignes de Moltke ou de Rommel qui leur avaient permis de prendre si rapidement tant de capitales provinciales. Mais dès le 15, tout était fini, les Talibans paradaient partout avec les armes fournies par les Américains aux forces afghanes. Il me paraît clair qu’ils ne sont pas « entrés » dans Kaboul, ils y étaient, mêlés à la population, et ils sont sortis dans la rue quand ils en ont reçu l’ordre, une fois le départ américain annoncé comme imminent, et en l’absence de toute réelle résistance. Malgré la comparaison que tout le monde fait, ce n’est pas Saïgon en 1975, c’est pire : le Viêt-Cong et les forces nord-vietnamiennes avaient dû s’ouvrir le chemin, et l’armée sud-vietnamienne s’était battue. D’autre part, à première vue, les Talibans actuels paraissent plus « sophistiqués » que leurs prédécesseurs : ils risquent de poser encore plus de problèmes…
L’absence de stratégie et de prévision des gouvernements occidentaux (leur intervention se situait en partie dans le cadre de force de l’OTAN, l’ISAF) atteint des sommets et révèle la crise politique profonde de ces pays, et l’échec de leur processus de décision. Car c’est bien à une défaite occidentale, et précisément à celle de l’OTAN, que l’on assiste, à l’issue d’un engagement de vingt ans : Chinois, Russes et Pakistanais, qui avaient établi des contacts avec les Talibans, ne sont pas concernés, et leurs ambassades restent sur place. Même les Soviétiques avaient fait moins mal : leur protégé Najibullah était resté en place encore quatre ans après le retrait de leurs troupes en 1988.
Nation building, réalisme et hypocrisie
Le président Biden a justifié sa décision de maintenir le calendrier rapide de retrait des forces américaines décidé par Trump en expliquant que les États-Unis étaient allés en Afghanistan en 2001 pour remplir une mission et une seule : pourchasser Al-Qaïda et Ben Laden après les attentats du 11 septembre, et que cette mission avait été remplie. C’est évidemment faux : les forces occidentales étaient également chargées de lutter contre les Talibans (qui ne sont pas la même chose qu’Al-Qaïda), d’établir un gouvernement, un État et une armée afghans fonctionnels (« nation building »), de promouvoir les droits de l’homme et en particulier ceux des femmes, et en outre de lutter contre la production et le trafic de l’opium. Ces différentes missions étaient d’ailleurs souvent contradictoires : comment détruire les récoltes d’opium sans ruiner l’agriculture afghane et pousser les paysans dans les bras des Talibans ?
D’autre part et surtout elles ignoraient la base de la réalité socio-politique afghane : un système tribal auquel personne depuis le XIXe siècle, ni les Britanniques ni les Russes, n’a pu mettre fin. Churchill, qui avait servi dans les années 1890 à la frontière indo-afghane, notait que les Afghans admiraient beaucoup une invention britannique : le fusil à répétition Lee-Enfield, qui permettait à un fermier de liquider son voisin à plus d’un kilomètre et demi sans sortir de chez lui. Mais ils admiraient beaucoup moins le réseau routier que les Britanniques essayaient d’établir, qui devait leur permettre d’aller mater les tribus.
On soulignera ici que les États-Unis ont laissé tomber, ou même poussé au départ, le shah d’Iran en 1978, Moubarak en 2011, et qu’ils ont évacué Mogadiscio en 1993, chaque fois devant l’islamisme radical. Certes, dans les cas iranien et égyptien, ces abandons étaient justifiés aux yeux des Américains par le fait que leur ancien protégé s’écartait par trop du respect des droits de l’homme. Mais il est clair que le « nouvel ordre mondial » proclamé par le président George Bush père en 1991, à la fin de la Guerre froide, et qui correspondait en fait au projet mondial libéral poursuivi avec des hauts et des bas depuis Wilson, n’a pas réussi à englober le monde musulman. D’autant moins qu’il a évolué : entre la Charte de l’Atlantique de 1941 et le programme féministe et LGBT+ devenu avec la présidence Clinton la charte internationale de l’Amérique, il y a un monde.
Après le messianisme, le réalisme ?
Mais revenons au discours de Biden. D’une certaine façon, c’est un excellent discours, et en tout cas un constat réaliste, et il est possible qu’après la première indignation il soit retenu comme tel. Les États-Unis luttent contre le terrorisme mais n’ont pas à pratiquer la contre-insurrection et le « nation building » auprès de populations rétives. C’est un tournant après une période messianique, et un retour au réalisme de l’ère Nixon-Kissinger (lequel Kissinger vit actuellement dans les médias et l’historiographie une sorte de revival !).
En même temps, le président américain indique très clairement que la lutte contre les terroristes continuera avec tous les moyens techniques possibles, y compris les frappes à distance avec des drones, comme elles sont pratiquées couramment depuis la présidence Obama. Il est possible que cela nous réserve un jour des surprises désagréables, si des repaires de fondamentalistes s’établissent en France… D’autre part, la défense universelle des droits de l’homme se poursuivra, dit Biden, par tous les moyens économiques et juridiques. En clair, par le système de contrôle planétaire établi par Washington depuis 1945 et renforcé par un système de sanctions de plus en plus contraignantes (comme l’explique Thomas Gomart dans son excellent ouvrage, Guerres invisibles – Nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, 2021). Mais système profondément hypocrite, appliquant les sanctions largement à la tête du client, en fonction des intérêts américains de toute nature.
Les Européens en général et les Français en particulier ne disposent pas des mêmes moyens. Que devraient-ils faire dans cette période de repli occidental désormais évidente ? D’abord ne pas chercher à tout prix à répandre leurs « valeurs », qui souvent font fuir le reste de l’univers. Traiter les autres États en fonction d’abord de leur politique extérieure : considérer que leur politique intérieure n’est un problème qu’en cas de prosélytisme anti-occidental. Ne soutenir que des gouvernements viables. Reconnaître qu’il existe un « continuum de sécurité » entre la politique intérieure et la politique extérieure, et que les questions de frontières et de droit d’asile doivent être entièrement revues en fonction de ce constat : comme on doit abandonner le projet de faire régner les droits de l’homme et la démocratie libérale partout dans le monde, il faut se protéger des États faillis, perturbateurs, etc., et des groupes terroristes, mafieux, etc., en abandonnant l’irénisme qui a triomphé depuis les années 1970.
Et enfin jouer les équilibres régionaux : si l’engagement américain en Irak ne s’est pas, malgré ses difficultés, terminé aussi dramatiquement qu’en Afghanistan, c’est qu’en 2006 les tribus irakiennes sunnites ont décidé que, tout compte fait, elles avaient encore intérêt à s’entendre avec les Américains.