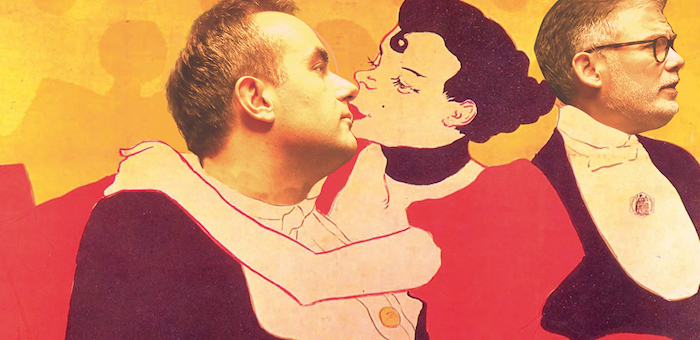Le va-t-en guerre de l’Élysée n’a plus d’autre ressource pour exister que d’agiter le spectre d’une guerre ; ce faisant, même si le risque n’en est pas exclu complètement, son but est à l’évidence de pousser toujours plus ce qui lui a tenu de fil conducteur depuis son élection, le fédéralisme européen. Mais le petit éborgneur de l’Élysée n’a jamais fait la guerre qu’à son propre peuple et, quand on prétend faire la guerre, il faut en avoir les moyens. Il se voit dans le rôle de Danton et parle de patriotisme, qu’il n’a cessé de vilipender au cours de ses mandats, mais il ne finira certes pas comme Danton, guillotiné le 5 avril 1794, le « rasoir national » n’ayant plus cours…
Quand les politiciens européens redécouvrent la politique et la diplomatie
Trump veut la paix par la force, Poutine aussi, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est comme Macron. Pour des raisons radicalement différentes, son intérêt est encore guerrier, ne serait-ce que parce que son « opposition » est plus belliciste que lui. Quant à Zelinsky, c’est sa faiblesse qui lui fait désirer la paix. On n’a jamais vu une guerre se terminer sans vainqueur ni vaincu : Lénine en avait rêvé, il subit le traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918, le gouvernement soviétique dut accepter un traité par lequel la Russie perdait l’Ukraine, ses territoires polonais et baltes, ainsi que la Finlande (l’Ukraine fut récupérée en 1919, pendant la guerre civile russe, et restera soviétique jusqu’en 1991). Macron feint de ne pas voir que l’issue est déjà jouée, l’histoire, qui est le plus souvent tragique, revient en force par la guerre, l’Ukraine en sera la première victime. L’Élysée dramatise, à la limite du ridicule, pour redorer son blason auprès des Français et renforcer le projet fédéraliste, alors même qu’il apparaît à l’évidence que le président français n’est pas partie prenante dans la négociation de paix. Cependant la peur et la mobilisation sont les instruments d’un pouvoir qui lui échappe, mais qui peuvent servir, par les budgets, à faire avaler à l’opinion plus de fédéralisme. Et celle-ci semble tomber dans le piège. Tous les médias ont encensé la fermeté du président Macron face à Poutine. Un unanimisme qui rappelle la période du Covid… Nous n’aurons donc pas les Cosaques au champ de Mars, mais les fédéralistes à Bruxelles.
Europe : l’étrange défaite ou réveil tardif ?
On peut néanmoins se féliciter de ce réveil relatif de l’Europe de la défense – mais se défendre contre qui ? On va donc mobiliser les jeunes Français pour se battre, ou faire la police d’une frontière, mais contre qui ? Et quelle frontière, alors que la France est déjà incapable de défendre les siennes ? À la frontière russo-ukrainienne, contre les soldats russes ? L’on sait que la désignation de l’ennemi est intrinsèquement liée aux buts de guerre, mais Trump, par exemple, se refuse à désigner la Russie comme tel. Il envoie des émissaires en Russie, en l’absence de tout représentant européen.
En Europe, les Pays Baltes et la Pologne, surtout, sont plus disposés à cette désignation, le pays veut pousser ses effectifs militaires de 200 000 à 500 000 soldats. Le passé de la Pologne l’y incline et l’enclave de l’oblast russe de Kaliningrad (15 125 km² pour un million d’habitants) constitue un problème au nord, tandis que l’alliée fidèle de Moscou, la Biélorussie, partage avec elle une frontière de 487 km. La géographie autant que l’histoire font de la Pologne le pays le plus armé, mais le magasin est aux États-Unis. Plus de 500 chasseurs F35 sont en cours de commande en Europe. La Pologne a décidé d’acheter 32 avions de la version F-35A, aux termes de l’accord du 31 janvier 2020 (d’une valeur de 4,6 milliards de dollars). L’Allemagne avait aussi opté pour le F-35 mais pourrait revenir sur sa commande : en effet, Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, appelle à des « mesures radicales » pour renforcer l’autonomie militaire européenne et réduire la dépendance au matériel américain. Neuf autres pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie, ont également fait ce choix. Cette homogénéisation permet une interopérabilité avec les forces de l’OTAN mais soulève aussi la question de la souveraineté industrielle et technologique de l’Europe en matière de défense. On voit combien il sera difficile de parvenir à une défense commune européenne et autonome sachant que pour qu’un de ces avions puisse décoller, il faut l’autorisation de l’oncle Sam. En effet tous les matériels sont dotés d’électronique qui nécessite des mises à jour régulières, ce sont des matériels dits « à clefs », entendez clefs électroniques, qui laissent encore la main à l’Amérique. Celle-ci prétend se retirer du financement mais pas du contrôle, une situation idéale. Le Rafale, quant à lui, dont les cadences de production sont en augmentation, bénéficie d’une indépendance industrielle totale, ce qui permettrait à l’Allemagne, si elle devait s’en équiper, d’éviter les restrictions liées aux composants américains. Quant à von der Leyen, elle joue les pères Noël. Confrontée au désengagement américain, l’Union européenne veut se réarmer avec un plan dont l’objectif affiché est de mobiliser jusqu’à 800 milliards d’euros. « Le temps des illusions est révolu », a-t-elle lancé le 10 mars, redoutable aveu ! Mais on voit mal comment une partie de ces milliards pourraient ne pas profiter au complexe militaro-industriel américain, tant l’industrie de l’armement européenne est encore indigente.
Le poids militaire de la France
Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a publié son rapport annuel sur le commerce des armes. Les États-Unis consolident leur position de leader avec 43 % des exportations mondiales, la Russie perd du terrain au profit de la France, la France s’impose comme le deuxième exportateur mondial avec 9,6 % des parts de marché. Son succès repose en grande partie sur la montée en puissance des ventes du Rafale, et l’Ukraine devient le premier importateur mondial. Washington a fourni du matériel militaire à 107 États, la part de l’Europe dans les exportations américaines atteint 35 %, dépassant pour la première fois celle du Moyen-Orient, qui se stabilise à 33 %.
Le problème de la France est qu’elle a un armement techniquement avancé mais de petite échelle. La France a du mal à produire en masse et ses délais de livraison sont trop longs. Emblématique est à cet égard le problème de LMB Aerospace. LMB Aerospace est une entreprise française de défense fondée il y a 60 ans. Elle pourrait bientôt passer sous pavillon américain. Or son cœur de métier consiste à produire des équipements pour les Rafale et les chars Leclerc (systèmes de réfrigération). Depuis plusieurs jours, au plus haut sommet de l’État, on cherche un moyen de bloquer cette transaction en posant ses conditions. « Si ces conditions ne sont pas strictement remplies, la France se réserve toutes les possibilités de veto », a déclaré le ministère des Armées. On demande à voir, ayant à l’esprit les affaires Alstom ou Technip.
Grand emprunt ?
La France en a déjà connu dans son histoire, citons en quelques-uns, ce fut l’emprunt révolutionnaire de l’An II (1793), l’emprunt forcé du 19 frimaire de l’An IV (10 décembre 1795), l’emprunt de la Défense nationale lancé en octobre 1916 et, plus récemment, l’emprunt Balladur. Celui du 19 frimaire semble avoir une postérité contemporaine. Alain Minc préconise carrément l’emprunt forcé remboursable par l’état dans cinq ans. Le chantre du Cercle de la Raison, après nous avoir fait la morale, veut aussi nous faire les poches…
On cherche aussi du côté de l’assurance-vie et de l’épargne-retraite pour financer le réarmement du pays. Selon un sondage IFOP réalisé en mars 2025, seuls 37 % des Français se disent prêts à investir dans un fonds d’épargne militaire, tandis que 45 % y sont opposés et 18 % restent indécis. L’encours de l’assurance-vie atteint 2 000 milliards d’euros, tandis que celui de l’épargne-retraite s’élève à 260 milliards d’euros. Il y a une volonté de porter le budget de la défense à 100 milliards d’euros d’ici 2030, mais l’État français est contraint de chercher des alternatives à l’endettement, eu égard à sa dette colossale.
Le budget actuel de la défense s’élève à 50,5 milliards d’euros (hors pensions militaires) et doit atteindre 100 milliards d’euros à l’horizon 2030, selon Sébastien Lecornu. Cette ambition suppose d’augmenter la part du PIB consacrée à l’armée, actuellement de 2 %, pour la porter à 3 % dans les cinq prochaines années.
Les compétences militaires de la commission européenne
Il y a donc dans cette affaire trois problèmes non résolus. Le premier : la France dispose d’atouts de haute technologie militaire mais que se passera-t-il lorsqu’il faudra envoyer des soldats ? On nous dit qu’il y a des volontaires (« Armons-nous et partez » ?) mais dans un pays où l’on nous apprend qu’un mal nouveau (?) s’est diffusé dans notre société : la flemme. Toutes les raisons que nous avions de fournir des efforts ont disparu. Les technologies se substituent à nos tâches et les États-providence ont déployé de puissants filets de protection. C’est l’objet de l’excellent livre d’Olivier Babeau, L’ère de la flemme (Buchet-Chastel, 2025).
Deuxième problème : seule la France est une puissance militaire mais alors comment partager la défense avec la Pologne, par exemple ? Ou encore avec les Britanniques qui ne sont plus dans l’Union ? Troisième problème, et non le moindre : avec ses 800 milliards, la présidente de la Commission européenne dispose-t-elle de compétences en matière de sécurité et de défense ? Hubert Védrine ne le pense pas. L’Union n’a pas d’armée européenne et ne dispose que des armées mises à disposition par les États membres (article 42-3 du Traité sur l’Union européenne) ; mais depuis 1992, avec le Traité de Maastricht, s’instaure ce qui deviendra la Politique de sécurité et de défense commune avec le Traité de Lisbonne de 2007. Cette dernière représente le volet sécurité et défense de la Politique Étrangère de Sécurité Commune (PESC) et prévoit, entre autres, la possibilité pour l’Union de faire appel aux forces militaires nationales des États membres dans le cadre des opérations de gestion de crise (article 42 du TUE). Mais « il faut penser que l’idée d’une défense européenne commune reposant sur un fonctionnement intergouvernemental est une « chimère », créature mythologique faite de l’alliance de contraires », toujours selon Védrine.
La sécurité et la défense constituent l’une des priorités définies par la Commission pour le mandat 2024-2029, priorité n’étant pas possibilité. Si l’Union dispose d’une compétence en théorie, la pratique est bien plus complexe. Les États membres doivent négocier et se mettre d’accord pour prendre une décision, et en la matière l’unanimité est requise, un des rares domaines où cette règle subsiste. Ces discussions se font au sein du Conseil européen. Dès lors, une acceptation de tous les États membres est nécessaire, ce qui peut rendre l’exercice de la compétence de la Commission considérablement laborieux et, mutatis mutandis, nous fait immanquablement penser à la Communauté européenne de défense de 1954. Pour conclure sur ce dossier particulièrement complexe, l’oligarchie européenne voit clairement dans cette guerre (ou paix) le moyen de pousser ses avantages fédéralistes par une sorte de coup d’État sournois et permanent dont l’UE est coutumière. Rappelons néanmoins que l’Europe n’existe tout simplement pas en tant qu’État.
Illustration : Les Allemands vont acheter des dizaines de F-35, dont les États-Unis peuvent inhiber à distance certaines capacités du système d’armes.