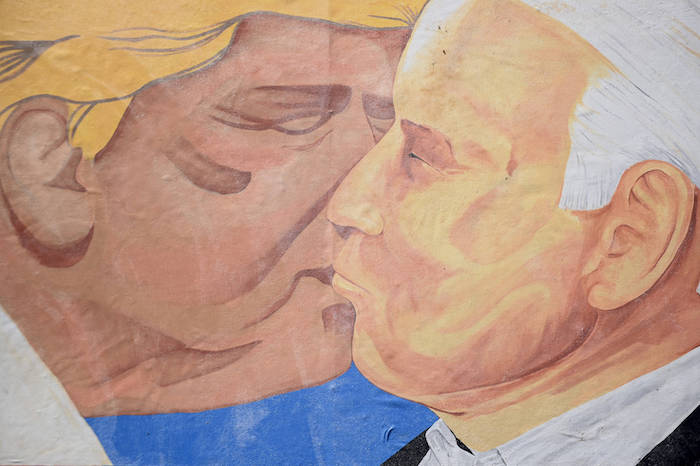On entend tellement parler de la pression des marchés financiers sur les États qu’on finit par imaginer que ces pauvres États sont tombés dans un grand piège orchestré par de méchantes banques et qu’ils s’y débattent depuis, prisonniers d’une idéologie mortifère. Et on se berce alors de grands plans de liquidation générale des dettes, au moins publiques. La réalité n’est pas plus gaie, mais assez différente.
Le joug de la finance, vraiment ?
Il y a d’abord cette idée farfelue selon laquelle avant 1973 l’État pouvait être en déficit tant qu’il voulait, la Banque de France le finançant par des avances gratuites. Il suffit pourtant d’ouvrir un livre d’histoire pour voir qu’il n’y a jamais eu d’époque magique où l’État pouvait dépenser ce qu’il voulait, la banque centrale créant sans inconvénient de la monnaie pour couvrir le déficit. Sans parler de l’époque des monnaies métalliques, qui excluaient par nature un tel mécanisme, rappelons-nous au XIXe la rente, très coûteuse (taux réel de 3 à 5 %, bien plus qu’aujourd’hui). Rappelons-nous en sens inverse le dérapage des deux guerres avec la planche à billets, qui a débouché sur des inflations démentielles. En dehors de cela, la Banque de France pouvait faire des avances de trésorerie à l’État, mais limitées, et le déficit éventuel était financé par emprunt public.
On a changé de monde en 1983 lorsqu’on a instauré en France le système de financement continu de l’État sur les marchés, imité des États-Unis. Pour les politiques, cela a été une aubaine fabuleuse, car cela permet de se financer discrètement, sans passer par le théâtre humiliant des grands emprunts type Pinay. En outre, cela réduit fortement les taux, car le marché financier est bien moins cher que l’emprunt public. Et donc le défaut du système actuel est exactement l’inverse de ce qu’en disent ses détracteurs : il donne aux irresponsables qui gouvernent depuis 40 ans la faculté de dépenser bien au-delà du raisonnable.
On dira : oui mais du coup on se met sous la coupe du marché financier, et on ne peut plus mener la politique qu’on veut. Mais en temps “normal” le marché est au contraire bonne fille ; la France a des déficits dépassant les 3 % depuis des années, contrairement à ses engagements les plus clairs, et elle paye des clopinettes en intérêts. La pression vient à tout prendre plutôt de Bruxelles, et encore.
Bien sûr, si le jeu dérape tout change. On l’a vu avec la Grèce : du jour au lendemain le marché devient méchant. Le pays ne peut plus ni financer ses déficits, ni refinancer la dette arrivant à échéance, ou à des taux prohibitifs ; il tombe sous la coupe du FMI et subit une austérité violente. Issue catastrophique donc. Moralité : si on continue à accumuler chaque année des déficits, la dette fait boule de neige, et un jour un bruit court sur le marché, qui change d’avis, et précipite la crise.
Déficit et dette, la recette du suicide
Le coupable, c’est l’endettement, et la cause de l’endettement, c’est le déficit. Si on ne veut pas dépendre de créanciers, on n’accumule pas les déficits comme nous le faisons depuis 45 ans. Or sauf drame comme les guerres ou les grandes crises, nos déficits sont injustifiés, car ils ne financent en général pas des investissements, qui génèrent un produit à terme permettant leur remboursement, mais des dépenses courantes, reportées sur les générations futures. Les dépenses courantes doivent être financées par des revenus courants, impôts et cotisations pour l’essentiel. Et si on a des déficits, c’est parce qu’on ne sait pas choisir : dépenser moins, ou augmenter les impôts. La France tout particulièrement. Ce qui est un indice sûr du dysfonctionnement politique de nos démocraties : pas de consensus, pas de courage politique, donc fuite en avant.
Si on refuse cette réalité, on se lance dans le rêve. Ainsi le financement par la banque centrale. Mais si on emprunte à la banque centrale, et qu’elle ne facture pas d’intérêt, son bénéfice est réduit d’autant et donc son dividende annuel à l’État, qui est son seul actionnaire. En outre, à masse monétaire inchangée, on réduit d’autant la capacité d’emprunt de l’économie productive. Il ne reste alors qu’une solution : la création monétaire, c’est-à-dire la planche à billets ; mais alors l’inflation, elle, est garantie, au moins à terme, une vraie inflation incontrôlée. Et donc la ruine, notamment des plus vulnérables. Sachant que la planche à billets nous est en principe fermée puisque nous ne contrôlons plus directement notre monnaie depuis l’euro.
Sortir du piège actuel
Il n’en reste pas moins que nous sommes bien dans un piège. L’endettement mondial est massivement plus élevé qu’avant la crise de 2008. Or les grands drames financiers ont tous été des crises de la dette, car s’il y a crise, une dette massive crée un effet domino, les faillites s’enchaînant.
Que faire ? Phantasmer sur les évolutions passées n’empêchera pas la dette existante d’être bien réelle, et juridiquement exigible. Si vous ne la payez pas, vous êtes en défaut. Certes on peut l’étaler dans le temps, mais cela ne change pas grand-chose, et on doit surtout fournir un effort lourd, sous le contrôle des créanciers.
Il y a ensuite la répudiation. Mais croire qu’on peut répudier sans risque notre gigantesque dette publique, désormais égale à plus de 100 % du PNB, on rêve. D’autant que les créances sur l’État ne sont pas principalement détenues par les banques, comme les gens le croient en lisant mal les statistiques, mais (outre les investisseurs étrangers) par des institutions d’épargne, SICAV et compagnies d’assurance-vie, caisses de retraite, etc. Veut-on vraiment les spolier? Bien sûr, si on est acculé, on ne peut pas faire autrement, mais c’est en général une opération violente, et à court terme très dure. Et qui dans le cas de la France déclencherait une crise financière majeure, compte tenu de la masse concernée.
Le seul moyen de réduire massivement les dettes sans créer un chaos entre débiteurs et créanciers est à nouveau de les monétiser. C’est un peu ce que font les banques centrales avec le Quantitative easing, qu’elles pratiquent depuis dix ans, qui est au fond, entre autres, un financement détourné des États par elles. Stratégie justifiée en cas de crise, mais pas en temps normal. Cela dit, reconnaissons que cela n’a pas déclenché d’inflation pour le moment, contrairement à l’objectif qu’elles recherchaient (inflation faible, à 2 %). On peut donc imaginer, en croisant les doigts, qu’il est possible de continuer à dose modérée ; cela allègera un peu les débiteurs. Mais pour vraiment éliminer les dettes, il faudrait des doses bien plus fortes : la banque centrale achèterait en masse les obligations d’État (et éventuellement d’autres), et les transformerait ensuite en créances perpétuelles à taux 0 (pour ensuite les annuler ou non, car cela ne change rien). Notons que c’est très improbable avec la Banque centrale européenne, que la France ne contrôle pas, d’autant que si certains pays européens sont très endettés, d’autres le sont peu (notamment l’Allemagne). Mais si cela se produisait, le risque est bien connu : que la création monétaire massive déclenche une hyperinflation et la fuite devant la monnaie. La même stratégie pendant les deux guerres a induit une inflation ravageuse. Peut-être y sera-t-on acculé un jour.
Mais de toute façon, ensuite, en régime de croisière, on n’échappera pas à l’assainissement des déficits publics. Et donc la démarche essentielle pour s’affranchir de la finance, c’est pas de déficit.
Illustration : Vous avez dit austérité ? Christine Lagarde, la patronne de la BCE, a mis sur la table 750 milliards d’euros dans le cadre du « programme d’achat urgence pandémique » (ou PEPP). Avec les précédentes mesures, le potentiel d’achats de la BCE est désormais de 1 trillion d’euros, soit près de 100 milliards par mois d’ici décembre.