Civilisation
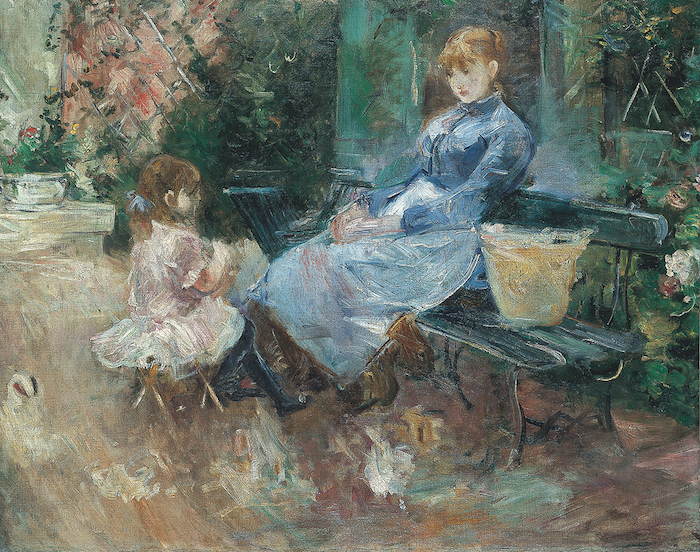
À la recherche du XVIIIe siècle
Le père de Berthe Morisot, préfet à Limoges, y créa un musée des Beaux-Arts. Une des premières œuvres données fut un ravissant portrait de Nattier.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Patrimoine. Le patrimoine français se détruit. Non seulement il est laissé à l’abandon mais, plus grave encore, il est modifié, adultéré : les exigences de l’accueil du public et d’une approche ludique (!) dénaturent les bâtiments et les espaces, quand ils ne conduisent pas à l’aberrante fabrique d’une fausse authenticité.

La première et la plus grave menace est l’état d’abandon. Par absence d’entretien, par négligence, les châteaux, églises, monastères, ponts anciens, palais, les grands bâtiments comme le petit patrimoine rural s’effritent, se fissurent, s’abîment, s’effondrent. À l’usure du patrimoine bâti s’ajoute l’enlaidissement des paysages dévorés par un urbanisme envahissant et la banlieue généralisée. Ce qui faisait la beauté de la France s’efface.
Le succès du loto patrimoine né de la mission Stéphane Bern a permis de sensibiliser nos concitoyens à cette situation dramatique. Car étrangement, ces derniers ont assez peu conscience de l’état déplorable de nos monuments historiques. Or un monument qui n’est pas entretenu est un monument qui s’abîme. Le patrimoine artistique n’est pas un organisme vivant, il ne se régénère pas. Toute usure est une disparition d’une part de son intégrité.
Certains s’exclament alors que l’État n’a pas les moyens d’entretenir tout ce patrimoine bâti. Et qu’il faut des lits d’hôpitaux. Rappelons que la part du budget de l’État destiné au Monuments Historiques est de 3 % du budget du ministère de la Culture, qui lui-même n’est que de moins de 1 % du budget de l’État. Voilà ce que nos présidents de la République et nos ministres de la Culture successifs consentent à investir dans ce qui incarne l’âme de la France, à travers son art, son histoire, ses territoires, son identité, sa fierté : 3 % de 1 %, à comparer à la part de la télévision publique : 50 % du budget de la Culture.
Il suffirait d’un arbitrage permettant au budget des Monuments historiques de passer de 3 à 4,5 % pour que la situation s’améliore notablement. D’autres solutions existent par ailleurs, parfaitement indolores. Mais nos élus se désintéressent de la beauté. La laideur progresse et nos monuments tombent en ruine, telle l’abbaye de Sénanque en péril.
Mais il y a plus absurde encore. Comme si cela ne suffisait pas, une deuxième menace pèse sur le patrimoine. Non contents de laisser s’abîmer les monuments historiques (et donc de les faire disparaître), les pouvoirs publics œuvrent à la destruction active de toute la poésie des lieux. Cette atteinte profonde à l’épaisseur même de l’émotion de l’art et de l’expérience sensible est soutenue par deux soldats qui se nomment la « mise aux normes » et « la politique des publics ». Sur le principe, qui serait contre ? Mettre l’électricité aux normes pour éviter que le monument ne flambe d’un court-circuit et offrir aux visiteurs les clés historiques du lieu qu’il visite, c’est très bien, n’est-ce pas ?
En réalité, plusieurs de nos monuments historiques, surtout parmi les plus importants et les plus beaux, sont malmenés pour les faire entrer de force dans les cases de la modernité. Tout doit être « conforme à la réglementation » (ce qui ne les empêche pas de brûler, comme le château de Lunéville en 2003). On y installe des extincteurs, des luminaires modernes, des balustrades renforcées, des rampes d’accès handicapés, des panneaux d’informations géants, polychromes et « ludiques ». C’est ne rien comprendre au charme de la pierre, de l’ardoise et de la brique, c’est ne rien comprendre à la patine du temps, à la valeur d’ancienneté. Triste reflet d’un monde qui a peur de tout, des accidents, des irrégularités, du temps qui passe. Un monde hygiéniste.
Les fondations d’entreprise ne veulent pas soutenir l’abbaye de Sénanque « par crainte, disent-elles, de réactions de leurs clients » (France Bleu, 14 février).
Le plus atroce dans ce domaine, ce sont encore les aménagements modernes, comme les pavements refaits à neuf, les pots de fleurs géants et colorés. Mais surtout, et bien pire encore, car dramatiquement pérennes, ce sont les constructions modernes plaquées sur le bâti ancien, les « nouveaux accès », les « extensions ». En témoignent l’atroce adjonction au palais des ducs de Bourgogne à Dijon (2013) ou le terrifiant nouvel accueil du public au château de Versailles (2016). Pire encore (si possible) est la nouvelle entrée du musée du moyen-âge à Paris (2018), gigantesque boursouflure étouffant les thermes gallo-romains et le délicat hôtel des abbés de Cluny. Pour ne rien dire de l’absurde projet de « parvis » devant la cathédrale de Chartres.
Quel que soit par ailleurs le jugement esthétique sur ces constructions modernes, celles-ci annihilent de toute façon l’harmonie poétique du monument. Si, dans un château, une aile datant du XVIIe siècle côtoie sans douleur une aile Renaissance, c’est que cette hybridation architecturale repose sur une même idéologie esthétique, quand bien même cela ne serait pas le même style. Or notre âge n’a plus rien à voir dans sa manière de bâtir avec les époques précédentes. Nos technologies, nos moyens mécaniques, nos matériaux synthétiques sont une rupture dont l’intensité est incomparable avec les expériences architecturales antérieures. Notre esthétique moderniste, post-Bauhaus, post-Corbusier, est sans rapport avec le monde médiéval ou classique. La culture a changé, la spiritualité qui anime les architectes est entièrement différente, les ouvriers viennent d’ailleurs, la pierre est remplacée par le Siporex. C’est une fiction que de croire que nous ne sommes qu’une strate de plus, qu’une évolution de plus. Les interventions architecturales contemporaines brisent orgueilleusement l’harmonie des lieux qu’elles investissent. Parcourant ces mêmes lieux, le visiteur est alors privé de cette projection dans une histoire profonde et lointaine, de ce charme nostalgique qui nous délivre d’un continuel présent.
Et comme si tant de violence ne suffisait pas à tuer toute poésie, les instances culturelles multiplient les « espaces de médiation », sollicitant force gadgets numériques et autres installations vidéos, pour des expériences « ludiques et immersives ». Sous prétexte que les gens seraient incultes (ce qui est vrai), il faut leur expliquer, les divertir, leur faire vivre une expérience « augmentée ». Ignorant le silence et la lecture, la « politique des publics » veut rendre « accessible » un monument qu’elle juge trop savant, trop lointain, si peu contemporain. Et pour cela, elle abolit l’essentiel : la contemplation.
Enfin, une troisième menace, plus rare mais encore plus invraisemblable, frappe les monuments historiques. Non contents de laisser se détruire le patrimoine, non contents de l’abîmer avec des adjonctions tuant toute poésie, les pouvoirs publics n’hésitent plus à violer les lois du patrimoine : désormais, on construit du faux.
Cet argent qui est si difficile à trouver pour entretenir (et, le plus souvent, sauver) l’authentique, on l’affecte à des reconstitutions illusoires, bâtissant en dur des mensonges architecturaux. Il y a chez l’homme une tentation de refaire ce qui a été détruit pour réparer les outrages de l’histoire. Or un monument détruit ne peut être « refait ». Car ce que l’on construit est un autre bâtiment. Un monument n’est pas qu’une succession de volumes, c’est une matière et une histoire.
Cette prise de conscience a mis du temps à émerger. L’idée de restaurer le patrimoine est née tardivement, au XIXe siècle, avec le développement d’une vision historiciste de l’architecture. Ce siècle qui sut goûter la poésie de l’histoire préféra l’imitation flamboyante à la ruine authentique. Eugène Viollet-le-Duc restaurait les monuments sans craindre de « refaire » dans un état qui « aurait pu » exister. Ce « refait » n’a aucune valeur d’authenticité. Le château de Pierrefonds est l’archétype de cette démarche, à mi-chemin entre le moyen-âge et Disneyland.
La situation est plus sensible encore pour la sculpture et la peinture. Si l’on peut remplacer un bloc de pierre dans une maçonnerie par un autre, si un parallélépipède rectangle peut remplacer un autre parallélépipède rectangle, la moindre œuvre figurative refaite est une interprétation stylistique qui trahit nécessairement l’œuvre d’origine. On le voit sur la cathédrale de Reims où les statues de la façade ont été terriblement abîmées au cours de la Première Guerre mondiale. On a entrepris de retirer les statues abîmées de la façade pour les remplacer par des statues toute neuves, refaites « dans le style gothique ».

Versailles : un sous-sol kitsch fait de plaques de marbre bêtement découpées, de pavement noir prétentieux, de dorures “glamour”, sous un éclairage au néon !
Il est pourtant un texte fondateur qui donne le cadre de la pratique de la restauration : c’est la Charte de Venise signée en 1964. Elle stipule que restaurer un monument historique veut dire préserver au maximum son authenticité et le stabiliser dans son intégrité présente. Cette charte fondamentale a tracé une frontière nette entre le réel (du monument comme de son histoire) et la falsification. Si un monument ou une partie d’un monument a été détruit, cette destruction aussi est un témoignage de l’histoire. C’est peut-être dramatique, mais c’est ainsi.
« Refaire » une œuvre d’art, c’est faire du faux. Ce principe a été admis par toute l’Europe des monuments historiques.
Et pourtant, sous la pression des enjeux économiques du tourisme comme des idéologues postcoloniaux estimant que la Charte de Venise est une vision trop occidentale qui ne prend pas en compte les pratiques ancestrales orientales ou africaines, le concept d’intégrité matérielle et la valeur d’ancienneté ont été contestés.
Si l’on peut admettre la singularité des temples japonais, les monuments européens ne devraient jamais en revanche s’écarter du cadre de cette Charte de Venise. Un siècle de réflexion sur le sujet de la restauration, d’Aloïs Riegl à Cesare Brandi, a permis d’accoucher d’une position déontologique claire fondée sur les valeurs d’ancienneté et d’intégrité matérielle. On sait que refaire, c’est faire du faux. Or, sans vergogne, nos ministres de la Culture, tant par ignorance des enjeux de la restauration que poussés par les exigences du tourisme et de la rentabilité, autorisent des chantiers qui contredisent frontalement la Charte de Venise.
Et ces mensonges se développent au cœur même de l’État centralisé. Le château de Versailles est le lieu emblématique de cette lamentable tendance. De plus en plus d’éléments du château et des jardins sont « refaits à l’identique » (bosquet des Trois Fontaines en 2004, grille « royale » en 2008) afin de rendre le château plus attractif aux yeux des touristes, avec un souci d’authenticité toujours moindre.
Ces funestes entreprises sont dénoncées par les spécialistes de la question, mais la présidence de Versailles l’encourage et le ministère laisse faire. Et pendant que les budgets et les équipes sont monopolisés pour faire du faux, on n’entretient pas le vrai.
La dernière folie de ce genre est la nouvelle flèche qui va bientôt être construite sur la façade de la basilique Saint-Denis. Cette future construction contrevient à toutes les règles morales d’intégrité des monuments historiques. On s’apprête à bâtir en 2019 un faux gigantesque avec la bénédiction du ministère de la Culture. Le projet prétend ainsi ne pas « reconstruire » mais « remonter » la flèche.
On préfère l’attraction touristique à la beauté sensible et fragile. On veut du clinquant. On privilégie le spectaculaire au lieu de l’authentique. On trompe le citoyen au lieu de l’éduquer. Nous sommes entrés dans l’âge du mensonge. C’est l’avènement du faux réel.