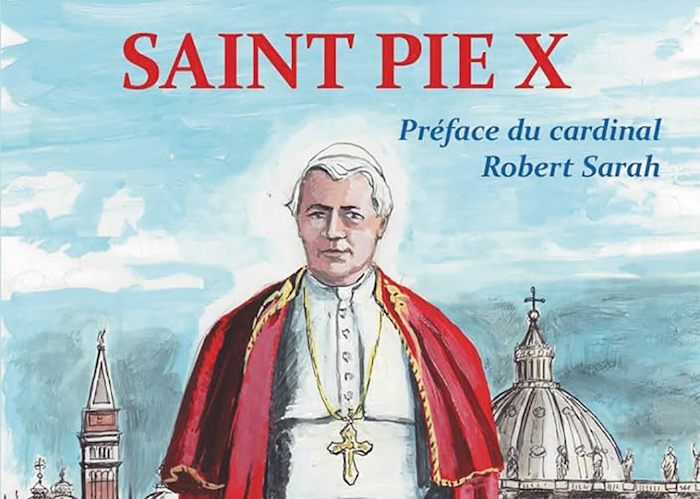«Qu’il est grand. Encore plus grand mort que vivant ». Le mot fameux de Henri III à propos du duc de Guise pourrait s’appliquer aux réactions des médias et de la population à l’annonce du décès de Jacques Chirac. L’ancien président n’a pas raté sa sortie. En vérité, ce phénomène n’a rien d’étonnant pour qui connaît l’étrange ethos politique de notre peuple. Cet ethos, depuis près de deux siècles et demi, est fait d’un fond de jacobinisme cocardier, constamment vivifié par un romantisme révolutionnaire et une prétention à guider les hommes sur le chemin de la liberté, de la justice et du progrès, conformément aux principes d’une morale universaliste dont nous serions les dépositaires. Or, cet ethos, Jacques Chirac, après de Gaulle, l’a incarné au plus haut degré. Un rückblick sur sa carrière le montre avec éclat.
Un produit de la méritocratie républicaine promis à une carrière de radical
La famille d’origine de notre homme illustre assez la « méritocratie républicaine », tant prisée des Français. Ses deux grands-pères étaient des instituteurs, des hussards noirs de la République, rationalistes, laïques et progressistes. Son père, François, simple employé à la Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie (BNCI), s’éleva à la force du poignet et accéda à la direction générale de la société Henry-Potez, puis à l’administration de la Société Nationale des Constructions aéronautiques du Nord (SNCN). Lui-même est diplômé de Sciences-Po en 1955. Il intégrera ensuite l’ENA, dont il sortira comme auditeur à la Cour des Comptes (1959), après avoir, au passage, effectué un séjour universitaire aux États-Unis, accompli son service militaire à Saumur, et fait la guerre d’Algérie. Ses origines le prédisposaient à devenir un bon républicain radical du type Herriot ou André Marie. Et, au fond, c’est ce qu’il devait être, sa vie durant, sous ses postures successives. Étudiant, il flirte avec le PCF, vend L’Humanité et signe l’appel de Stockholm (mars 1950).
L’homme qui trahit son camp
Le jeu combiné de son ambition et de son ascension le recentre. Il épouse, en 1956, Bernadette Chodron du Courcel, issue de la haute bourgeoisie parisienne. Il entre au cabinet de Georges Pompidou, alors Premier ministre, qui l’apprécie. Il intègre l’écurie de Pierre Juillet, cet homme de l’ombre, qui recrute de jeunes talents pour l’UNR. Or, Pompidou et Juillet représentent l’aile conservatrice du gaullisme, à laquelle notre héros s’est rallié par intérêt. Chirac va donc s’engager à droite, et il fera partie de ces jeunes loups juilletistes qui lutteront contre les gaullistes « sociaux » que sont les Chaban-Delmas, Capitant, Vallon et Boulin. Il devient le poulain favori de la droite gaulliste, à tel point que celle-ci songe à lui pour une candidature à l’Élysée contre Chaban-Delmas. Mais, trop jeune et trop peu connu, il doit se contenter d’être celui qui persuade nombre de gaullistes de préférer Giscard à Chaban, lors de la présidentielle de 1974, trahissant ainsi l’UDR, et lui faisant perdre l’Élysée. Chirac touchera alors « le denier de Judas », suivant l’expression de Defferre, en devenant le Premier ministre de Giscard. Cette trahison confirme son appartenance à la droite. D’autant plus que, devenu chef du gouvernement, il prend, avec véhémence, la tête du combat contre la gauche unie socialo-communiste.
Le prétendu chef de la droite
La suite le confirme dans ce rôle de chef de guerre de la droite. Il s’oppose à la ligne « libérale avancée » de Giscard, et, après son départ de Matignon, fonde son parti, le RPR, résolument enté sur des positions conservatrices et « nationales », dont l’euroscepticisme est le marqueur fort. Il apparaît comme celui qui dit carrément « non » à la gauche, refuse tout net son projet de société, et préconise la fermeté face aux mouvements sociaux, aux syndicats et aux contestations de toutes sortes, et la restauration de l’autorité et de l’ordre dans les mœurs, la société, les lycées et les universités. Il a la voix forte, le verbe haut et dur, et la carrure et l’énergie d’un chef qui mène son monde à la baguette. Et il ne ménage pas non plus la droite molle et le centre, incarnés par l’UDF. Tous ceux qui souhaitent un redressement national le préfèrent à Giscard. Beaucoup le comparent à un apprenti dictateur. Le Canard enchaîné le représente en tenue de SA, botté et coiffé d’une casquette militaire, et l’appelle « Facho Chirac ».
Mais tout cela n’est qu’apparence. Chirac n’est pas un Déat ou un Doriot (encore moins un Hitler) ; et les grimaces inquiétantes (?) de ce tribun droitier laissent bien visibles les traits bonasses et amollis du brave notable radical qu’est notre Corrézien de Paris.
Maître d’œuvre du libéralisme avancé de Giscard
Son bilan à Matignon l’atteste, d’ailleurs. « Je veux qu’on voie en moi un libéral », déclare-t-il, tout sourire, lors de son entrée en fonction, en 1974. C’est tout dire. Et, tout de go, il met en place les réformes sociales et sociétales du début du septennat de Giscard, tout particulièrement la loi Veil autorisant l’IVG (17 janvier 1975), et le décret du 29 avril 1976 autorisant le regroupement familial et ouvrant ainsi toutes grandes les vannes de l’immigration de masse. Certes, à partir du printemps 1976, il se repositionne à droite, car il constate que le libéralisme gauchisant de Giscard fait le lit de l’opposition qui progresse constamment dans les sondages et triomphe aux municipales de mars 1977, lesquelles se soldent par un véritable raz-de-marée socialo-communiste. Mais il se gardera bien de prétendre revenir sur ces « acquis », et se défendra, à l’occasion, de vouloir le faire.
Le tenant d’une droite à prétentions volontaristes et nationales
Combattant la gauche, il se démarque de la politique d’austérité de Raymond Barre, qui lui a succédé à Matignon, et prône une manière de dirigisme gaulliste à base de rigueur dans les dépenses de l’État et de relance sélective dans certains secteurs économiques. Il espère ainsi rallier ceux qui souffrent de l’austérité barriste, mais ont peur du communisme et doutent de la compétence économique de la gauche, ainsi que ceux qui réprouvent les orientations européistes et le libéralisme délétère de Giscard, vecteur de décadence. Mais, échaudé par les accusations de tendances fascistes dont l’accablent la gauche et sa presse, il refuse délibérément de devenir le leader d’une droite nationale, malgré les accents gaulliens qu’il trouve pour défendre la souveraineté nationale contre les européistes, et sa dénonciation du laxisme ambiant, qui l’amène à cette définition : « La démocratie est un régime d’autorité ».

La plus belle réussite de Jacques Chirac est sa contribution à la dignité des institutions républicaines, rapidement transformée en ferveur populaire.
En fait, Chirac, à cette époque, va suivre l’exemple de de Gaulle à la fin des années 1950. Le Rassemblement du Peuple français (RPF) du général avait échoué en grande partie en raison de ses « dérives » nationalistes et populistes ; et, à partir de 1958, l’ancien chef de la France libre avait opté pour la constitution d’un parti conservateur de notables (et non de masse) à l’imitation du parti tory britannique, balayant ainsi le soupçon d’aspiration à la dictature bonapartiste qu’on lui avait prêté.
Aussi, à un programme populiste de « troisième voie » plus ou moins avouée, Chirac va préférer un projet volontariste de rétablissement de la grandeur et de la prospérité de la France pour le bien du peuple qui, avec le retour de la croissance, grâce à une politique libérale judicieusement orientée, sortira des heures noires du chômage et retrouvera le plein emploi. Une sorte de thatchérisme ou de reaganisme à la française, incluant un volet social. C’est une telle rhétorique qu’il déploie à partir de 1981, sous l’influence de son « ami de trente ans », son mentor d’alors, Édouard Balladur. Et qu’il met en avant lors du débat télévisé qui, à la veille des législatives de 1986, l’oppose à Fabius, alors Premier ministre.
Mais, revenu à Matignon en 1986, il en fait trop : il veut tout privatiser et ne jure que par les vertus de la libre entreprise, de la « libération des énergies » et du capitalisme. Et il prétend détricoter la politique sociale de la gauche. Résultat : le mécontentement ressurgit, l’opposition se ressoude. Elle manifeste en masse lors de son essai de réforme des universités. La mort tragique de Malik Oussekine le tétanise ; il accepte avec soulagement la démission de Devaquet, son ministre de l’enseignement supérieur. Désormais, il navigue à vue et ne touche plus à rien. Et surtout pas au Code de la nationalité, qu’il avait pourtant promis de réviser dans un sens restrictif. Il y gagnerait en popularité au sein de la France profonde, mais verrait se dresser contre lui toute la jeunesse des lycées et des facs, entraînée par la FIDL, la gauche, la LICRA, le MRAP, la Ligue des Droits de l’Homme, la presse, bref tout ce qui « fait » l’opinion et les manifs. Il y renonce donc, et c’est un Chirac décérébré et dévertébré qui perd la présidentielle de 1988 face à Mitterrand.
Le président néo-gaulliste soumis au nouvel ordre européen
Il ôte alors à sa défroque libérale, et revient à sa préférence de naguère pour une droite gaulliste et populaire, à la fois patriote et sociale, équidistante du néolibéralisme mondialiste et du socialisme. Mais, enfin installé à l’Élysée, il se cassera le nez du fait de « la seule politique possible » (d’austérité) de Juppé (1995-1997), se verra imposer une longue cohabitation avec la gauche (1997-2002), laquelle ayant une fois de plus déçu tout le monde, sera exclue du second tour de la présidentielle de 2002, permettant à notre « grand Jacques » d’être réélu face à un Le Pen diabolisé.
Alors, durant les cinq années de son second mandat (2002-2007), Chirac ne cessera de jouer au héraut (et au héros) de « la France que nous aimons », celle de la République, des Droits de l’Homme, de la défense des opprimés, de l’aide au Tiers Monde. Au nom de la nation, il demandera pardon pour les rafles sous l’Occupation (le mea culpa prononcé au Vel d’Hiv en juillet 1995). Au nom du droit des peuples, il fera de l’esclandre à Jérusalem (octobre 1996). Au nom de l’indépendance de la France et de l’Europe vis-à-vis des États-Unis, il s’opposera à l’intervention militaire américaine en Irak (début 2003). Ce qui ne l’empêchera pas de se prononcer pour l’adoption du Traité constitutionnel européen, rejeté par référendum (29 mai 2005). Tout comme, durant sa cohabitation avec Jospin, il n’avait rien trouvé à redire à l’institution du PACS (novembre 1999), et avait approuvé la mise en circulation de l’euro (janvier 2002). Une politique européenne qu’il avait longtemps condamnée durant sa période 1976-1992, mais que lui avait imposée la droite giscardienne, le forçant, lors du référendum sur le traité de Maastricht (20 septembre 1992) à se prononcer en faveur du « oui » quand Séguin, Pasqua et la majorité de la base RPR prenaient parti pour le « non ».
En définitive, Chirac laisse le souvenir d’un « patriote » qui a favorisé la submersion migratoire et la dénatalité autochtone, accentué la décadence des mœurs, sacrifié la souveraineté de la France à l’Europe libérale, et a scrupuleusement observé tous les codes du politiquement correct et de la bonne conscience universelle. En cela, il est l’homme politique français typique de l’ère contemporaine. En particulier, il incarne cette malédiction qu’est l’obsession euro-libérale de la droite républicaine.