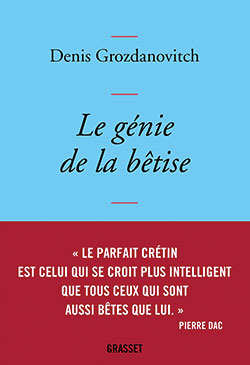Voici la rentrée littéraire : mauvais temps ! Les éditeurs déchaînent l’artillerie pour hébéter les esprits avant de les écraser sous le tapis de bombes des prix littéraires ! Vite au bunker, amis lecteurs, cette pièce blindée de livres qu’on appelle une bibliothèque. Non que toutes les publications saisonnières soient sans intérêt, mais il est du devoir de l’honnête homme de commencer par mettre son intelligence et ses goûts à l’abri de toutes campagnes commerciales. Aux phrases fabriquées en usine, opposons les propos peaufinés dans l’atelier, aux fatras des sentiments convenables, la délicatesse des émotions vraies. Il est des guides amicaux pour cela, et je m’en vais vous en proposer deux ou trois.
Charme des livres hors d’âge
Denis Grozdanovitch vient de publier Le génie de la bêtise aux éditions Grasset. C’était en décembre de l’année dernière, mais l’actualité est la première peste à éviter quand il s’agit du plaisir de lire, sans oublier toutefois qu’il est des poisons qui, habilement dosés, sont d’excellents remèdes.
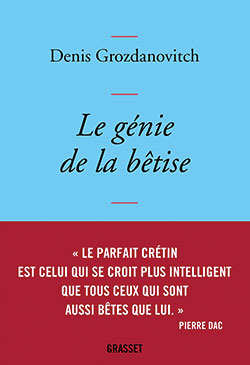
Janvier 2017, Editions Grasset, 320 p. 20 €
Le génie de la bêtise ne porte pas d’étiquette, et c’est par là qu’il se recommande. Il fait partie de ces plats étonnants, où on trouve des choses rares artistement mêlées, qui constituent le régal des fines bouches. Voilà un écrivain de bonne compagnie, qui nous invite à connaître ceux qui lui ont appris l’essentiel, à commencer par un petit garçon, Valentin, qui était un « simple » comme on disait dans les campagnes, mais qui savait vivre dans l’éblouissement. Impossible de présenter tous les êtres délicieux qu’a rencontrés Grozdanovitch, ni tous les auteurs qu’il cite, ni toutes les histoires qu’il nous raconte ; ce serait d’ailleurs idiot puisque le livre est là pour nous les offrir !
J’aime ce qu’il dit de l’amitié, qui n’est savoureuse qui si chacun reste ce qu’il est, comme l’explique Louis : « Toi t’es conditionné à l’intelligence, moi à la connerie, si tu veux qu’on reste copains et qu’on continue de se marrer ensemble, essaie pas de changer de rôles, sinon, ça va devenir mortel ! » Je crois qu’Aristote, tout admirable qu’il soit, n’a jamais rien écrit de si juste, de si profond sur les mystères de l’amitié – de l’amour aussi. J’aime plus encore ce qu’un excellent maître lui a dit des mathématiques, qui entretiennent « une alliance objective avec la barbarie montante », et de la façon dont on les enseigne en incitant « les élèves à ne pas réfléchir par eux-mêmes », afin de les préparer à accepter la tyrannie. Cela rejoint ce que disait Bernanos dans La France contre les robots, cité un peu plus loin. Mais je tombe vraiment dans l’admiration quand il nous parle de celui qui l’a initié à la lecture des grands auteurs. C’est d’une finesse, dans un style, sur un ton ! On se croirait dans quelque salon du Grand Siècle. Tout paraît superflu après des textes de cette qualité.
Un roman qui ne passera pas
Et pourtant, je vous parlerai encore d’un autre, le roman d’une femme cette fois, pour l’amour de la parité, comme dirait quelque Trissotin d’aujourd’hui…
Il s’agit de La blessure et la soif de Laurence Plazenet, paru en 2009 aux éditions Gallimard.

Ce livre est déjà ancien ? Qu’importe, puisqu’il est appelé à durer ! Et puis, « les chemins les plus merveilleux sont des détours ». J’y reviens avec le sentiment d’un devoir à accomplir, parce qu’il s’agit d’un des plus beaux livres que vous puissiez lire. Il eut en son temps un succès d’estime, trop confidentiel. Mais comment aurait-il pu en être autrement pour un texte des cimes, écrit dans une langue dont Bruno de Cessoles a dit finement que c’était du français « joué sur un Stradivarius » ?
Laurence Plazenet est nourrie du Grand Siècle. Elle nous déploie le parcours d’un noble blessé sur les barricades de la Fronde, soigné par Mme de Clermont ; M. de La Tour guérira de sa blessure pour connaître la soif de l’amour. Il fuira le désir fulgurant et impossible jusqu’en Chine, que les Jésuites tentent alors de donner au Christ. Il y rencontrera, dans les désordres d’un pays déchiré, Lu Wei, son double en amour et en soif d’absolu. Puis il reviendra mourir à Port-Royal, en odeur de sainteté. Ce résumé ne dit rien de la splendeur d’un texte, qui éclate comme la jeunesse du matin.
Un texte qu’il faut savourer mot à mot. Voici Mme de Clermont qui « va au premier office du matin », croyant que M. de La Tour est à l’agonie. « Elle prie, interroge Dieu, qui pend à sa croix et dont elle redoute, pour la première fois, les paupières closes et l’éternelle souffrance. Elle observe le corps d’ivoire où le sang perle, la face muette. Elle est entièrement abandonnée à cette contemplation, dont ne monte aucun chant, aucune supplique, bouleversée par une Passion qui n’avait jamais fait battre sa gorge comme elle fait, ce matin de juillet. […] Mme de Clermont découvre soudain ce qu’est un homme qui meurt. […] Elle souffre désormais à cause de la fragilité mauvaise, punie, humiliée, adorable, à quoi se réduit toute humanité. »
Je demande pardon pour les coupures sacrilèges que j’ai dû faire dans ce phrasé superbe, cette sourde musique de basse continue. J’espère seulement qu’elles n’empêchent pas de sentir la force de cette prose qui, une fois lue, reste dans la poitrine, comme une respiration qui exalte à jamais.
M. de La Tour ne part pas en Chine vulgairement, il « va là où il n’aura plus de nom, plus de passé, plus d’amour, plus d’espérance, où la désespérance même n’aura plus de signification. Il va là où il ne sera qu’un corps, dans sa faiblesse, sa menace permanente de faillir, incapable d’attirer à soi compassion ou pitié par les artifices du langage. Il sera son cœur. On ne sait pas ce qu’on est. On ne saurait de quoi répondre en soi, si on se tirait un instant du mensonge et de la peur d’être que l’usage couvre si bien. Il sera privé de ces artifices. »
Le livre existe en poche, mais ce serait lui rendre l’honneur qu’il mérite de le lire dans la collection blanche, où il est paru plus dignement.
Je ne voudrais pas conclure sans indiquer que la collection « Bouquins » a publié récemment un ensemble de textes de Bossuet – « le sommet de l’art littéraire » dit un maître de Grozda – aussi admirables que méconnus, en particulier les Méditations sur l’évangile et les Élévations sur les mystères. On est gâté par cette collection-là, chez Robert Laffont.
Et je vous garantis qu’aucun de ces auteurs ne recevra le Goncourt.