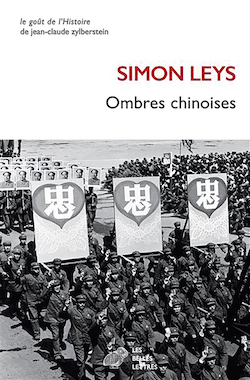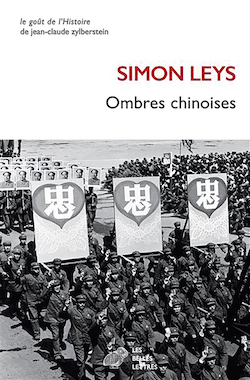On ne présente plus Simon Leys, universitaire distingué entré dans l’arène politique en 1971 avec Les Habits neufs du président Mao qui révélait la réalité du maoïsme alors triomphant chez les intellectuels de gauche.
Suivit Ombres chinoises, en 1974, réédité en 1978 avec une préface de Jean-François Revel, et à nouveau disponible grâce aux Belles Lettres. Simon Leys venait de passer six mois en Chine, il racontait ce qu’il avait vu, c’est-à-dire un immense décor – en fait réduit à très peu de lieux et très peu de Chinois – de propagande où les intellectuels étrangers circulent sans jamais questionner le pouvoir qui les cornaque (le premier chapitre, « Les étrangers en Chine populaire », est un modèle d’étonnement critique et de tristesse lucide). Mais lui parlait chinois avec les Chinois, hors circuit, lisait les journaux chinois, mangeait chinois, toutes choses inconcevables et même saugrenues aux yeux des thuriféraires du régime, prisonnier des slogans tout faits des révolutionnaires culturels. Simon Leys nous décrit la Chine de Mao, donc il nous décrit le totalitarisme. On peut bien sûr goûter l’âcre saveur de ses récits qui mêlent l’observation directe, la réflexion politique, le commentaire narquois sur la même réalité vue par les organismes du Parti ou les idiots utiles du communisme international (les quatre pages de « Petit intermède philosophique » sont d’une drôlerie achevée) : à ce titre, Ombres chinoises est une leçon d’histoire sur la manière dont n’importe quel observateur construit son objet en fonction de mille présupposés qui l’empêchent, littéralement, de le considérer objectivement (et Leys lui-même ne prétendait pas dire la vérité, juste – énorme tâche – rendre compte qu’il ne voyait pas celle que tous les autres décrivaient dans des termes identiques). Mais on peut aussi, et avec plus de profit, se promener avec lui en Chine maoïste en s’imaginant en Russie stalinienne, en Allemagne hitlérienne, voire en des lieux et des périodes plus proches où une vérité officielle tente de s’imposer et s’appuie, pour se faire, sur le grand appareil et le grand apparat des bureaucrates et des “scientifiques” (ces guillemets connotent mon sentiment sur la scientificité des sociologues, démographes et économistes qui valident les thèses gouvernementales). Dans le chapitre « Bureaucrates », Leys découvre que les cadres administratifs sont soigneusement séparés du reste de la population, bénéficient de privilèges très réels pour le seul fait qu’ils administrent et savent placer leur progéniture. Le tout est assez éclairant, surtout quand il décrit le luxe de précautions avec lequel ces privilèges se font discrets. Mais comment ne pas penser à nos propres nomenklaturas ? Le signe le plus sûr de l’actualité de Leys est sa défense du peuple chinois : un homme qui explique qu’un peuple vaut mieux que ses dirigeants est certainement plus près de la vérité qu’un sectateur expliquant que le peuple ne mérite pas son chef, et même devrait être puni d’oser penser qu’il n’est pas heureux. « John Stuart Mill a dit que la dictature rendait les hommes cyniques. Il ne se doutait pas qu’il y aurait des républiques pour les rendre muets » nous dit Simon Leys en citant Lu Hsün. Tant de républiques, en effet.
Simon Leys, Ombres chinoises. Les Belles Lettres, 2025, 360 p., 15,90 €