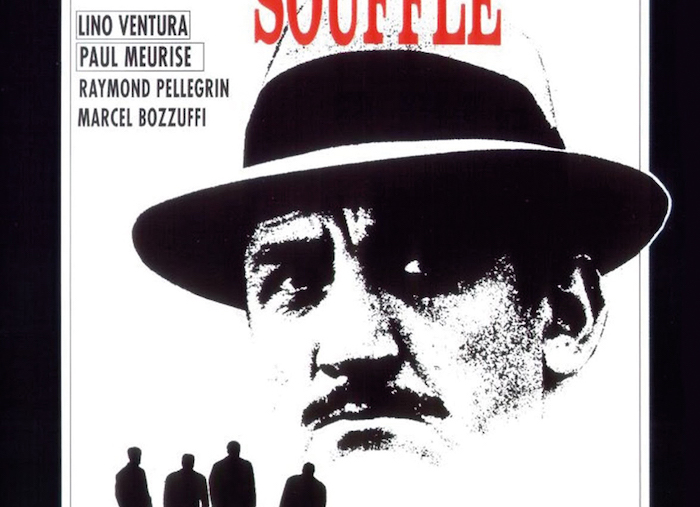Jack Lee Thompson sans doute livre avec ce film son chef-d’œuvre définitif, auquel on adjoindra, dans un tout autre genre, Les Canons de Navarone, réalisé l’année précédente.
Nous ne serons pas aussi sévère, voire impitoyable que le duo – parfois aussi peu inspirés qu’injustes, en dépit de leur fine connaissance du cinéma très difficile à prendre en défaut – Tavernier et Coursodon qui, dans 50 ans de films américains – ouvrage qui, au fil des années, s’est imposé, aux yeux de nombreux cinéphiles, dont l’auteur de ces lignes, comme un classique magistral –, éreinte proprement Thompson. Bref florilège : « œuvre spectaculaire et terne » concernant Les Canons de Navarone, film de guerre (avec Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Stanley Becker et Irène Papas, récemment disparue) ; « raté » et « ringard » à propos de Taras Bulba (1962, avec Yul Brynner et Tony Curtis) ; « western d’une crétinerie abyssale » pour qualifier L’Or de Mackenna (1969, avec Gregory Peck, Omar Sharif et Telly Savalas) ; « manque total de subtilité » s’agissant de L’Encombrant Monsieur John (1965, avec Shirley MacLaine, Peter Ustinov, Richard Crenna).
On sait que Thompson dirigera Charles Bronson de nombreuses fois – il est vrai, pour d’oubliables navets tels que Le Justicier de minuit, La Loi de Murphy ou Le justicier braque les dealers. Nos duettistes ne sont pas d’une absolue tendresse envers ce cinéaste étrillé jusqu’à plus soif qui est décrit, pour l’occasion – et avec lui son acteur fétiche –, comme « l’homme de ménage de Charles Bronson, acteur désespérant qui semble littéralement fossiliser tout ce qu’il touche ». Flèche assassine, l’un comme l’autre ne méritant pourtant pas autant d’opprobres – notamment Bronson qui s’en tire plutôt très bien dans des films comme Il était une fois dans l’Ouest, Adieu l’ami ou encore Le Passager de la pluie. Jusque-là, on restera d’une complaisante tolérance vis-à-vis des brocards vipérins assénés par nos bretteurs du 7e Art. Mais l’on ne les rejoindra nullement – et l’on s’autorisera même à se demander s’ils ont bien vu le film – dans leur critique, assez incompréhensible, de Cape Fear (titre original des Nerfs à vif). Certes, leur concèdera-t-on du bout des lèvres que Grégory Peck (interprétant Sam Bowden, l’avocat pourchassé par la vindicte obstinée et sadique d’un ancien prisonnier) incarne un personnage quelque peu effacé… surtout en face du Max Cady impeccablement campé par un Robert Mitchum au mieux de sa forme, qui nous avait déjà fortement impressionné par un rôle à peu près similaire dans La Nuit du chasseur, magnifique coup de maître de Charles Laughton.
Mais c’est peut-être un faux-semblant et, à la réflexion – c’est-à-dire lorsqu’apparaît le mot « Fin » – ne l’est-il pas tant que cela, si l’on songe qu’il sait se montrer aussi humain – sinon humaniste, ainsi qu’en attestent ses propos sur les droits de la défense – que foncièrement déterminé, froid et redoutablement calculateur, notamment lorsqu’il échafaude son plan pour prendre Cady au piège. Bref, pas de quoi convaincre Tavernier et Coursodon qui, avec une certaine condescendance estiment que « le personnage de Grégory Peck paraît très falot, défaut accentué par une mise en scène et une écriture simpliste, grossière et mécanique qui sacrifie tout (et, notamment, les personnages de femmes relégués à l’arrière-plan de manière plutôt déplaisante) au suspense le plus épidermique auquel on regrette de marcher malgré son efficacité épisodique. » Jugement rendu, selon nous, sans discernement et, comme tel, susceptible d’appel. C’est passer sous silence une mise en scène soignée, un montage sans temps morts, une lumière et une photographie admirables, une intrigue exemplaire – dont la crédibilité renforce d’ailleurs l’angoisse voire le malaise du spectateur –, sans oublier la superbe partition de Bernard Herrmann, musicien attitré d’Alfred Hitchcock sur nombre de ses films (Sueurs froides, L’Homme qui en savait trop, Psychose, etc.). C’est encore ne pas voir que ce thriller est digne des meilleurs films de Fritz Lang, par le découpage des plans et l’écriture cinématographique. En 1991, Martin Scorcese adaptera une nouvelle version de l’œuvre de Thompson, avec Robert De Niro et Nick Nolte, laquelle, en dépit de personnages psychologiquement plus complexes, péchera, malgré tout, par certaines insuffisances – monolithisme lassant de Nolte moins subtil que Peck. On l’aura compris, la version de 1962 demeure une référence que Patrick Brion juge même comme « la plus grande réussite de la carrière du cinéaste ».