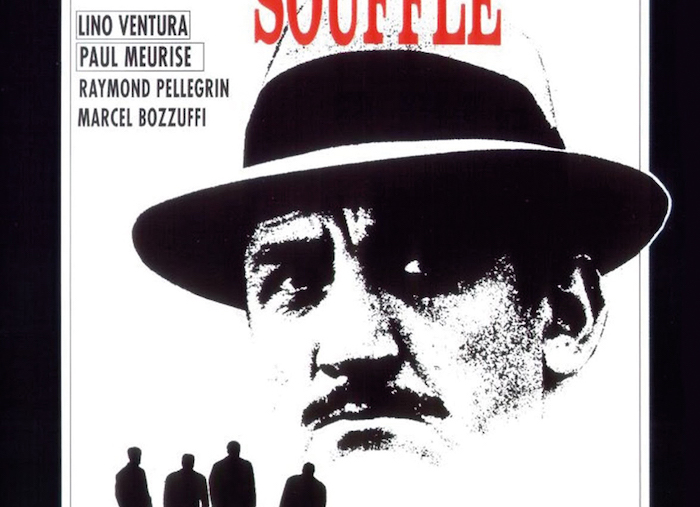Pour comprendre le cinéma américain d’une certaine époque – c’est-à-dire avant les disparitions et autres fusions-absorptions successives des grandes majors –, on ne saurait trop recommander de visionner Les Ensorcelés (The Bad And The Beautiful, 1953). Après avoir trahi un réalisateur, une actrice et un scénariste qui lui doivent, malgré tout, leurs carrières et leur succès, le producteur Jonathan Shields leur demande, en dépit de la brouille qui les oppose, de revenir à son service, le temps d’un film. Structuré en trois flash-backs, le film de Vincente Minnelli déploie un savoir-faire cinématographique qui en fait, selon nous, une véritable leçon de cinéma. L’usage des travellings, des plongées et contre-plongées, les éclairages nocturnes, les (rares) plans-séquences, les gros-plans, les fondus-enchaînés, etc., ne sont pas sans évoquer, à eux seuls, toute l’histoire de la technique cinématographique depuis David W. Griffith. Loin d’être une satire cruelle d’Hollywood, l’œuvre se présente, au contraire, comme une ode à la politique des grands studios et des producteurs – à laquelle Minnelli se pliait, d’ailleurs, sans réserve, ainsi qu’en atteste sa longévité à la MGM qui accueillit, entre autres, Madame Bovary, Le Père de la mariée, Un Américain à Paris, Brigadoon… En France, il faudra attendre François Truffaut et sa défense (audacieuse) d’Ali Baba et les Quarante voleurs de Jacques Becker, aux prestigieux – bien que parfois ennuyeux – Cahiers du Cinéma, pour voir conceptualiser ce qui apparaissait chez nous comme une évidence : un film est d’abord l’œuvre d’un auteur. Outre-Atlantique, cette « politique des auteurs » étaient à peu près inconnue – au profit d’une politique des studios et des producteurs –, sans qu’aucun réalisateur n’en ait nourri une quelconque amertume ou gêne qui ne furent, précisément, absorbées par cet écrasant système des studios. Sans nullement sacrifier la dimension tragique de l’histoire, Minnelli montre très bien qu’un film se conduit sous l’orchestration du producteur, le scénariste signant la partition, le metteur en scène se posant en soliste de l’orchestre quand les acteurs constituent le reste des instrumentistes. Les Ensorcelés – qui aurait tout aussi bien pu s’intituler Le Salaud Magnifique/Lumineux – sont une évocation à peine voilée du grand producteur David O. Selznick – encore que l’ombre de Louis B. Mayer ne se tienne guère loin –, du réalisateur Fritz Lang et de Joseph L. Mankiewicz. Kirk Douglas est parfait dans la peau d’un producteur aussi peu scrupuleux que froid et ambitieux, mais tellement habité par l’amour de l’art, qu’il finit par transgresser, à ses dépens, la ligne de démarcation qui doit séparer le producteur du réalisateur. Une leçon prudentielle que se chargera de lui rappeler le personnage du cinéaste Von Ellstein : « Un film n’est pas seulement une suite de moments forts. […] Vous voulez obtenir exactement ce que vous souhaitez ? Occupez-vous personnellement de la mise en scène. Mais la mise en scène suppose une certaine humilité. » L’histoire du cinéma a démontré que cette ligne n’était pas si infranchissable, à en juger par les personnalités ayant cumulé les deux offices, eux-mêmes conjugués à une prenante fonction d’acteur (Clint Eastwood, John Huston, Orson Welles…). En outre, la figure de Jonathan Shields/Kirk Douglas n’est pas sans offrir de discrètes similitudes avec celle de Charles Foster Kane de Citizen Kane (1941) de Welles. Le film regorge, d’ailleurs, d’autres références qui en font un des sommets du cinéma classique – ainsi, par exemple, la scène où un médiocre script de film d’épouvante est sublimé par le recours aux ombres, à des suggestions et à de savants jeux d’éclairages, se trouve être une claire allusion à La Féline de Jacques Tourneur. L’on ne manquera pas de relever les femmes du film. Lana Turner est plus qu’attachante dans le rôle d’une actrice tourmentée que Pygmalion/Schields parviendra à sortir de l’ombre tutélaire d’un père mort mais adulé ; Gloria Graham, sans doute la figure la plus tragique du film, est tout simplement rafraîchissante en ingénue ravissante et frivole, et Elaine Stewart a parfois les airs envoûtants de Rita Hayworth dans Gilda (1946).