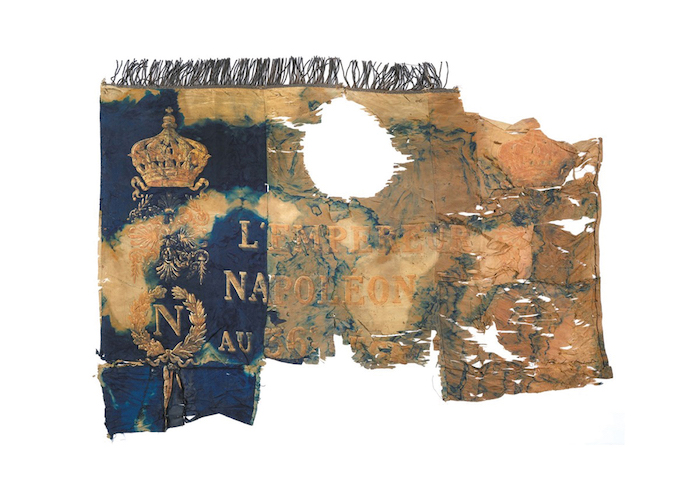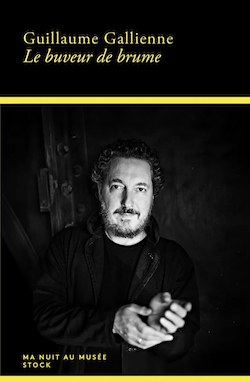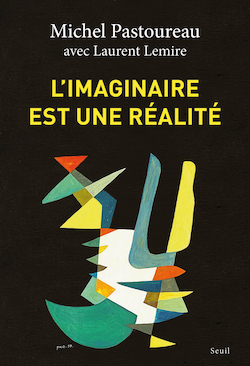Le premier a la rondeur qui donne confiance, et quand il écrit un bouquin pour nous dire que L’imaginaire est une réalité (éd. du Seuil), on peut jouer avec lui. Le second en impose d’abord, mais le regard est droit, le front, haut, les joues, honnêtes ; surtout, la moustache est sympathique. Pas de problème, on passera sans peur une nuit au musée en sa compagnie, d’autant que le titre énigmatique de son récit, Le buveur de brume (éd. Stock), nous titille la boite à rêves. Vous me direz qu’il s’agit de gens bien connus. Certes, mais peut-on faire confiance aux gens parce qu’ils sont connus ? Avez-vous confiance dans la tête de financier retors de notre président ? Pensez-vous pouvoir vous fier à la mine de Mongol fatigué de Poutine ? Vous voudriez peut-être que je vous parle de Trump, avec sa tronche de vieux clown itinérant ? Ces gens-là volent les lapins, les poules, les pommes, plus s’ils peuvent.
Michel Pastoureau a de l’estomac, les mains d’un décortiqueur de cuisses de poulet, les yeux clairs ; tout en faisant honneur aux plats de la vie, il tient des propos sans détours, originaux, surprenants, quoique évidents, qui touchent en nous une sensibilité atavique. C’est qu’il aime le monde, les grosses bêtes, et les arcs-en ciel. Il est beaucoup plus malin qu’un singe, aussi se méfie-t-il de tout ce que racontent les malins d’esbrouffe, ceux qui font des mines de dessous derrière leur fard jaune pisseux. Les savants glorieux, qui savent depuis toujours ce qu’ils proclament avec l’autorité de coqs tonitruants, Michel Pastoureau s’en est toujours méfié. D’abord parce qu’ils sont prétentieux, ensuite, et surtout, parce qu’ils pensent au cordeau, avec équerre et compas. De plus, ils jabotent de l’aplomb de leur cuistrerie comme les dindons, que leurs caroncules pourraient faire passer pour des magistrats de westerns. Michel Pastoureau est un savant amusant : il choisit ses sujets d’études en complicité avec son enfance ; voilà une garantie de vrai sérieux. La curiosité des enfants est merveilleuse, au sens propre : elle va d’instinct vers les merveilles que les grandes personnes ne voient plus depuis qu’elles se sont laissé embobeliner par les maîtres d’école. Michel Pastoureau n’a pas trop écouté ses maîtres, il a préféré continuer de contempler ses livres en couleurs, et d’abord les grands volumes qui recensent les armoiries, et puis ceux qui sont illustrés de bêtes multicolores. Et il s’est demandé pourquoi les canards y étaient jaunes, les lions, rouges, les licornes, bleues, et les ours, bruns. C’est vrai : il n’avait jamais rencontré d’animaux de ces couleurs-là, pures et fraîches comme ces idées emplies d’éclairs, qui font les aurores de la pensée ; et puisque ces bêtes colorées étaient mystérieusement plus parlantes que celles qu’on croise dans la nature, il est entré en conversation avec elles.
« Un document ou un témoignage ne dit jamais tout, et il le dit à sa façon. »
Voilà qui signale la démarche du vrai découvreur, de celui qui renouvelle notre regard, et nous apprend ainsi à apprendre. Le premier pas de la pensée qui pense, c’est de se dépayser. En se passionnant pour le latin et le moyen-âge, Michel Pastoureau a trouvé son « truc », une manière de penser autrement que ne fait la pensée rationnelle, qui est notre carcan. Et ses passions lui ont fait comprendre « que plus les outils du savoir se perfectionnent, plus la pensée recule », qu’une « langue n’est pas un code, […mais] une partie de la pensée, une forme de sensibilité, de partage, de sociabilité », bref, que notre monde scientifique a tout faux. Donc, principe de base, « un document ou un témoignage ne dit jamais tout, et il le dit à sa façon », qu’il faut comprendre en le mettant sur le dos, comme une tortue, ou un hérisson. Voilà pourquoi les malades d’information que nous sommes devenus sont nécessairement des imbéciles.
Cela donne une éthique, et une sagesse : « je veillerai à être clair », à « ne jamais prononcer ni écrire des phrases que moi-même je ne comprends pas. » Ah ! si nos experts prétendus pouvaient appliquer ces règles modestes ! Et nos hommes politiques, donc ! Michel Pastoureau n’est pas vraiment écrivain, mais il est honnête homme, en ce sens d’il y a beau temps, qui s’est dégradé depuis belle lurette. Son livre, autant qu’un régal, est une leçon beaucoup plus magistrale que toutes celles qu’on prononce dans les temples culturels. Il nous parle en ami, pour dire des choses profondes comme des puits, et on l’écoute avec un sourire grand comme ça, enchanté par cette bonne bouille épanouie d’intelligence.
Guillaume Gallienne n’est pas non plus un écrivain, mais qu’importe. Rien à voir avec le savant non plus. Ce serait plutôt un homme qui donne envie de le rencontrer la nuit dans un musée. Vous connaissez le principe de la collection « Ma nuit au musée » : on invite une vedette à passer une nuit dans un musée, et à faire un livre de cette expérience. Guillaume Gallienne a accepté, puis a tout raté, pour des tas de raisons, qu’il nous explique patiemment, avec un humour plein de colère et de gentillesses. Je résume : c’est la faute à Poutine. Guillaume Gallienne rêvait de passer la nuit dans un grand musée russe, et voilà que le camarade glacé envahit l’Ukraine. Plus question de Russie ! Et si on allait en Géorgie, où Guillaume a de la famille, et même le portait de son arrière-grand-mère au Musée national ? Va pour la Géorgie, sauf que c’est un pays à moitié occupé par les Russes, et qui a bien du mal à garder un peu de sa liberté. Pour le portrait de la grand-mère, c’est d’accord, mais pas au Musée national. On va arranger ça à la mode péri-soviétique. Du coup, le descendant princier se trouve obligé de nous donner un livre inattendu, et c’est paradoxalement ce qui fait sa réussite. Il est parvenu à tirer de sa nuit, qu’on lui a volée – vous lirez comment dans les détails – une histoire émouvante, celle de ses liens avec sa famille de l’aristocratie géorgienne, liens quelque peu brumeux, mais qu’il a bu avec d’autant plus de plaisir ; au moins, c’est mon interprétation du titre : Le buveur de brume, titre énigmatique, gorgé de sens possibles – dont celui de désigner un peuple des Andes réellement buveur d’une brume épaisse à en devenir liquide au moindre contact – et par là chargé d’une force poétique peu commune.
« Sans cadre, comment l’art pourrait-il s’exprimer ? »
Tout étant de la faute à Poutine, sorti du fond de la steppe pour jouer son Attila, le tableau du musée interdit sera transporté dans une galerie d’exposition, soigneusement gardée par trois sbires aussi froids que des glaçons pour la vodka. Il faudra que le touriste ravale sa colère atavique, et se laisse aller à découvrir des choses qu’on ne lui avait pas encore racontées. L’occasion de nous parler des artistes géorgiens, des poètes, des écrivains, de cette culture tellement riche, et dont nous ignorons presque tout. Et à travers les souvenirs de famille, c’est l’histoire de la Géorgie que nous découvrons, et c’est un peuple délicieusement accueillant que nous apprenons à aimer. Il y a les figures familiales, dans des portraits attachants, à travers des anecdotes gracieuses et surprenantes, il y a les confidences sur l’enfance difficile, l’école pénible, le métier d’acteur et les tracs, le mauvais et le bon, les difficultés de certains rôles inattendus, l’importance de Tchekhov dans une vie de théâtre, et tant d’autres choses narrées avec talent, modestie et humour. Car Guillaume Gallienne se révèle un artiste de la langue, un homme à la sensibilité vibrante, originale, qui nous apprend des choses joliment fines.
Deux en particulier m’ont frappé. Sur le sens du mot obliger d’abord, un mot rare en son emploi noble, réservé à des occasions solennelles, et qui vient du terreau de notre langue comme une plante précieuse, qu’on connaît mais qu’on remarque à peine, jusqu’au jour où il nous émeut si fortement qu’il devient un joyau de notre âme, qu’il nous fait fondre en larmes. Ce mot est « plus qu’on mot, c’est un verbe » : un verbe est plus qu’un mot parce qu’il agit, et met en action. En le lisant dans le livre de l’avocat Richard Malka, l’auteur s’est senti bouleversé : « Je ne l’avais jamais lu ainsi. Je l’ai compris à l’instant même. Il y a dans ce verbe une telle humilité, un sens magnifique de la reconnaissance, du souvenir et du devoir […] Un mot qui donne une tenue, un sens […] une direction, une route, et tout cela avec modestie… Un honneur, une fierté même, la tête haute qui s’efforce d’avancer avec humilité. » Le visage avenant de l’acteur ne nous a pas trompés : il est de bonne race.
Et puis sur l’importance du cadre. On ne peut rien comprendre des choses « sans les situer » ; « en effaçant les traces » qui les cernent, on n’a que « des faits désincarnés », dont il est impossible de connaître « la vérité ». Il en va ainsi dans l’art. « Sans cadre, comment l’art pourrait-il s’exprimer ? » C’est en le situant « dans l’espace et dans le temps » qu’on le fait vivre. Ces remarques, qui emportent loin, sourdent évidemment de ce lieu magique qu’est une scène de théâtre, où les acteurs portent des masques, non pour se dissimuler, mais, tout au contraire, pour se manifester, révéler ce qu’il porte de l’homme.
Michel Pastoureau, L’imaginaire est une réalité, Seuil, 2025, 208 p., 19,50 €.
Guillaume Gallienne, Le buveur de brume, Ma nuit au musée. Stock, 2025, 288 p., 19,90 €.