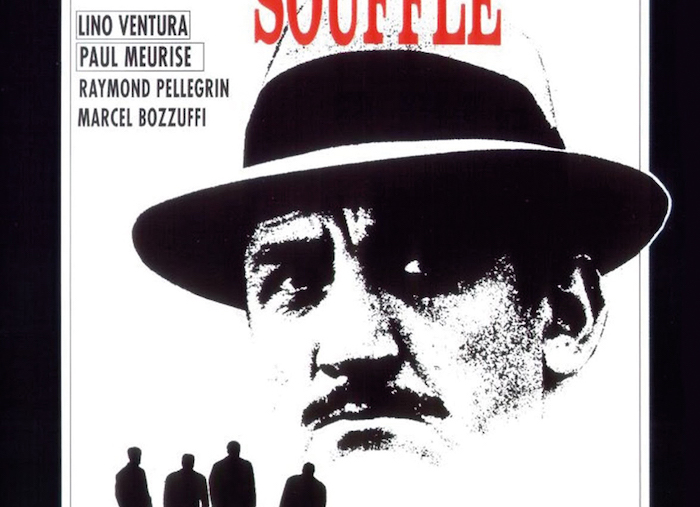Film mondialement connu pour être entré dans l’histoire du cinéma en tant que premier film parlant (« talkie »), Le Chanteur de jazz d’Alan Crosland (1927) demeure, paradoxalement, parfaitement méconnu.
Nombre de poncifs entourent d’ailleurs cette œuvre attachante dont la postérité n’a retenu qu’un titre aussi surfait que légendaire. Tout d’abord, il ne s’agit pas à proprement parler du premier film parlant ; de nombreuses expériences de synchronisation du son et de l’image avaient commencé à voir le jour dès le début des années 1920, sans que les essais fussent techniquement et commercialement concluants. En 1926, les Warner Brothers (Jack, Harry, Sam et Albert), expérimentant leur système Vitaphone (consistant à synchroniser le son d’un phonographe avec un projecteur de film), produiront Don Juan, premier long métrage sonore du même Alan Crosland avec John Barrymore dans le rôle-titre. Ce fut un échec cuisant qui endettera la major, ses innovations se révélant trop en avance par rapport au sous-équipement des salles de cinéma. Bien décidée à ne pas se laisser damer le pion par ses concurrents (notamment la Fox qui venait de mettre au point son procédé Movietone permettant d’imprimer directement le son sur la pellicule), la Warner réitère l’année suivante. Porté par Al Jolson, alors vedette de music-hall se produisant sur les scènes de Broadway, Le Chanteur de jazz enthousiasme alors le public. Cinq chansons ponctuent ce mélodrame qui concentre ses effets filmiques et visuels sur l’émotion et les sentiments – parfois outrés. C’est, en gros, l’histoire œdipienne d’un fils de rabbin désertant le domicile familial – au grand désespoir de sa mère – pour fuir les rigides traditions paternelles de la synagogue et embrasser une talentueuse carrière de chanteur à succès. D’origine russe (on relèvera que le film comporte un élément quasi autobiographique, puisque l’acteur incarnant le rôle de Jakie Rabinowitz, optera pour Jack Robin, son nouveau nom de scène), Al Jolson (1886-1950) crève l’écran avec sa prestance et sa voix claire et particulièrement mélodieuse.
Recours au grimage caricatural
Comme nous le disions plus haut, le titre ne correspond guère au sujet du film. Jolson se livrera une seule et unique – et très inachevée – prestation jazzique en interprétant au piano, devant sa mère au comble de l’admiration, « Blue Skies » d’Irving Berlin, qui deviendra un authentique standard popularisé plus tard par Benny Goodman et Ella Fitzgerald. En 1969, l’historien du cinéma et fin connaisseur du jazz Noël Simsolo écrira : « Le titre reposait sur une escroquerie dont la postérité allait s’emparer. C’est ainsi que pour beaucoup, le jazz devint ce que chantait Jolson ». On ne saurait mieux dire. Rangé dans le genre des comédies musicales, Le Chanteur de jazz pourrait aussi bien, plus de quatre-vingt-dix ans après sa sortie, être qualifié d’aimable bluette, au happy end (la réconciliation du père avec son fils) attendu et rassurant. Ce serait ignorer quelques détails significatifs. D’abord, d’une manière fort troublante, le film n’est pas sans évoquer cet archétype du cinéma de propagande nationale-socialiste que fut Le Juif Süss de Veit Harlan (1940), non pas tant dans la satire d’une société juive américaine quelque peu endogamique voire archaïque, que dans le grimage des acteurs. Ainsi, en est-il, par exemple, de la physionomie judaïque singulièrement accentuée du personnage de Moisha Yudelson campé par Otto Lederer. L’on comprend mieux, néanmoins, ce recours au grimage caricatural, lorsqu’Al Jolson se noircit le visage pour mimer les chanteurs noirs des champs de coton à l’époque de l’esclavage – une « appropriation culturelle » qui déclencherait aujourd’hui la furia des grands-prêtres du wokisme… On l’aura compris, le film vaut surtout pour son aspect documentaire – le réalisateur filmera, qui plus est, en immersion en plein cœur du quartier juif de New-York – sans oublier la magnifique tessiture de Jolson. Il faudra attendre 1929 et le superbe Hallelujah ! de King Vidor pour voir de vrais acteurs noirs figurer sur grand écran – la MGM inaugura en la matière puisqu’habituellement les films destinés à la communauté noire n’étaient tournés et distribués que par des productions indépendantes.
À noter encore la technique de surimpression particulièrement bien employée pour symboliser la présence tutélaire du père, à la fois bienveillante et moralisatrice, troublant ainsi la vision de son fils déchiré entre piété filiale et plan de carrière. On se laisse porter tant par les partitions que par une histoire simple et légère.