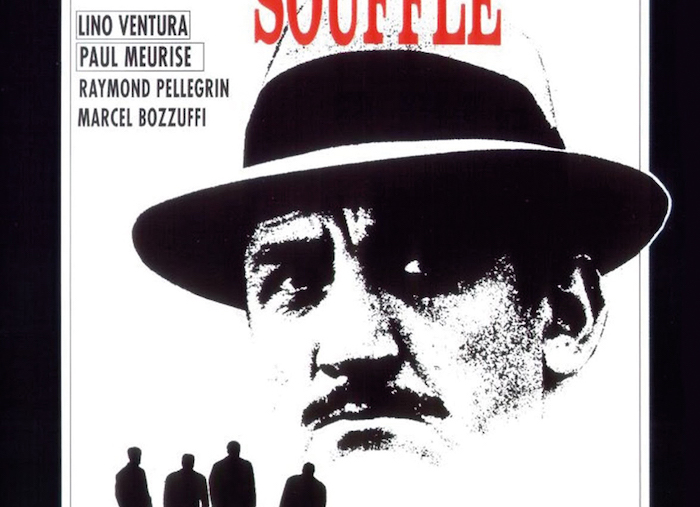Il s’appelait Sean Connery, sujet de sa Gracieuse Majesté, mais nationaliste écossais intransigeant, acteur mondialement connu et, probablement, le meilleur James Bond de toute la saga. Avec sa mort, à 90 ans, le 31 octobre dernier à Nassau aux Bahamas (lieu où Ian Fleming situe l’action de son roman Opération Tonnerre), c’est tout un mythe qui prend désormais corps, en même temps qu’une époque s’achève. Si la plupart des rétrospectives télévisuelles ont rendu principalement hommage à son incarnation du héros bondien (il en tourna pas moins de sept, en comptant son ultime, non canonique, Jamais plus jamais de Irvin Kershner en 1983), il reste que, d’une manière générale, elles ont cruellement manqué d’évoquer des films où il déployait son indéniable talent d’acteur. Que l’on pense, par exemple, au Gang/Dossier Anderson (dans lequel Connery excelle en cambrioleur borné) tourné en 1971 sous la direction de Sydney Lumet ou encore, toujours du même, The Offence (1972), film noir absolu traitant de la pédophilie, jamais distribué en France jusqu’à sa sortie en 2007 (!) et auquel Connery contribua à l’écriture, sans jamais percevoir un seul centime (du fait d’un contrat qui le liait aux producteurs Saltzman et Broccoli relatif aux Diamants sont éternels). Malgré sa violence crue, ce film mérite amplement le détour pour l’interprétation, criante de vérité, de l’acteur en inspecteur de police ivre de justice – jusqu’à la vengeance sociale –, que la vue de ces horribles crimes fait défaillir de rage. L’on pourrait également citer Pas de printemps pour Marnie, remarquable suspense psychologique réalisé en 1964 (année faste puisque Connery tournera trois films dont Goldfinger de Guy Hamilton) par Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren ou bien L’homme qui voulut être roi de John Huston (1975), splendide adaptation, avec Michael Caine, de la célèbre nouvelle de Rudyard Kipling. Mais l’on nous permettra de retenir, dans le cadre de cette chronique, La Colline des hommes perdus (The Hill), toujours du même Sydney Lumet (avec lequel Sean Connery tourna également Le Crime de l’Orient-Express en 1974). Sidney Lumet (1924-2011) fait partie de ces cinéastes mal-aimés de la critique cinématographique française. Dans leur incontournable somme consacrée à 50 ans de cinéma américain, Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon écrivent : « Il ne mérite pas la sévérité excessive dont la critique française a fait preuve presque constamment à son encontre depuis son deuxième film [Les Feux du théâtre, 1958, NDLR]. En effet, de demi-réussites sans éclats en ratages sympathiques, Lumet a fini par construire une œuvre personnelle assez chaotique et souvent discutable mais qui a le courage de prendre des risques et de ne pas tourner le dos aux difficultés ». Tout est dit et bien dit et peut, aisément, être appliqué à The Hill qui n’est, par surcroît ni une « demi-réussite sans éclat », ni moins encore un « ratage sympathique », puisque ce film se hisse sans peine au rang des incontestables réussites du metteur en scène. Satire pamphlétaire de l’univers concentrationnaire des camps de discipline militaires, il n’est pas sans faire penser, mutatis mutandis, aux Sentiers de la gloire (Stanley Kubrick, 1967) dans la dénonciation d’un système militaire oscillant entre entêtement criminel (dans le film de Kubrick) et veulerie et sadisme comme dans le film de Lumet. Sean Connery, qui tente de se défaire des habits de 007, est superbement juste en officier rebelle qui cultive l’habitude de suspendre son respect des ordres hiérarchiques à l’exercice d’un sens critique d’autant plus nécessaire qu’il peut s’avérer précieusement économe en vies humaines. Réalisé en Espagne, dans la plaine d’Almeria, sous un soleil de plomb, le film est d’autant plus réussi que le réalisateur a l’idée d’adapter ses focales au fur et à mesure de l’avancée du film, renforçant ainsi tant son intensité dramatique que les caractères des personnages, alternant grandes profondeurs de champ et longues focales (gros plans). Le tortionnaire est d’un sadisme haïssable tandis que les victimes suscitent une empathie réelle. Le décor, que ce soit l’enceinte de la caserne (au milieu de laquelle trône une artificielle colline pyramidale que doivent gravir sans but les soldats récalcitrants) ou les cellules exiguës dans lesquelles s’entassent les prisonniers, fait habilement ressortir la sensation oppressante d’enfermement qui prend à la gorge dès les premières minutes du film.