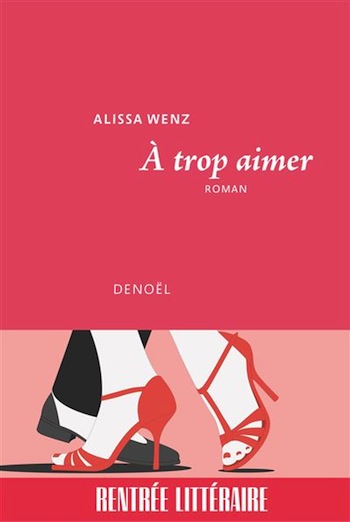Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
En chrétienté, un homme est indifféremment un homme ou une femme, puisque Dieu a créé l’homme « homme et femme ». Aussi, quand Bernard Leconte publie La galerie des femmes (éd. de L’Harmattan), c’est aussi une galerie d’hommes qu’il nous propose. Parce qu’on a beau vouloir distinguer l’homme de la femme, c’est en les réunissant qu’on les observe le mieux.
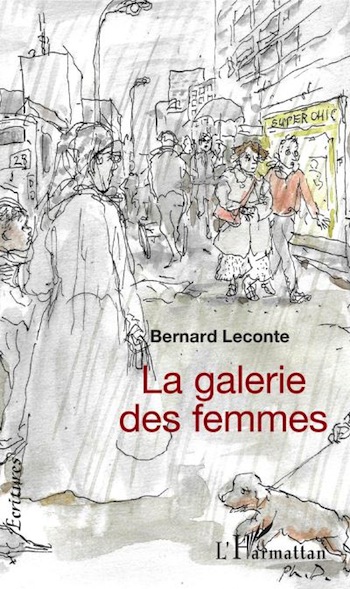
Comme dans une galerie de peintures, il y a plusieurs tableaux dans ce recueil de nouvelles ; les uns sont des miniatures, les autres des compositions de grand format, parfois en plusieurs panneaux. Un homme se fait séduire par une femme, et c’est La femme de 50 ans, qui n’a rien de balzacien. Je dis qu’il se fait séduire, et c’est vrai, mais il ne se laisse pas faire ; il observe, il garde ses distances, et on l’aide à les garder en le tenant avec des pincettes, ajoutant quelques mépris bien cuisants. On comprend que l’essentiel est le portrait de cette femme active et dominatrice, qui ne réussit que pour mieux sentir son échec secret. Cependant, le portrait de celui qui l’observe et nous raconte l’affaire est tout aussi intéressant ; son coup d’œil le révèle, quoiqu’il n’en soit fait aucune peinture. On le connaît expérimenté, un peu roublard, très sensible, mais qui le sait, et se méfie donc. Bref, un double portrait original, subtil, finaud, construit « en double aveugle », comme disent les savants.
J’ai commencé par là pour faire sentir que l’auteur n’a nulle intention satirique, nulle visée cruelle. C’est un moraliste à la façon de La Bruyère, mais en plus rigolo, avec le regard qui frise dans l’étonnement devant ce qui lui arrive – car c’est lui qui raconte, on ne s’y laisse pas prendre – aussi bien que devant ce qui arrive à cette femme tellement séduisante, et dont la vie n’est qu’un rôle parfaitement maîtrisé, jusqu’à ce qu’il l’ennuie mortellement. Cette nouvelle est ample, longue, complexe. Une autre est en diptyque, plus ramassée, construite sur le portrait de deux hommes opposés : un brave homme de beau-père, et un abominable manipulateur, qui se joue d’un enfant à la nature maladive et troublée, et de sa mère dépassée. Là, c’est la femme qui se laisse deviner en filigrane, fragile, inquiète, et dont on sent qu’elle aurait bien besoin d’un homme solide et clairvoyant pour l’éclairer ; hélas, elle ne croisera qu’un gamin ambigu, plutôt vantard, incapable de jouer l’homme en tous cas.
Et puis une nouvelle brève, Une soirée chez les Mareuil, qui a le fil tranchant du rasoir. Un chef-d’œuvre de cinq pages. Bernard Leconte, qui a le génie des choses ramassées, du fer battu jusqu’à la lame de scalpel, nous donne là un beau morceau de littérature française. Dur, féroce, intense, original, vigoureusement humain. Un morceau à savourer comme une vieille liqueur, dans un verre rond, les yeux sur les flammes dans la cheminée. Dehors, le vent, la pluie, mais on s’en fiche. On est tellement bien ici !
Bernard Leconte écrit aussi un beau texte sur les amours poétiques de Ronsard pour la jeune Hélène de Surgères. Il se trouve à l’aise en plein XVIe siècle, mais sans vouloir nous trop dépayser. Ce qui l’intéresse, c’est le vieux poète qui se prend au jeu proposé par la reine : écrire des poèmes d’amour à une de ses filles d’honneur. Hélène est sotte, d’une sottise ingénue. Qu’est-ce qui émeut un vieil homme dans une toute jeune fille, dont il sent tous les ridicules ? La fraîcheur de la vie qui en est à son printemps. Bernard Leconte nous le fait sentir avec une finesse amusée, attendrie.
D’autres textes ont l’embonpoint charmant que donnent les souvenirs. L’auteur se fait plaisir, il répète des formules qui le grisent, c’est un homme après tout. Mais un homme qui manie le français avec le talent des gens d’esprit de chez nous. Il en reste de cette espèce. Profitons-en, car on peut craindre que la race n’en soit menacée, et personne pour se soucier de préserver cette biodiversité-là, surtout pas nos écololos, qui ont déjà assez de travail à faire les malfaisants imbéciles en dégradant notre art de vivre, nos décors, et nos paysages.
L’inculture de ces minables a quelque chose de sidérant. C’est justement l’inculture qui est le sujet masqué d’Alissa Wenz dans À trop aimer (éd. Denoël), l’inculture amoureuse, qui fait aussi de terribles ravages. Une femme aime un homme ; elle découvre qu’il a l’âme malade ; elle croit que l’amour consiste à soigner, et elle s’abîme à le tenter, en vain bien sûr. L’amour n’est pas la vocation des médecins et des infirmiers. L’amour ne soigne pas, ne guérit rien. Quand l’infirmière prend son malade dans son lit, elle n’a aucune chance de le soulager, bien au contraire, elle aggrave son mal.
Il s’appelle Tristan, il est photographe, il a de l’humour, il est drôle. Elle tombe amoureuse, elle fonce à tombeau ouvert, elle s’enfonce. Tout est déjà perdu. D’abord, Tristan, c’est un type qui tombe amoureux de la fiancée de son roi sous l’effet d’un philtre. Une histoire qui ne peut que finir mal. Je sais, ce n’est qu’un conte, mais, en littérature, les contes sont des enseignements. Un type qui s’appelle Tristan et qui fait de ses rêves des réalités provocantes, ça devrait mettre la puce à l’oreille. Bien sûr, il est tellement ceci, tellement cela, et comme elle est aussi artiste, qu’elle chante ses propres compositions, elle est taillée pour comprendre son talent. Oui, mais il dit parfois des choses étranges, comme l’idée qu’il pourrait avoir de l’emprise sur une fille qui lui serait utile. Elle l’entend, cette formule trouble, mais ne s’en étonne pas. C’est ça, l’inculture : ne pas comprendre ce qu’on entend, ne pas voir le sens de ce qu’on lit. C’est pourquoi il est capital d’apprendre jeune à commenter les grands auteurs, pour apprendre ce que les mots portent de puissance, de sens maléfique ou de vertu salvatrice. Les mêmes mots. Heureusement, elle est attentive aux mots, puisqu’elle écrit ; plus tard elle comprendra, et ce mot entendu autrefois, remémoré la sauvera. Mais que de souffrances pour n’avoir pas su le comprendre au début de l’histoire ! Les mots sont dangereux, même les plus beaux. Tristan lui demande maladivement de lui dire qu’elle l’aime, et elle le lui dit. Comment refuser cela ? Mais quand une fille honnête et tendre dit « je t’aime », elle s’empoisonne le cœur avec cette formule, elle s’oblige à aimer alors que peut-être elle ne sait pas ce que ça veut dire, aimer, aimer ce tordu-là. Et si Tristan lui demande et redemande de lui dire son amour, c’est qu’il sait que c’est une glue avec laquelle on prend les oiselles.
Bien sûr, Tristan a quelques excuses, et dans une scène admirable et terrible, l’auteur nous fait comprendre d’où vient son mal, de ce père monstrueux qu’il a dû endurer. Mais est-ce une raison pour qu’elle lui dise qu’elle l’aime ? Est-ce qu’aimer, c’est comprendre, avoir pitié, vouloir consoler ? Un psychiatre consulté l’enverra promener en lui disant qu’elle n’est pas la mère de cet homme. Pourquoi ne voit-elle pas immédiatement qu’il a terriblement raison ?
La conteuse se demande si on n’aurait pas programmé les femmes pour les exploiter, les condamner à n’être que des consolatrices. Possible qu’il y ait de cela, mais le fond des choses, c’est qu’on n’apprend pas à l’école que l’amour d’une femme pour un homme n’est pas de cet ordre-là. Et la prétentieuse et lamentable éducation sexuelle, qui fait croire que coucher c’est aimer, n’apprendra rien que de plus catastrophiques sottises. Nous sommes tous, les femmes comme les hommes, presque toujours abandonnés en amour, jetés dans la vie sentimentale sans enseignement ni boussole. Alors, on s’en tire mal, voire très mal, sauf chance, hasard bienheureux, feux tricolores salvateurs comme dans cette histoire. Mais de leçons utiles, si peu ! et encore moins d’apprentissage au bon usage des leçons.
Alissa Wenz sait qu’il y a les mots, car elle est un écrivain de qualité, mais un écrivain blessé. Le printemps retrouvé ne suffit pas à garantir qu’il n’y aura plus de grabuge, comme elle dit le croire à la dernière page. Aimer un homme, pour une femme, aimer une femme, pour un homme, ce n’est pas se laisser surprendre par l’émotion qui vient combler un jour creux. Cela n’est qu’une péripétie, presque toujours malheureuse. Les histoires de Bernard Leconte ne nous indiquent pas de solution, même si sa dernière nouvelle lève quand même un peu le voile. Alissa Wenz nous dit qu’il faut faire confiance à la vie. C’est encourageant pour les convalescents, ça ne sert à rien pour ceux qui vont bientôt attraper la fièvre.
La vraie leçon, c’est la culture qui la donne, la véritable culture, celle qui enseigne les finesses de la langue, les mystères troubles des hommes, leurs vices et leurs vertus, celle qui protège un peu, donne aux plus fins l’envie de chercher la sagesse. Hélas ! de cette culture du temps passé, il n’en est plus nouvelle, comme aurait pu dire Ronsard à son écervelée.