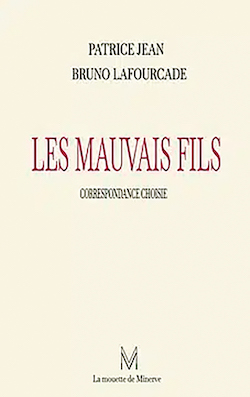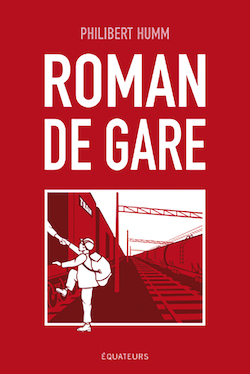Ou en pleine déconfiture ? Il est vrai que la littérature se porte mal, mais plutôt moins mal que l’homme, qui la produit, lequel chemine inéluctablement en étourdi vers la mort. La saison est mauvaise. Mais c’est justement dans ce sale temps-là que vient Noël, avec son étoile, et ses lumignons, avec son Enfançon royal, reçu dans une mangeoire comme une nourriture attendue. Fermons les volets, allumons le feu, et fêtons ces mystères, dont celui de l’écriture, de toutes ces écritures qui sont les petits de l’Écriture Sainte. « Laissez venir à moi les petits enfants. » Qu’ils viennent donc, les petits écrivains, qu’ils sortent de leurs boîtes de papier, qu’ils entonnent leurs chants de gloire.
Voici d’abord Philibert Humm, qui rêve de trains et nous le dit dans son Roman de gare (éditions des Équateurs). Philibert est un gamin débordant d’idées folles, le plus souvent venues de ses lectures par des chemins incongrus, des lectures dont il préfère ne pas toujours parler ouvertement, obéissant à son humeur folâtre plus qu’à des règles. Cette fois, il se souvient des trimardeurs américains qui ont pris des trains de marchandises pour trouver du boulot pendant la Grande Dépression, qui sont devenus les héros de toutes sortes de productions plus ou moins artistiques, et qu’on appelle par là-bas des hobos, c’est-à-dire selon l’auteur « des assoiffés d’azur, des poètes, des fous. » Évidemment, ils voyagent clandestinement, et au hasard ; s’ils peuvent monter dans un train qui part, ils n’hésitent pas : « J’irai où tu iras, [disent-ils] au train, qu’importe la place et qu’importe l’endroit. »
Le hobo voyage ordinairement avec un pote à la cervelle aussi déglinguée que la sienne ; donc, le héros, qui se fait appeler Callaghan, emmène son copain Simon, qui s’appellera Buck, pour les besoins du folklore. Simon est un type épatant, totalement largué, qui se moque de tout, sauf de bouffer. Sa présentation est un petit chef-d’œuvre dans le grand – qui en est bourré comme le croupion d’une dinde de ces petits trucs éblouissants – lequel se conclut ainsi : « En résumé, Simon est une canaille, et aussi le meilleur camarade qui soit. Jamais fatigué, jamais vaincu, il est une véritable tête brûlée et donc, le compagnon de route idéal. Je l’aime beaucoup. » La chute indique assez qu’il faut s’attendre à tout avec le gaillard qui avoue de tels amours. Ne manquons pas de remarquer à cette occasion, nous qui sommes savants, que le couple du mince et du gros remonte à la plus haute antiquité, et fait aussi par conséquent partie du folklore cinématographique américain. Ce qui permet d’affirmer que ce bouquin loufoque est truffé de références culturelles, qui en font une œuvre nourricière, capable d’orner joliment de science superfétatoire la cervelle de ceux qui le liront.
Raconter des choses de rien avec un talent fou
Si la littérature est en piteux état, le roman de Philibert Humm apporte la preuve que ça n’a aucune espèce d’importance, étant donné qu’il y aura toujours des gens impayables pour raconter des choses de rien avec un talent fou. Car cela va sans dire, mais ira beaucoup mieux en le disant, voilà un livre qui fait honneur à la librairie française, à l’édition française, et au peuple français qui est encore, pour sa meilleure part, un peuple de lecteurs malins. Les aigris, les râleurs, les hypocondriaques le trouveront méprisable, et ils auront raison car il n’est pas écrit pour eux. Le public auquel s’adresse Philibert Humm, alias Callaghan, c’est celui de Fernandel, de Tati, de Raymond Devos, et des « petites dames à leur fenêtre », que l’auteur tient « pour le premier et le dernier rempart de notre civilisation. » Bon, vous voilà prévenus : il faut que l’esprit, qui est un champagne, pétille ! Et boum, feu d’artifices !
Après ça, voilà du lourd, comme aime dire Fabrice Lucchini, qui est un faux léger : Les mauvais fils, correspondance choisie de Patrice Jean et Bruno Lafourcade (éd. La mouette de Minerve). Patrice Jean, je vous en ai dit récemment tout le bien qu’il convient pour sa Vie des spectres ; Bruno Lafourcade est moins connu du grand monde qui porte un maillot avec la frimousse de Che Guevara sérigraphiée, mais il n’en est pas moins un type qui a du mordant, greffé sur un écrivain éblouissant. Je vous en ai parlé déjà dans cette chronique (voir les numéros 201, 211 et 223 de notre cher magazine). Vous imaginez quelle fête de l’esprit peuvent être les échanges de deux têtes de ce calibre ! Bien sûr, ces deux-là rencontrent d’énormes difficultés pour exercer simplement leur métier, obéir à leur vocation d’écrivain, aussi sont-ils souvent chagrinés, jusqu’à la tristesse qui jette à terre le plus fringant cavalier. Mais justement, leurs conversations épistolaires de déprimés permettent de pénétrer en familier dans le monde ignoré de la cuisine littéraire, de comprendre en sympathie combien il peut être difficile de se faire publier, encore plus de se vendre. La plupart des lecteurs s’imaginent que la vie d’écrivain est facile, et même enrichissante en monnaie, en « caillasse » comme aime dire Bruno Lafourcade. Il est difficile d’imaginer la réalité, celle que nos deux amis qui la subissent nous font aimablement toucher du doigt.
Ainsi nous confient-ils les difficultés rencontrées pour faire respecter leur travail par des correcteurs d’édition parfois bien entêtés, de se faire comprendre de ces types farauds pour des questions de ponctuation, de mise en page, de présentation. À voir comment ils se battent pour défendre leur travail, on comprend mieux combien les bons écrivains sont des passionnés de la langue, de son utilisation correcte, et qu’ils souffrent vraiment, gravement, de voir le mépris où on tient aujourd’hui ces questions, qui sont pourtant liées aux fondements de la civilisation et, en fin de compte, à la fragile qualité humaine des primates, que nous redevenons si facilement. Pourtant, me direz-vous, les étals des libraires regorgent de livres, et on pourrait penser qu’il s’agit d’un commerce florissant. Mais inutile d’évoquer les difficultés économiques du secteur, car ce n’est pas de quoi il est question. Nos compères parlent de littérature quand vous répondez par commerce, faisant mine d’ignorer que c’est précisément le commerce qui tue la littérature.
La foule des mauvais lecteurs a fait le succès de n’importe qui
Ne nions pas l’importance de gagner raisonnablement de l’argent, mais rappelons avec insistance que la littérature n’est pas un commerce, au moins, pas un commerce comme les autres. Au Grand Siècle, les écrivains ne vivaient pas de leur productions, mais du mécénat ; leurs chefs-d’œuvre ne se vendaient pas en grande quantité, ils n’intéressaient qu’une fraction étroite de la population, dont la majeure partie était illettrée. Les écrivains ont commencé à perdre leur dignité au XVIIIe siècle, quand ils se sont pris pour des pédants lumineux ; conséquemment, ils se sont mis à lorgner vers le commerce : Diderot avec son Encyclopédie, Voltaire avec ses sales trafics ; et puis le grand chambardement est arrivé, et, au XIXe siècle, tous ont dû vivre de la vente de leur livres ; c’est alors que le journalisme, censé faire vendre, a gangréné la littérature : relisez Les Illusions perdues ; le public s’est agrandi en se détériorant : voyez les sarcasmes de Flaubert ; la foule des mauvais lecteurs a fait le succès de n’importe qui, tandis que Stendhal vendait 50 exemplaires de son chef-d’œuvre Le rouge et le noir. On devine que ça ne s’est pas amélioré depuis ; c’est de ce malheur des temps que s’entretiennent Lafourcade et Jean ; voilà pourquoi ils finissent par se fâcher contre la médiocrité des lecteurs, qui ignorent ce qui fait la qualité littéraire d’un livre. Mais s’ils ne le savent pas, c’est qu’on ne le leur a pas appris. Si on veut de nombreux et bons lecteurs, il faut une école qui forme le goût, fasse découvrir les grands écrivains et apprenne à en juger. Or, aujourd’hui, les animateurs de classe mettent le quotidien du matin sur le même plan qu’un Balzac. Conséquence, les fabricants de livres, ceux qui veulent avec rage réussir dans ce commerce, écrivent comme les journalistes, et racontent les mêmes balivernes. Quand c’est la presse populaire qu’ils prennent pour modèle, ils racontent leur vie sexuelle, présentent leurs opinions en criaillant comme des poivrots, et tiennent la plume avec des tremblotements de ramasseurs de mégots.
Où l’on voit que parler du travail d’écrivain et de la littérature, c’est se pencher sur la société et sur son évolution ; c’est aussi forcément se livrer à la satire, puisque la société qui méprise les écrivains authentiques ne peut s’attirer de leur part que des volées de coups de bâtons. Qu’est-ce donc que la littérature ? Un art, bien sûr. Ce qui suppose l’amour de la beauté, et le goût du travail bien fait. On ne peut s’y consacrer que si on a l’esprit libre, et la technique, qui s’acquiert par l’apprentissage. Or, les écrivains aujourd’hui doivent avoir un autre métier pour vivre. Aussi Jean et Lafourcade nous parlent-ils de leur métier de bouche. Lafourcade court les subventions pour faire des films sans valeur ni public. Jean tente d’instruire des gosses qui ne savent que pianoter sur des machines abrutissantes. Ce qu’ils nous disent est ahurissant. Lisez-les, vous n’en reviendrez pas.
Roman de gare, Philibert Humm, Éditions des Équateurs, 2024, 224 p., 22 €
Les Mauvais fils, Jean Patrice Jean ; Bruno Lafourcade, La mouette de Minerve, 2024, 426 p., 22,90 €