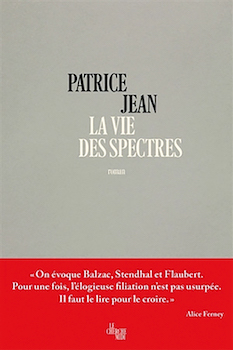Je vous propose un recueil philosophique de Jacques Dewitte, La Texture des choses (aux éditions Salvator, avec une postface de Fabrice Hadjadj), un penseur belge qui a trouvé le secret d’une philosophie sans grands mots ni jargon, ou qui en donne, quand il les emploie par exigence professionnelle, des transpositions dans le langage de tout le monde. Voilà un monsieur dont la pensée est heureuse, un chercheur joyeux qui creuse goulument les notions pour en faire jaillir à nouveau la source vive, qui nous rend la fraîcheur des choses vraies, illuminant ainsi les zones les plus grisâtres de nos paresses, de nos mauvaises habitudes. Il ne s’agit pas à proprement parler de littérature, mais quand même, puisqu’il s’agit du sens des mots, du découpage des phrases et de leur déploiement, de leur capacité à revêtir les vérités de vêtements qui nous les rendent d’un abord agréable, d’une fréquentation plaisante, qui dit aimablement la beauté du monde sensible, de ses multiples apparences – peut-être faudrait-il dire de ses apparitions, comme on parle des apparitions de Notre-Dame, car il nous enseigne que la Création est le théâtre d’apparitions incessantes, que nous négligeons par routine lassée.
Ce livre n’arbore pas un titre alléchant, mais il est ajusté à son projet par un sous-titre clair : Contre l’indifférenciation. Le premier acte du regard doit en effet consister à isoler, à différencier ce que nous allons regarder de ce qui l’entoure, afin que nous puissions apprendre de quoi il s’agit, quelle tissure en serre la trame, quel texte s’y inscrit. Ça n’a l’air de rien, ce défi lancé à la confusion, mais il en va de l’essentiel. C’est Pascal qui regarde un ciron afin d’y découvrir l’infini ; c’est le chirurgien qui isole l’organe qu’il va traiter par un champ opératoire ; c’est le bûcheron qui sort de la forêt l’arbre qu’il va mettre bas, car l’arbre ne cache pas la forêt, il est pour un homme qui agit ce qui aujourd’hui, hic et nunc, se détache de la forêt ; c’est l’amoureux qui ne voit plus que celle qu’il aime afin d’apprendre à l’apprécier, à la chérir droitement. Cela permet de dire qu’un chat est « un chat, et Rollet un fripon » ; de comprendre qu’un démocrate affirme que le pouvoir appartient au peuple non pour le lui donner mais afin de se le faire donner par un peuple aux oreilles duquel il aura braillé plus fort que les autres égosillés.
Ce bienfaiteur rend la vue aux aveugles que nous sommes
On croit qu’on fait ça naturellement, différencier. Eh bien non ! d’autant plus aujourd’hui où la technique nous oblige à ne plus voir dans la diversité du monde que notre image, que notre manière de le percevoir tel un réservoir de choses mesurables, transformables et consommables : « dans un tel monde, [… l’homme] ne rencontre plus, où qu’il aille, que sa propre image et ses propres traces. » Dans un tel monde, on ne saurait aimer rien ni personne, car il faut pour aimer découvrir un être qui apparaît et nous étonne, un être qui nous manquait. Jacques Dewitte vous explique tout cela avec une maîtrise pédagogique chaleureuse, qui conduit pas à pas à la lumière de la compréhension. Ce bienfaiteur rend la vue aux aveugles que nous sommes, chaque lecteur pouvant s’écrier enfin : « je vois ».
Avec lui, nous voyons des choses arrachées au point aveugle de nos regards, nous connaissons tout à coup en vérité où nous sommes, dans un monde réduit en bouillie par des tours de magie noire, alors que ce monde est harmonieusement organisé, que « la nature vivante n’est pas un chaos […], qu’elle est structurée et étagée », que la richesse de ses formes, qui en constitue la beauté, exprime chez tous les vivants « une tendance impérieuse […] î » par une manière propre de se faire voir, en élaborant « une structure d’apparaître », car si la science consiste à faire des distinctions, c’est que « l’activité du vivant lui-même [est de] se distinguer. » Il nous apprend que la qualité de la langue repose sur la qualité de notre attention « aux choses et aux phénomènes », qu’apprendre à bien parler notre langue ne peut venir que d’une attention aiguisée à ce que nos sens perçoivent. La leçon de choses doit précéder la leçon de grammaire. Que ce petit échantillon des trésors qu’offre ce livre vous donne l’envie de vous le procurer pour le savourer – et buvez frais !
Afin de compléter cette leçon, et de reposer l’esprit en le faisant travailler autrement, voici un roman de Patrice Jean, La vie des spectres (éd. Le cherche midi). Le héros, Jean Dulac, est un journaliste de gauche, communiste dessoûlé, qui a un fils, Simon, et une épouse, Doriane, parfaits produits de ce monde en bouillie, où se distinguer, oser paraître ce que l’on a l’honneur et le devoir d’être, constitue un crime odieux. On ne peut donc plus que se trancher en deux parts, l’une qui grimace afin de ressembler à tout le monde, l’autre qu’on refoule afin de ne jamais se distinguer, de ne jamais montrer sa distinction (car la distinction est bien le signe de la qualité propre).
Le thème central de ce roman fascinant est celui du double, mais d’un double qui se dédouble et se multiplie jusqu’à perdre toute consistance, et toute possibilité d’être connu, donc de permettre une relation véritable. D’où ce que médite le héros en marchant dans les rues de Nantes, imaginant « les doubles flottant au-dessus des passants, doubles intimes et antagonistes », et se disant : « chaque passant est accompagné de ses doubles, ces chimères que l’on construit à partir d’une somme d’anecdotes et de souvenirs, un entrelacs de symboles et de phrases perdues. C’est le double que l’on aime, le double que l’on déteste. Les doubles remplacent la personne réelle, personne mobile et incertaine qu’il faudrait des années pour connaître vraiment. […] Nous vivons dans un pêle-mêle de semi-vérités, fabriqué à la va-vite. Un monde de spectres. » Dans ce monde, les intellectuels ne pensent pas, ils récitent ; les gens cultivés pratiquent la « lecture-sommeil » ; nous vivons « l’ère du simulacre lexical, où les mots dissimulent plus qu’ils ne disent le réel. » Mais cela n’est pas grave en fin de compte, car « l’espèce humaine [n’est qu’] une grosse masse de pareils », une masse d’imbéciles interchangeables.
Une œuvre puissante qui vous éclaire et vous guide
Là-dessus, une galerie de portraits, qui ne sont que des leurres, évidemment, des caractères à la façon de Théophraste et La Bruyère, c’est-à-dire les quelques types toujours reproduits, multipliés et détruits, engagés dans des aventures qui ne sont que des péripéties incessamment répétées par des acteurs qui se croient originaux, et ne sont que des singes – des « fagotins » comme disait La Fontaine. C’est la grande pantalonnade, ou la danse macabre des anciennes nécropoles, l’éternel ronde sans queue ni tête, une farandole qui fait rire, grimacer, pleurer, dans la confusion de l’aveuglement. Patrice Jean ne cesse de vouloir comprendre, de chercher ce qui compte dans ce grand foutoir. Pourquoi ces pitreries jouées par des gens qui se prennent au sérieux ? La technique et les moyens de bourrage de crâne modernes qu’elle développe permettent de rendre la ronde plus folle, et de donner plus de tablature à celui qui voudrait sauter en bas du manège, quitte à rouler dans la boue. Pourtant, son héros trouvera de ces occasions inattendues et dérangeantes, dans des lieux propices quoique invraisemblables.
Les vieilles bâtisses abandonnées sont parfois fréquentées par des spectres d’un autre genre, des morts qui survivent dans la mémoire et les décors qui l’ont construite, et qui vous font des confidences. Les vivants vous rejettent parce que vous ne leur ressemblez plus, mais les morts vous accueillent et vous parlent avec leur sagesse d’ombres. Ceux qui ont gardé l’amour de la langue juste et des pensées honnêtement pensées, ceux-là ont des alliés dans ces âmes qu’on dit errantes. Ainsi le roman satirique devient conte fantastique, mais d’un fantastique qui est plus réel que la bouillie des discours officiels, des journaux psittacistes, des idées industrielles, plus réel parce qu’il se fait avec les éléments de la mémoire, cette mémoire illimitée dans laquelle saint Augustin rencontrait l’infini de l’Ami divin, du Dieu familier des mystiques et des saints.
N’allez donc pas croire que vous lisez seulement un roman ; vous lisez un grand roman, où les idées sont mises en scène dans des tableaux vivants, où les choses telles qu’elles sont apparaissent dans des dialogues d’une vivacité pétillante, dans lesquels ricanent des vérités désolantes, donc une œuvre puissante qui vous éclaire et vous guide, qui ne se contente pas de vous divertir, ce qu’elle fait brillamment par ailleurs, mais vous invite surtout à grandir afin de regarder de plus haut, et de voir plus loin, bref un vrai roman qui, offrant un monde à explorer, fait du lecteur un aventurier de l’intelligence. Certes, « lire exige un effort que beaucoup entendent éviter », comme le constate Jean Dulac que son patron invite à écrire de la lavasse ; je vous y exhorte cependant, puisque c’est bien la rentrée, qu’il faut donc reprendre « la pelle et les râteaux /Pour rassembler à neuf les terres inondées », afin de lutter encore et toujours contre L’ennemi.
La Texture des chose, Jacques Dewitte, Salvator, 2024, 160 p., 17,50 €
La vie des spectres, Patrice Jean, Cherche Midi, 2024, 452 p., 22,50 €