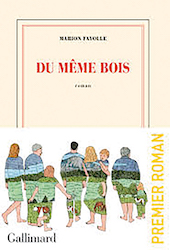Commençons par la débutante, qui fait montre d’un talent prometteur. Elle nous introduit dans une ferme d’élevage, là-haut. On ne sait où, mais on sait que c’est perdu, ancien, qu’en bas il y a une vallée, moderne. Les gens n’ont pas de nom, car ils sont interchangeables, non dans l’espace, dans le temps, qui fait que les jeunes prennent sans efforts la place des vieux. Il y a le pépé, la mémé, la mère, le père, les « petitous », la gamine, l’oncle, l’orphelin, les vaches, les poules ; on pourrait confondre, parce que parmi les vaches, il y a aussi les mères et leurs veaux, que tous ces êtres sont au fond plus que ressemblants, fraternels. C’est le thème du roman, la ressemblance avec les bêtes qu’on élève, qui n’est pas seulement une ressemblance due à la commune animalité, mais aussi une ressemblance par le cœur, les émotions essentielles de ceux qui vivent ensemble. La différence, c’est que quand une bête va mal, on lui « met un coup de fusil », ou on l’envoie à l’abattoir ; quand un homme va mal, on le garde, en le surveillant du coin de l’œil, mais en le laissant suivre son chemin bossué d’extravagances. On ne sait pas comment l’aider, alors on le laisse se soûler, ou regarder une poule faisane dans les yeux, des jours entiers, parce que le mystère de son malheur, chacun le cherche aussi dans les yeux des bêtes, de celle qu’on a choisie pour entrer en dialogue amoureux. L’amour, c’est loin de n’être que sexuel comme dans les romans sentimentaux ; l’amour, c’est une habitude qui vous organise, à l’intérieur et au-dehors. Et puis, les bêtes font ce que nous faisons : elles ont leurs crises, leurs dépressions, leurs coups de folie, ces démences imprévisibles, qui peuvent saisir la vache la plus douce, et en faire une brute dangereuse.
La nature de musée construite par l’écologie
Pour nous faire comprendre tout ça de l’intérieur, l’auteur s’est forgé un style dopé à l’empathie, un style qui entre et nous fait entrer dans l’âme des êtres qui vivent là-haut, depuis toujours et pour toujours, au moins c’est ce qu’on sent viscéralement, grâce à cette langue qui agit comme un charme, circulant dans le sang à la façon des esprits animaux de l’ancienne médecine. Ce style est sans aucun alanguissement psychologique, philosophique, politique, rien de tout ça ; c’est un style qui ne pense pas. Un style qui dit les choses sans chercher à mettre son nez où il ne faut pas. Est-ce qu’on sait ce qui se passe dans les bêtes ? Non. Est-ce qu’on sait ce qui se passe chez les autres hommes ? Pas plus. Il faut admettre qu’on ne sait rien, qu’on ne comprend pas grand chose aux êtres vivants, même à nous-mêmes, qui sommes peuplés de bêtes mystérieuses et voraces, incompréhensibles mais pourtant familières. Alors, il faut simplement attraper au vol, regarder et saisir à la façon dont l’objectif de l’appareil photographique saisit un passage, une scène, un visage. Le style doit être objectif comme un jeu de lentilles optiques, et aussi vif. Marion Fayolle a travaillé son style jusqu’à ce qu’il soit objectif dans ce sens-là. Elle ne décrit même pas, elle dit, retrouvant la parole des anciens diseurs qui allaient de village en village conter, mettre en mots ce qui avait eu lieu, quelque part, « en ce temps-là », qui est le temps de l’éternité puisqu’il est un temps sans repères calendaires, sans ces attaches de fer, qui le tueraient en le fixant.
Son écriture donne le sentiment de la plénitude de l’existence de chaque personne, totalement originale, intransposable, mystérieuse jusqu’à l’opacité, et cependant fraternelle parce qu’elle obéit aux grandes lois de la vie animale, comme nous tous en dernière analyse. Or, ce mode d’existence disparaît. Les jeunes ne veulent plus vivre comme ça, ils préfèrent descendre dans la vallée où la vie se déroule selon d’autres lois, sans contact véritable avec la nature, la nature qui est la nôtre, cette nature richement animale que nous partagions avec nos bêtes familières, mais dont nous ne voulons plus. L’écologie prétend préserver la nature, mais il s’agit d’une nature faussée par les approximations de cerveaux trop savants, les mêmes qui ont inventé les musées pour y enfermer des beautés anesthésiées, empaillées. Nous remplaçons la vraie vie par des jeux qui la miment, tentent de la reproduire selon des règles mortelles. On ne sauve pas la planète en créant des réserves ; on sauve la vie en vivant selon la nature. Puisqu’ils ne veulent plus de ça, les hommes sont devenus des gamins toujours au bord de la crise de nerfs, qui hurlent chaque fois qu’on prétend les décrasser de leurs rêvasseries de gosses mal élevés – pas élevés du tout, en vérité, puisqu’on ne veut plus se consacrer à l’élevage.
L’autre monde est celui des grands évènements négligés par la prétention qui paonne, moments-clés qu’Olivier Norek veut faire revivre, en romancier chevronné, en gars qui connaît le boulot, et qui l’abat. Il sait faire un roman qui doit séduire. Il se donne du mal pour ça. Celui qui vient de paraître lui a demandé des années de recherches, de documentation, de voyages aussi, puisqu’il a décidé de nous faire revivre la lutte de la Finlande contre l’ogre russe au début de la deuxième guerre mondiale, quand Staline eut décidé, sur une lubie de déséquilibré, d’avaler la Finlande pour contrer son comparse en horreurs, l’éructant moustachu. Bien sûr, un tel sujet fait écho à notre actualité, où l’on voit l’ours russe tenter de vassaliser l’Ukraine, qui est cependant bien plus grande que la petite Finlande. La Finlande d’alors eut son héros, Simo, surnommé « la Mort Blanche » pour ses extraordinaires prouesses de franc-tireur. Voilà qui devrait séduire les foules aussi bien que les jurys des prix de fin d’année, d’autant que l’auteur, je vous l’ai dit, est un maître artisan qui connaît son boulot.
Il suffit de le suivre dans sa mise en place de la situation de la Finlande en 1939, dans sa manière de nous faire connaître les personnages qui vont jouer leur rôle, de nous faire découvrir ce peuple finlandais que l’on connaît si mal, et qu’il révèle admirable. On pourrait croire qu’Olivier Norek est capable de se transporter dans le passé pour y faire son exploration des hommes et du monde, car il a ce talent des vrais romanciers historiques de ressusciter les temps révolus, de les rendre aussi vivants que si nous y étions en voyage nous aussi. Parmi ces hommes qui vont s’entretuer, il aime particulièrement les durs, les brutaux, les hommes qui n’obéissent qu’à leur force et à leur volonté de s’en sortir ; mais il sait dénicher en eux l’humanité enfouie, il sait aussi rendre présents les plus doux, ceux qui subissent en baissant la tête, puis les femmes dévouées qui veulent soigner les blessés, et la foule bigarrée d’un peuple habitué à la rudesse, qui connaît la loi de la vie, qui tient le coup avec héroïsme sans même se douter qu’il est héroïque.
Les hommes sont gouvernés par des déments
Olivier Norek sait composer, c’est une qualité majeure. Il sait lier des scènes détachées pour nous emprisonner dans la trame qu’il ourdit ; il sait alterner les couleurs, les tons, les décors ; il maîtrise les rythmes. Il est peintre, tantôt pittoresque, tantôt féroce, car il s’agit d’abord de peindre l’enfer, comme un Thierry Bouts, comme un Jérôme Bosch ; puis il se fait délicat comme un Monet, comme un Degas ; il lui plaît de peindre la tendresse, avec un raffinement d’aquarelliste. C’est un artiste complet, puisqu’il est aussi bien dramaturge que peintre de grotesques. Il sait faire parler ses personnages de telle façon qu’on se croirait avec eux, à les écouter. Mais pas de mélo, nous sommes obligés de nous tenir droitement avec ces gens qui jouent leur vie, leur liberté, leur terre. Les ministres, les officiers finlandais sont résignés, mais droits. Ils savent qu’ils ne peuvent que perdre cette guerre qu’on leur impose, mais il n’est jamais question de s’avilir : aucun de leurs descendants ne pourra rougir de leur épopée.
Au fil des épisodes, certains insupportables d’horreur, d’autres adoucis par l’amitié virile, quasi muette, Olivier Norek nous invite à méditer sur la guerre, l’abomination qu’est cette folie, si horriblement humaine. Il ne nous accable pas de discours, il fait parler ceux qui décident, il montre leurs gesticulations pitoyables. Il fait aussi parler ceux qu’on fait marcher. Il nous dit que les hommes sont gouvernés par des déments, qu’ils tremblent devant eux, jusqu’à ce qu’un jour, poussés à bout, ils les abattent d’un coup de baïonnette. Il nous donne de frémir, il nous hante de nos faiblesses, il nous enseigne, et il nous botte le cul, parce que ça fait partie de l’éducation. Son livre est une sacrée claque, qu’on prend en pleine poire. Mais on ne se plaint pas, tant il fait du bien. Et puis, s’il faut du cran pour le lire jusqu’au bout, on devine tout ce qu’il a fallu de courage à Olivier Norek pour l’écrire, son chef-d’œuvre. Alors, debout, on l’applaudit.
Du même bois, Marion Fayolle, Gallimard, 2024, 128 p., 16,50 €
Les guerriers de l’hiver, Olivier Norek, Michel Lafon, 2024, 448 p., 21,95 €