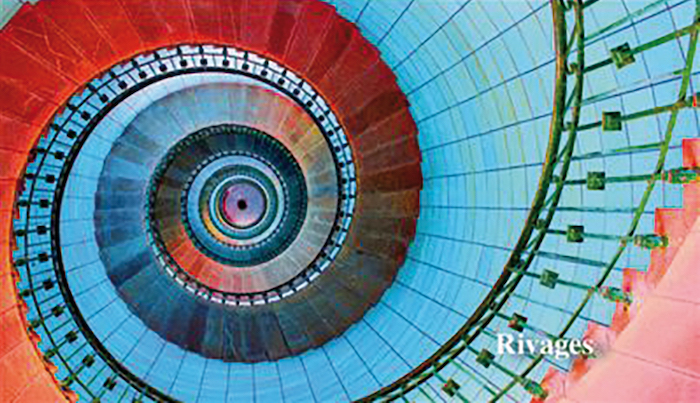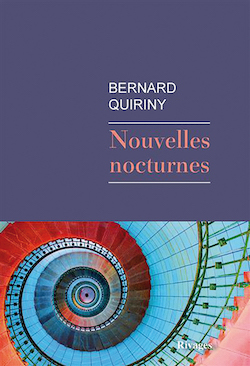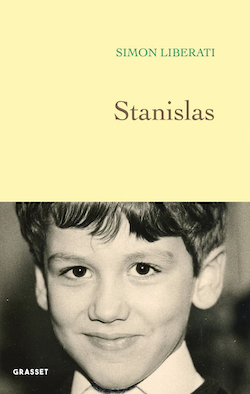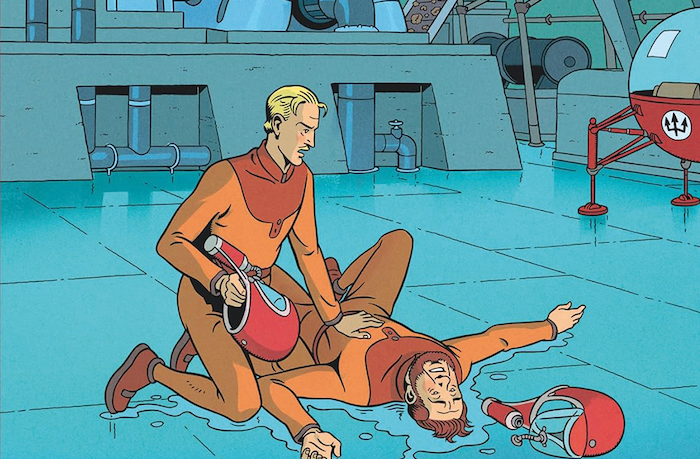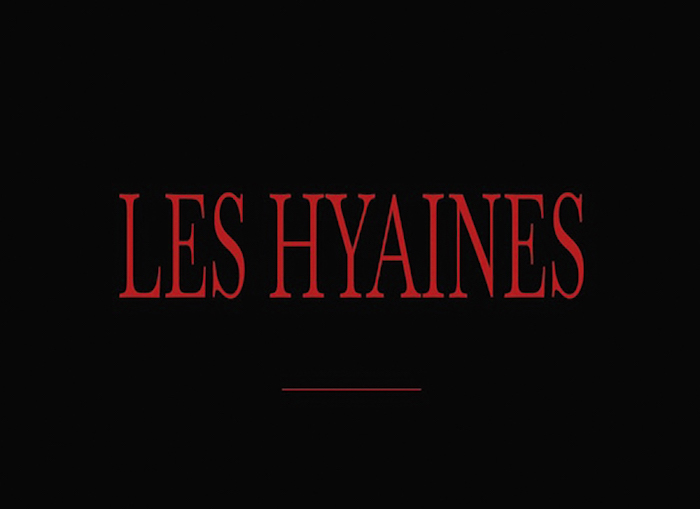Le bizarre est inquiétant autant qu’il est drôle. On peut le trouver partout, et d’abord dans les arcanes de son propre passé, comme il advient à Simon Liberati, qui nous le raconte dans Stanislas (éd. Grasset). Stanislas, c’est le fameux établissement d’enseignement, où le jeune Simon a trouvé une sorte de bagne.
C’est ce qu’il pense d’abord. Puis, en creusant ses souvenirs, il découvre autre chose, de moins dramatique, et cependant de plus inquiétant. Et d’abord de voir que le passé est tellement difficile à retrouver. Bien sûr, Proust nous a donné son mode d’emploi pour y parvenir ; mais ça ne marche pas toujours ; en tous cas, ça ne marche pas très bien pour l’auteur. Parce que pour se souvenir, il faut retrouver des lieux ; or l’auteur ne peut plus retrouver les lieux de sa jeunesse, qu’il a connu en travaux d’enlaidissement, où il n’a vu « que des bulldozers », parce que le monde a tellement changé que Paris ne se reconnaît plus. Le monde de Proust était comme immuable, aussi bien par les mœurs et les hommes, que par le décor. Ce qui a changé, et qui fait que Proust sera bientôt totalement étranger, c’est que le monde s’est déréglé : pris de tremblements comme un malade des nerfs, il se détraque et ne sait plus ce qu’il est. Les sots s’alarment du changement climatique, qui n’est une nouveauté que pour les gens sans mémoire, mais il est bien plus alarmant qu’on soit en train d’achever de détruire ce qui constituait un environnement civilisateur. L’enfance de Simon Liberati a été vécu dans les saccages et les démolitions de tout ce qui émerveillait les yeux du niais – celui qui n’a pas quitté le nid – dont il ne reste pour s’en souvenir que des textes, magnifiques, mais qui ne sont plus que des mausolées. D’où les citations de quelques pépites. D’où aussi le fait désolant que l’auteur n’aime pas l’enfant qu’il a été, encore moins l’adolescent, qui a besoin dans son désarroi d’un monde qui tient debout autour de lui, auquel il peut s’affronter sans risquer de tomber sur un décor minable, et qui plus est en chantier perpétuel.
Pour se souvenir, l’auteur a besoin de rechercher son passé dans les anciens annuaires de Stanislas. C’est en les feuilletant qu’il retrouve les élèves qu’il a connus, dont quelques-uns sont devenus des célébrités, et dont beaucoup d’autres étaient les fils de « gens bien », c’est-à-dire de cette bourgeoisie insupportable qui engendre des petits cons à la pelle, cette bourgeoisie qui se croit destinée à gouverner les hommes pour le motif qu’elle en est incapable, et c’est cette raison obscurément refoulée qui la rend folle, odieuse, et désastreuse. Comment ne tomberait-on pas dans les drogues, l’alcool, les parties de toutes sortes ? On n’apprend pas à vivre dans les bagnes dorés où s’ennuient des enfants abandonnés. Ce que nous peint Simon Liberati sans en avoir l’air, c’est le mécanisme infernal qui nous a fait arriver où on se trouve aujourd’hui, dans une France ensauvagée, barbarisée à coups de subventions inutiles, qui n’ont pour seul résultat que de ruiner chaque jour un peu plus un pays qui tombe en lambeaux, habité par des crétins qui sortent à grands budgets dilapidés de ses collèges, lycées et universités toujours plus bordéliques.
Quand même, il y a des choses qui surnagent du passé, et que l’art permet de faire passer sous nos yeux comme des fantômes, comme ces ombres voletantes qui obnubilèrent le Grand Meaulnes. Simon Liberati se hisse alors au grand style, serré, vibrant, évocateur. Et puis il y a « ce soir d’avril 1972 » quand l’auteur qui écrit ce livre est né d’une insomnie habitée, qui se termina par un de ces miracles de la vie : « l’aube brumeuse qui se leva, et se lève encore aujourd’hui à jamais, sur le jardin de curé, deux pelouses bordées de buis, une allée centrale, quelques poiriers, un mur de pierre et un clocher ruiné. » Phrase magnifique, qui nous donne la carte qui permettra de retrouver « l’île au trésor », le lieu magique où l’auteur est enseveli : « Je ne me suis jamais réveillé de cette insomnie de 1972. Parlez-moi, adressez-vous à la bonne pierre, à la bonne feuille de lierre et je reviendrai. Je reviendrai toujours. » Car c’est à cela que l’auteur nous convie : une résurrection par le style jeté à la mer : on ne peut pas estimer, constate-t-il, « la puissance d’évocation d’une phrase de prose. » Il faut donc écrire « pour que soudain, après notre mort, un autre se saisisse de ce que nous avons laissé échapper presque par hasard, mais pas tout à fait. » Les hommes écrivent dans l’espoir que la conversation, ce miracle d’humanité, reprenne et continue, fort longtemps après leur mort.
Et puis il y a les esprits inspirés qui, pour échapper aux bizarreries de la vie, inventent des bizarreries maîtrisées par le talent et l’imagination créatrice. C’est le cas de Bernard Quiriny, qui nous propose quelques-unes de ses inventions dans ses Nouvelles nocturnes (éd. Rivages). Ce qu’il y a de fichtrement intéressant dans ces inventions, c’est qu’elles sont si étrangement plausibles qu’elles nous éclairent sur nous-mêmes. Pour les construire, Bernard Quiriny choisit un petit point sensible où il appuie ; ce faisant, il ne trouve pas la douleur, mais un autre monde, qui jette sur le nôtre des lueurs infernales.
Rien de tel que quelques exemples. Dans Le gai savoir, qui ouvre le bal, il imagine un étudiant qui fait une thèse « sur rien » ; partant de là, il déroule tout le processus avec une logique imperturbable, et nous fait assister à une soutenance faite de silences soigneusement minutés, puisqu’il n’y a rien à dire mais qu’il y a des règles : c’est le respect des règles qui donne aux remueurs de vent un statut enviable. (Cela s’applique à tous les domaines, évidemment, même à la Présidence de la République, ou de n’importe quelle autre activité de prestige.) Après que chacun, le doctorant et les membres du jury, se soit tu pendant le temps qui lui est imparti, le jury délibère et confère « le titre de docteur ès rien, avec la mention très honorable et les félicitations », ajoutant qu’il « autorise [le nouveau docteur] à ne pas publier [sa] thèse. » Après cette découverte, le narrateur repart : « le cœur étonnamment léger, comme si une clarté s’était faite en moi sur des sujets que j’ignorais ne pas connaître, et qu’un secret de l’existence était en passe de m’être révélé. » Plus un mot sur ce secret, bien sûr : le propre de la nouvelle est d’esquiver toute conclusion, mais on voit bien qu’il s’agit d’une révélation sur l’inanité de toute la science des hommes.
Dans Le barrage sur la Rustule, l’auteur imagine un petit pays du bloc communiste dirigé par un dictateur, qui veut encore développer son économie, donc ses infrastructures ; l’Hilbétie « jouit, pour des raisons bizarres, d’une relative autonomie par rapport à Moscou, d’où sa santé économique. » On y construit à cet effet un nouveau barrage avec l’aide d’ingénieurs français, dont l’un s’étonne de la tranquillité des habitants d’un bourg qui doit être englouti par les eaux, et pour lesquels rien n’a été prévu. Il demande où ils iront quand les eaux monteront. Nulle part, lui répond-on, on restera ici. « En moyenne, […] un barrage hilbète noie 10 000 personnes […] Avec 5 000 victimes, le nôtre serait dans le bas de la fourchette. » Personne ne se plaint, personne ne se révolte, la vie continue. « Quelle importance, à présent ? » C’est la conclusion du texte, riche en anecdotes pleines de tendresse, d’humanité. Si ça ne vous donne pas à penser, laissez tomber. Mais quand même, ayez une pensée pour M. Poutine, pour son talent à développer l’empire russe, pour son ignorance si joliment slave du nombre de victimes que ses projets de développement exigent. N’y a-t-il pas quelque chose d’aztèque dans ces affaires-là ? Vous savez, ce goût des sacrifices humains, dont les grands prêtres n’arrivent pas à se débarrasser.
Vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir vous parler des 26 nouvelles qui forment ce recueil, toutes différentes, par le sujet bien sûr, mais aussi par la forme, la construction ou le point de vue. J’aime celles qui sont faites de collection, comme Professeurs. Le premier est une sorte de fou, qui refuse de faire son métier ; il s’appelle Emstein, parce qu’il évoque Einstein, qu’il n’est pas un génie des sciences, mais de la philosophie, et que lorsqu’on est un génie, on devrait être reconnu ; alors, pour se venger de ne pas l’être, il casse les crayons de ses élèves. Le deuxième est un professeur d’allemand terriblement rancunier. Le troisième est un professeur remplaçant de dessin, qui enseigne l’allemand avec une efficacité étonnante et donne des leçons de saut à de vieux professeurs de gymnastique. Cette galerie offre un étonnant tableau de nos souvenirs d’école en les transfigurant dans un monde de contes et légendes. Elle nous éclaire bizarrement sur la transmission et ses mystères. La nouvelle la plus déroutante s’intitule Histoires du Roi K. On pense à Kafka, mais ça pourrait être Ubu. Elle est terriblement impressionnante, et se termine en farce sanglante. Il y a même des lecteurs qui en font des cauchemars. Rassurez-vous : au matin, tout s’efface, et le soleil luit – s’il ne pleut pas, évidemment. Pour finir, une nouvelle de deux lignes. Je ne vous en dirai rien, parce que les critiques n’en font qu’à leur tête, na !
Stanislas, Simon Liberati, Grasset, 2025, 224 p., 20 €.
Nouvelles nocturnes, Bernard Quiriny, Rivages, 2025, 224 p., 19,50 €.