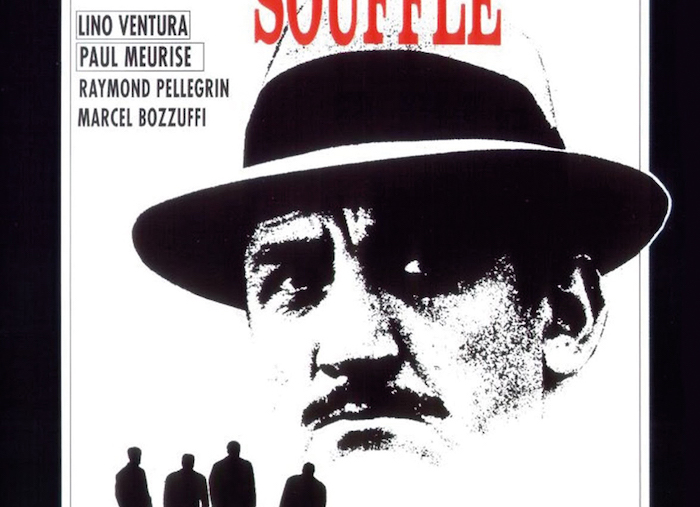À l’heure où, avec componction, certain député en mal de notoriété agite la muleta sur les dangers de la corrida, est-il temps de voir ou de revoir Blood and Sand, magnifique chef-d’œuvre tourné en 1941 par Rouben Mamoulian, en somptueux technicolor.
Le casting est de choix : Tyrone Power en torero impétueux et ténébreux, que le succès brûle jusqu’à l’ivresse, Anthony Quinn, félin et jaloux, qui évincera son ancien ami au sommet de l’affiche des meilleurs toreros, Linda Darnell en madone fidèle et sage mais guère candide, et enfin Rita Hayworth, la rousse incendiaire croqueuse d’hommes. Tiré du roman de Vicente Blasco Ibáñez – auteur valencien à succès dont Hollywood adaptera d’ailleurs par deux fois (en 1921 sous la direction de Rex Ingram et en 1962 sous celle de Vincente Minnelli) Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse –, Blood and Sand s’inscrit dans une politique commerciale et artistique hollywoodienne de réadaptation des anciens grands succès du muet ; c’est ainsi que Robin des Bois ressuscita sous les traits d’Errol Flynn (antérieurement campé par Douglas Fairbanks sous la direction du grand Allan Dwan), que Le Signe de Zorro – sous le masque duquel apparaissait encore Fairbanks (alors dirigé par Fred Niblo) – fera son come-back avec le fringant… Tyrone Power (qu’il tournera, un an avant Arènes sanglantes, sous la houlette de… Rouben Mamoulian) ou encore que Les Trois Mousquetaires crèveront à nouveau l’écran, en 1948 (avec un bondissant et jubilatoire Gene Kelly dans le rôle de D’Artagnan) grâce à George Sidney qui reprendra un des grands succès du même Fred Niblo de 1921.
Ainsi, Blood and Sand est le remake d’un film encore réalisé par Niblo en 1922 (dans une version assez spectaculaire et symbolique, notamment par le combat final qui voit le taureau et le torero, incarné par le grand séducteur qu’était Rudolph Valentino, mourir côte à côte). La version colorée de Mamoulian s’écarte quelque peu de celle de Niblo par les traits de caractère dont il affublera ses personnages. Ici, le cinéaste russe d’origine arménienne, fortement marqué par le théâtre dont il est issu – il mettra même en scène des opéras –, cherchera avant tout l’immuable vérité qui gît au fond de chaque être. Tyrone Power (inoubliable Jesse James dans le mythique Brigand bien-aimé de Fritz Lang) est littéralement écrasé par le fatum auquel il ne peut échapper, en dépit des prières suppliantes de sa femme trompée – qui ne cessera jamais de croire en sa rédemption – ou des conseils avisés de ses amis proches, auxquels il restera sourd. Son personnage de torero illettré, grisé par la gloire factice gonflée par des journalistes sans scrupules, demeurera aveugle à l’amour non moins artificiel que lui consentira Rita Hayworth qui se jouera de lui, avant de jeter ses filets sur Anthony Quinn – dont on devine très vite qu’il ne sera, lui aussi, qu’un énième et furtif trophée au tableau de chasse de la flamboyante séductrice. L’on comprend que le milieu de la corrida est un monde sans pitié ; la nature y est brute, sinon brutale, toute faiblesse pouvant s’avérer fatale, dans l’arène surchauffée comme dans les cafés bondés ou dans les draps tentateurs d’une mante religieuse.
Linda Darnell (qu’on verra beaucoup plus ardente et entreprenante dans La Poursuite infernale de John Ford, en 1946) symbolise au contraire cette pureté quasi édénique, sinon mariale (la scène de prière, saint-sulpicienne à souhait, dans la chapelle de l’arène, évoquerait presque la mort du Christ avant la Résurrection). Elle est rejointe par l’idéalisme d’un John Carradine, qui restera fidèle à son ami, malgré les avanies qu’il subira de lui. Pourtant, rien de manichéen dans cette histoire, à la fois nietzschéenne et biblique. Les salauds ne sont pas ceux que l’on croit et les bons ne sont pas tous voués à la sainteté. Joyau du technicolor, impeccablement réalisé par un cinéaste cultivé, dont le réalisme n’étouffe pas une certaine poésie et qui, par surcroît, nous administre une belle leçon de cinéma, Blood and Sand, par son esthétique (les scènes nocturnes et en clair-obscur sont remarquablement photographiées), son langage universel, une sublime distribution d’acteurs, n’a pas pris une ride. Mamoulian fit moins de films que certains grands Européens d’Hollywood (Lang, Curtiz, Siodmak…) mais mérite incontestablement de figurer au panthéon des grands du 7e Art. Nous avions été très impressionné par sa version du Dr Jekyll and Mr Hyde, surpassant, selon nous, celle de Victor Fleming, pourtant excellente.