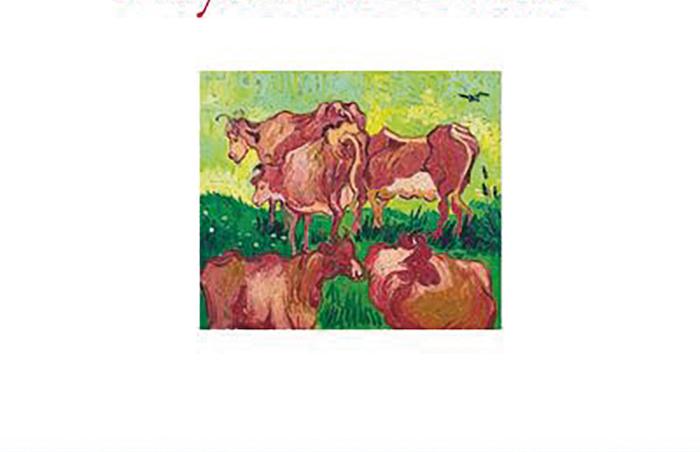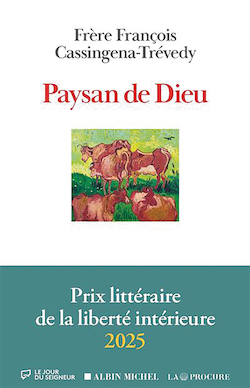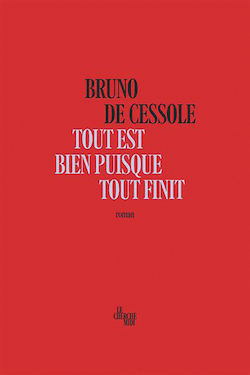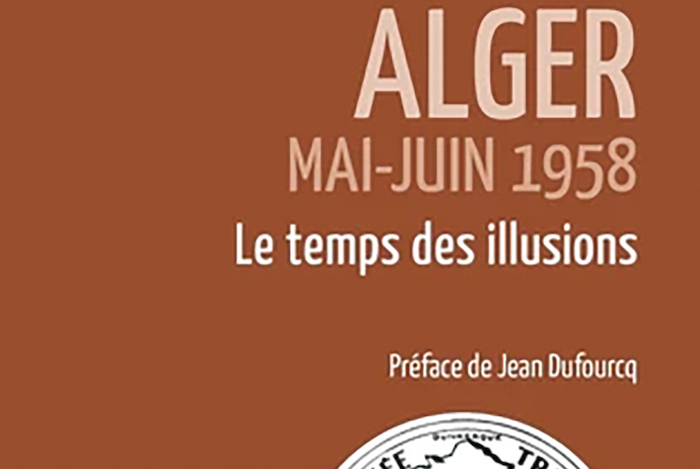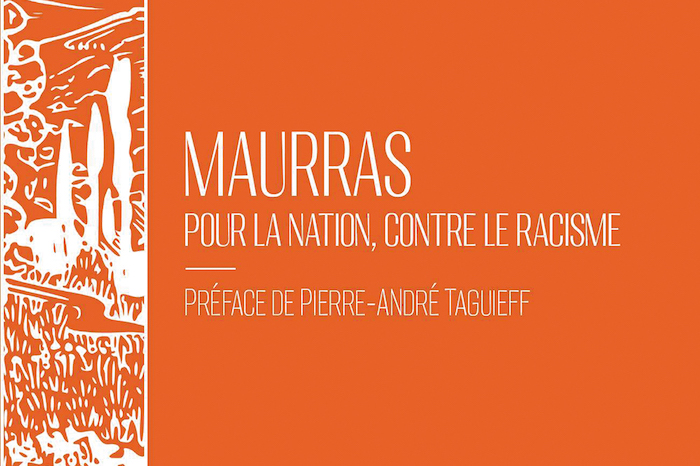Ne reconnaît-il pas humblement qu’il a voulu imiter son maître en se retirant parmi les plus pauvres, attelés à des taches épuisantes, sans reconnaissance, ni récompense ? Dans ce pays rude, tenu à l’écart des mirages du progrès, la vie se raréfie, les joies compensent à peine les deuils – dont les suicides de ceux qui n’ont plus supporté les affres de leur condition précaire. Le peuple juif astreint aux corvées d’Égypte devait présenter bien des parentés avec ces éleveurs à la peine.
Néanmoins, ce qui unit le moine à ce peuple de paysans, ce n’est pas tant de partager ses souffrances que, plus profondément, et plus essentiellement, d’avoir pour lui des mouvements de tendresse et d’admiration. Une tendresse qui se veut proche de celle que le Jardinier mystérieux offre à Marie-Madeleine, qui la lui rend dans l’immensité de ce mot d’amour : Rabbouni (p. 53) ; une admiration généreuse que l’ouvrier agricole ressent pour ces modestes, et qu’il pressentait lorsque, « très jeune élève d’hypokhâgne au prestigieux lycée Louis-le-Grand », venu en vacances dans ce pays rude, il admirait « le commis d’une ferme voisine [… et] lui enviais ses bottes épaisses, ses chandails » et son odeur d’étable. Et cette admiration, et cette tendresse se joignent pour unir les deux versants d’une vie apparemment décousue : loin du couvent, des travaux intellectuels brillants, et « de toutes les officialités assises », le moine érudit a pris la place de ce commis, et le reconnaît avec bonheur : « j’ai pris sa place sur la scène, je suis devenu ce qu’il était. » (p. 183)
Cette communauté se construit, s’accomplit dans le travail de la terre et l’amitié avec les bêtes, qui font de ceux qui s’y adonnent « des gentilshommes », inscrivant dans leurs mains une « majesté », devant laquelle l’auteur ému ne peut que s’incliner : « j’ai considéré les mains de Nicolas, dans la quarantaine, épaissies, meurtries, déformées presque, déjà, par le contact quotidien des bêtes et ces travaux mécaniques de toutes sortes […]. Alors j’ai mesuré […] le privilège qui m’était octroyé d’accéder au compagnonnage intégral et pleinement avoué de cette humanité-là ». Hélas, ce monde si hautement humain s’éboule : « on a mutilé partout nos villages de leurs épiceries, de leurs boulangeries, de leurs cafés, de leurs services les plus élémentaires, et jusque de leurs habitants mêmes. Dans sa marche impitoyable que l’on ose appeler le progrès, une civilisation sans âme ni visage, ivre de communication artificielle, a signé l’arrêt de mort du lien social », la mort de la conversation, qui « est le vivre le plus nécessaire de l’homme. » Espérant néanmoins toujours plus fort, l’homme de Dieu devenu son paysan œuvre à créer dans ce désert une petite Église, faite « des quelques vieilles gens qui viennent encore [à la messe], et des autres, de tous les autres qui n’y viennent pas. » Ces autres, il va vers eux le cœur ouvert par la rude amitié paysanne, la forgeant par le partage des peines gratifiantes du travail de bouseux – vous verrez comment l’auteur honore la bouse – et les petites joies si brûlantes de la vie humble – abandonnant à Dieu tout le reste, dont Il fera sa Volonté.
Voilà ce que le frère François nous raconte dans ce journal tenu au fil des jours, illuminé par l’émerveillement devant la campagne, les vaches, le temps qu’il fait, et que l’art du poète charge d’un feu qui ne consume pas. Ainsi, en allumant le premier bûcher de la saison froide, l’ermite s’émeut : « Sa senteur et son chant me tienne compagnie : il est mon fils. Avec la fidélité conjugale de l’horloge, c’est tout ce que je voulais au monde. » « De mon vivant, avoue-t-il, je suis entré dans mon repos. L’intellectuel s’efface, mais le poète vient pleinement au monde. » Dans cette vie nouvelle, tout est miracle, ainsi du brame des cerfs : « Je sors sur le pas de ma porte, tard dans la soirée, et, naturaliste averti des lois universelles de la vie, j’écoute les exhalaisons rauques du noir désir qu’exaspère la clarté complice de la lune. » Plus tard, par un autre crépuscule, « il y a des chauves-souris dans les cheveux des soirs. » Cette beauté délivre le sens du monde caché dans les choses, inspire le courage de continuer. « Avec dix vieux et quelques hosties, qui frissonnent, depuis des semaines sans doute, dans un tabernacle que nul ne visite, l’on peut faire avancer le Royaume dont on célèbre aujourd’hui le Prince, [car] le Royaume des cieux est comparable à un grain de sénevé »…
Bruno de Cessole n’a pas élu le même peuple. Son héros, qui est aussi un transfuge, se retire auprès des Lisboètes. L’auteur nous raconte ce qui a déterminé ce choix dans un roman vigoureux : Tout est bien puisque tout finit (éd. Le Cherche Midi). Baltazar dos Santos est un écrivain célèbre qui vient d’obtenir le prix Nobel de littérature. On fait sa connaissance alors qu’il est dans l’angoisse de devoir prononcer le discours attendu du récipiendaire : parler en public lui fait peur, tant il est purement écrivain, homme de l’écrit, non de la parole. Il va le prononcer quand même ce discours, vers lequel il tend de toutes ses forces, mais sa vie va en être bouleversée. Car il y ose des aveux qu’on ne doit jamais faire, surprenant tout le monde, au point qu’il est contraint de fuir, de se cacher des journalistes et de ses proches au Portugal.
Vous découvrirez par vous-même ce discours foudroyant, qui frappe comme un essaim d’éclairs ; je vous dirai seulement qu’il est le plus vrai des discours qu’on entendra jamais prononcer à Stockholm. Il pose de manière audacieuse le problème insoluble de la valeur de la littérature, qu’il faut deviner malgré la diversité des livres, des publics, des idées qu’on peut se faire de l’art d’écrire. Bruno de Cessole fait prendre à son héros une attitude quasi diabolique, afin de mettre en lumière l’âme tourmentée de tout homme dont le cœur est travaillé par la plume, car selon l’auteur, tout homme qui ressent le besoin d’écrire est d’abord un monstre. L’homme n’est pas fait pour écrire, être écrivain est donc un malheur, qui signale une incapacité maladive à vivre. Un écrivain authentique est atteint d’un trouble noir, qu’on refuse de voir, que ceux qui lisent préfèrent inverser en artisanat de luxe, fait pour les divertir en flattant leurs passions, leurs sottises ; c’est pourquoi ils font volontiers des vedettes des plus habiles à leur servir d’amuseurs, ce qui donne une vocation illusoire à toutes sortes de faiseurs. Mais ceux qui sont authentiquement tourmentés par ce mal devinent dans cette condamnation à écrire une vocation prophétique, une voix enfouie à faire entendre, et aussi une voie à prendre pour descendre vers ce Portugal rêvé, ce qui est une figure de la descente aux catacombes de notre âme, qui s’y cache pour soupirer, comme le cerf assoiffé d’eaux vives.
Malheureusement, les éditeurs, les écrivains, le monde littéraire dans son ensemble forment un marécage infect où l’on ne cherche qu’à se couler les uns les autres. Ce monde, aussi bien que toute « notre époque, qui se veut si morale, adore, au fond, l’imposture. » Tellement convaincu de cela, Baltasar en vient à douter de l’écrivain qu’il portait au pinacle ; atterré par la lecture d’un guide de Lisbonne écrit par Fernando Pessoa, il s’écrie : « Se pouvait-il que le plus grand écrivain portugais depuis Camoens fût l’auteur de cette insipide œuvre de propagande ? » Il se reprendra, mais la vérité a été levée : un écrivain n’est qu’un homme qui tente de cacher ses petitesses derrière une notoriété de pacotille.
Une aventure étrange va permettre de prolonger cette découverte humiliante. Tandis qu’il vit caché au Portugal sans plus rien écrire, un livre paraît sous son nom, fabriqué par un faussaire talentueux. Commence une enquête policière pour découvrir qui a pris sa plume par usurpation. Baltasar rencontrera cet homme, se liera avec lui, passera un contrat dont je ne dévoilerai rien, sinon qu’il poursuit les révélations sur la nature de ce qu’est la littérature, sur le fait qu’on n’échappe pas aux étrangetés du métier d’écrivain, qu’on doit y tenir compte de beaucoup de choses qui n’ont rien à voir avec le génie.
La richesse de l’invention ne se limite pas à la littérature et aux aventures qu’elle cache, aux secrets qu’elle porte. L’auteur s’est attaché aussi aux mystères des rencontres entre les hommes, à leurs amitiés, à leurs relations, et bien sûr à l’alchimie qui opère, quand un homme et une femme tombent en amour, comme on disait en des temps surannés. Ajoutons que Bruno de Cessole écrit avec cette variété stendhalienne, qui, quoique vive et pénétrante, semble sans apprêt ; une façon de tenir la plume qui enchantera toujours les lecteurs gourmets.
- Paysan de Dieu, François Cassingena-Trévedy, Albin Michel, 2025, 240 p., 21, 90 €.
- Tout est bien puisque tout finit, Bruno de Cessole, Le Cherche-Midi 2025, 352 p., 22 €.
Politique Magazine existe uniquement car il est payé intégralement par ses lecteurs, sans aucun financement public. Dans la situation financière de la France, alors que tous les prix explosent, face à la concurrence des titres subventionnés par l’État républicain (des millions et des millions à des titres comme Libération, Le Monde, Télérama…), Politique Magazine, comme tous les médias dissidents, ne peut continuer à publier que grâce aux abonnements et aux dons de ses lecteurs, si modestes soient-ils. La rédaction vous remercie par avance.