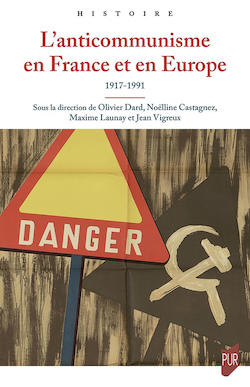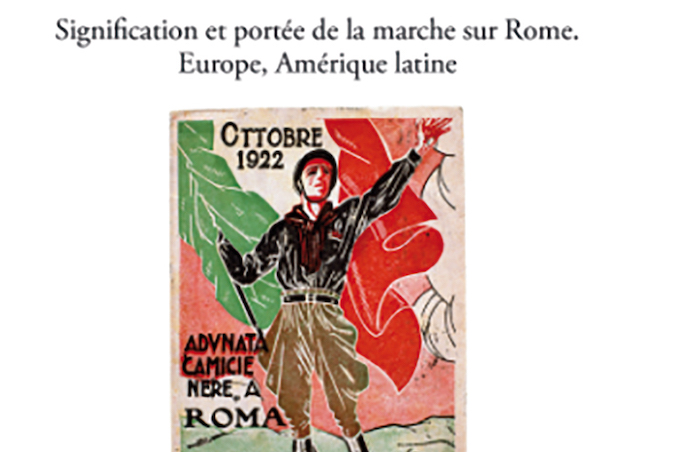On a beaucoup étudié le communisme, mais peut-être pas assez l’anticommunisme, et comme l’écrivent les directeurs de cet ouvrage, « plus encore que l’antifascisme, et peut-être même que l’antiaméricanisme, l’anticommunisme est un parent pauvre de l’historiographie ».
Mais pourquoi diable l’étudier quand triomphe Sartre, pour lequel « tout anti-communiste est un chien », et qui professe qu’« il faut juger le communisme sur ses intentions et non sur ces actes » ? De plus, l’anticommunisme croise autant l’antisoviétisme, géopolitique, l’antimarxisme, philosophique, que ce que Corinne Bonafoux appelle « l’anticommunisme du quotidien », généré par les positions du parti communiste en France.
De l’apparition d’un régime communiste en Russie avec la révolution d’octobre 1917 au remplacement du drapeau soviétique par le drapeau russe au soir du 25 décembre 1991, il y eut ainsi non pas un mais des anticommunismes politiques, celui des droites nationalistes et des conservateurs, sans doute, celui des démocrates-chrétiens encore, mais aussi celui de la gauche, socialiste ou gauchiste. Il y eut des anticommunistes de théorie et des anticommunismes de pratique, des anticommunismes de réaction à une tentative de prise de pouvoir par la force – l’Allemagne après la Première Guerre mondiale – et des anticommunismes luttant contre « la subversion » téléguidée de Moscou. Il y a des méthodes différentes : ceux qui mettent en place des réseaux pour lutter contre le communisme là où il s’est installé, ceux qui veulent juste éviter de le voir s’installer chez eux, et ceux qui, craignant sa victoire, préparent des réseaux pour « l’après ». Il est parfois le fait de gouvernements, parfois d’institutions, parfois de partis, parfois de mouvements culturels, parfois même spirituels si l’on pense aux catholiques ou à une franc-maçonnerie dont Denis Lefebvre nous montre les rapports ambigus qu’elle entretint avec le communisme. La menace communiste, celle des « chars soviétiques », sert souvent à structurer certaines oppositions, en Italie bien sûr, en Allemagne, mais l’anti communisme peut être une doctrine d’État, comme en Allemagne, conduisant à l’interdiction de partis après la Seconde Guerre mondiale. Les anticommunistes dénoncent une réalité mais jouent aussi sur les mythes : en France par exemple, aux élections de 1919 avec l’affiche de « l’homme au couteau entre les dents ». Enfin, la scène internationale a son rôle : influences, pour la France, de la guerre d’Espagne, du Front populaire, du Second conflit mondial, ou du pacte germano soviétique, un contexte qui a ses conséquences sur l’évolution des anticommunismes – les rapports avec les catholiques ayant ici valeur d’exemple.
Comme le notent les directeurs de cet ouvrage collectif, il faut donc noter l’importance, la variété et la durée de l’anticommunisme au long du XXe siècle. On y étudie par exemple, au fil des 25 contributions, le mouvement sabianiste (de Simon Sabiani), qui, à l’époque du Front populaire, s’affirme à Marseille (Florent Gouven), ou l’on suit Jacques Doriot (Édouard Sill). Manuelle Peloille décline les diverses formes de l’anticommunisme en Espagne, Clément Fontannaz les réseaux anticommunistes de la police suisse. Deux analyses évoquent l’armée française : Simon Catros son État-major de 1936 à 1939, Maxime Launay sous la Ve République. Le lien avec les réseaux américains est évoqué (Veronika Dutin-Hornyik), comme le rapport à la RDA et à ses espions (Franck Schmidt). Philippe Buton et Hugo Melchior traitent des gauchisme français, Bryan Muller des comités pour la défense de la république, Stéphane François et Adrien Nonjon les rapports entre l’extrême droite française solidariste et les mouvements russes. On ne peut tout citer ici de cet ouvrage, très riche, très documenté, qui contribue à combler un vide mais qui ouvre aussi bien des pistes.
Sous la direction de Olivier Dard, Noëlline Castagnez, Maxime Launay et Jean Vigreux, L’anticommunisme en France et en Europe. 1917-1991, Presses Universitaires de Rennes, 2025, 376 p., 23€
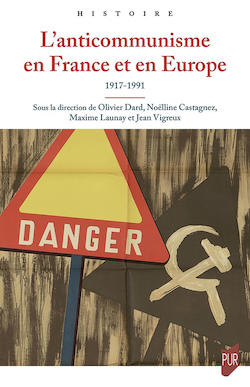
Politique Magazine existe uniquement car il est payé intégralement par ses lecteurs, sans aucun financement public. Dans la situation financière de la France, alors que tous les prix explosent, face à la concurrence des titres subventionnés par l’État républicain (des millions et des millions à des titres comme Libération, Le Monde, Télérama…), Politique Magazine, comme tous les médias dissidents, ne peut continuer à publier que grâce aux abonnements et aux dons de ses lecteurs, si modestes soient-ils. La rédaction vous remercie par avance.