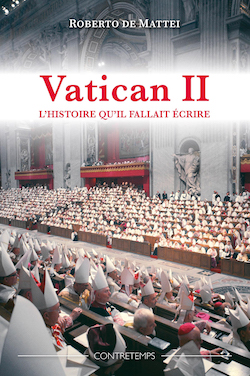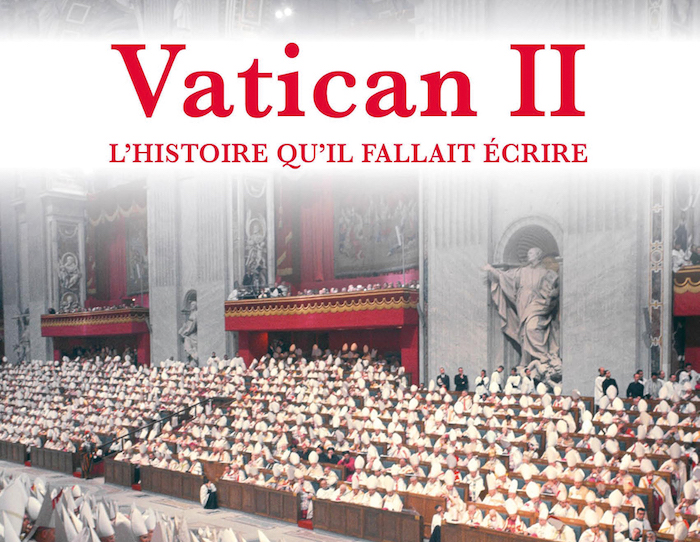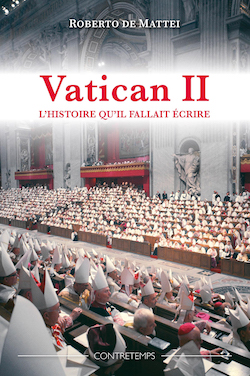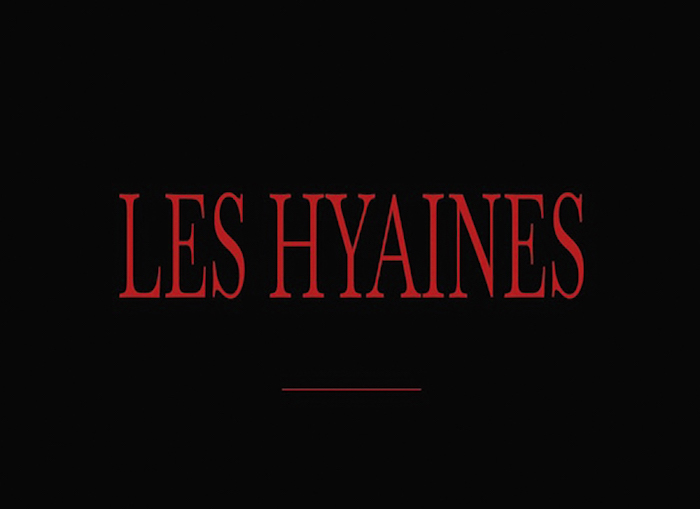La forte polarisation du pontificat de François a remis sur le tapis la question du Concile, non plus en tant qu’enseignement, mais en tant que praxis radicale.
Contrairement à ce que le titre laisse penser, Vatican II, l’histoire qu’il fallait écrire n’est pas un nouvel ouvrage de l’historien Roberto de Mattei, mais la réédition actualisée de son histoire de Vatican II, publiée en 2013. L’auteur propose donc une histoire du Concile appuyée par différentes sources, dont certaines viennent de la « droite » de l’Église. Mais il recourt aussi aux témoignages publiés peu après le Concile ou longtemps après à l’instar de certains carnets. Mattei commence bien avant Vatican II l’histoire du Concile : il rappelle les travaux des prédécesseurs de Jean XXIII et certains éléments qui ont marqué la première partie du 20e siècle comme le modernisme, le mouvement liturgique ou les tentatives de Pie XII pour lutter contre certaines « nouveautés ». Il aborde aussi les phases préparatoires et anté-préparatoires du Concile.
Des rappels pertinents
Pour celui qui s’intéresse à l’histoire de Vatican II, il n’y a rien de nouveau : l’auteur restitue assez fidèlement les controverses conciliaires et rappelle certains faits élémentaires. On notera avec intérêt les anecdotes où certaines plumes du monde catholique traditionnel sont plus lucides que certains évêques de la minorité conciliaire qui « s’emballèrent » pour le Concile qui ne s’était pas encore réuni. Si l’auteur a ses préférences, il rappelle que certaines affirmations ont été le fruit de laborieux compromis. Le fait que la minorité conciliaire ne s’organisa que tardivement, à partir de la deuxième session, en 1963, est bien souligné. Si l’auteur a son parti-pris, il n’évacue pas le fait que Vatican II a été un concile transactionnel. Il souligne aussi en liminaire une perspective de l’époque (les années 60) qui fait de l’histoire un lieu théologique (locus theologicus) : le choix d’une certaine théologie et la conscience de voir des « signes des temps » devait aboutir à un style propre aux documents conciliaires. Mais justement, l’auteur a sa position : l’impossibilité de dissocier les faits des doctrines. Ce qui peut conduire à des difficultés, car si le modernisme s’est traduit par une conception historiciste de l’énoncé théologique, la critique de Vatican II tend aussi à tomber dans cet écueil en survalorisant trop fortement le poids de l’histoire.
Quelques approximations théologiques
L’auteur est historien, mais pas théologien, ce qui conduit parfois à certaines affirmations approximatives. Ainsi, Mattei affirme trop rapidement que la notion de « peuple de Dieu » rompt avec l’ecclésiologie plus traditionnelle de « Corps mystique » pour définir l’Église. Or le thème du « Corps mystique » n’apparaît que tardivement dans les débats théologiques, à la fin du XIXe siècle. Il est vaguement esquissé par certains évêques de Vatican I et il faut attendre l’encyclique de Pie XII Mystici Corporis de 1943 pour que le thème soit mis en avant par le magistère. Le thème est certainement traditionnel, mais sa redécouverte, trop récente, n’a pas suffisamment irrigué la théologie dite préconciliaire. Ce qui prédomine jusque-là, c’est une approche « bellarmienne » de l’Église, insistant sur son aspect juridique et extérieur. En effet, face aux protestants qui minimisaient la visibilité de l’Église, des théologiens de la Renaissance comme Robert Bellarmin ont surenchéri sur cet aspect visible en comparant l’Église à n’importe quelle puissance temporelle comme la république de Venise. Au passage, cette conception bellarminienne fragilise l’unité de l’Église en distinguant radicalement son corps (sa hiérarchie, les sacrements) de son âme (la vie de grâce). Pourtant, dans le même ouvrage, Mattei affirme que Mystici Corporis s’inscrit dans cette optique bellarminienne (!), alors que ce texte affirme la notion de « Corps mystique ». On voit que ce pan complexe de la théologie est mal maîtrisé, ce qui conduit à certaines affirmations hasardeuses. On peut aussi s’interroger sur l’optique minimaliste de l’auteur sur le caractère doctrinal du Concile. Le Concile est pastoral et ne saurait être considéré comme n’étant pas doctrinal en raison de son aspect non « définitoire » dû à ce qu’il n’a pas proclamé de dogme. Mais le développement doctrinal dans l’Église ne peut se limiter à la proclamation de dogmes : quid alors de ces éléments « connexes » que l’Église a imposés sans chercher à les dogmatiser ? Vatican II a tranché certains points comme la sacramentalité de l’épiscopat. Il est le premier concile à traiter de l’Église dans son ensemble, alors que les précédents conciles n’en abordaient que certains aspects (la primauté du pape). Peut-on vraiment dire que malgré un style amphigourique Vatican II a été exclusivement pastoral, même si on peut affirmer qu’il y a bien une doctrine derrière la pastorale invoquée ?
Roberto de Mattei, Vatican II, l’histoire qu’il fallait écrire, Contretemps, 2025, 690 p., 28 €