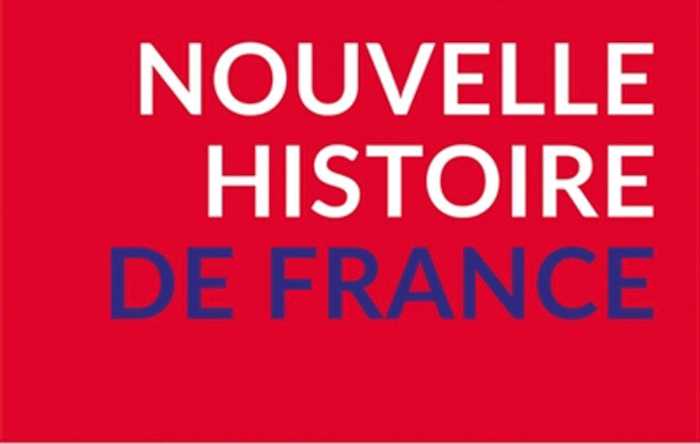Faut-il supposer que les juges se sont organisés pour gouverner la France, ou doit-on faire l’hypothèse que les juges ont « simplement » une vision partisane de leur rôle : ils seraient, eux, les parfaits représentants du consensus social.
On a tout dit sur le délibéré du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 31 mars 2025 dans l’affaire des assistants parlementaires des députés européens du Rassemblement national. Pour ceux qui s’en indignaient, on parlait de « gouvernement des juges », de « décision politique », on sous-entendait un complot, sans que l’on sache bien s’il fallait dénoncer un juge « aux ordres » ou s’érigeant en pouvoir suprême. Mais si l’on écarte le procès d’intention, la décision nous semble mériter plus encore d’être examinée par ce qu’elle révèle des biais inconscients qui expliquent les choix d’une part de la magistrature. Prenons-en quelques exemples.
« Près de dix ans après les faits – écrivent les juges –, malgré les décisions de justice intervenues, la défense […] continue à soutenir que les faits poursuivis ne peuvent tomber sous le coup de la loi pénale. Ce système de défense constitue une construction théorique qui méprise les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire, en ne s’attachant qu’à ses propres principes. »
L’interprétation du juge n’est pas la vérité…
Premier biais, ce refus du juge à tirer toutes les conséquences du fait que le débat ne porte pas tant sur la matérialité des faits – ce que les prévenus, dans leur ensemble, ne semblent pas vraiment contester en l’espèce – que sur leur interprétation, et que le prévenu a le droit d’avoir une interprétation des faits différente de la sienne. On retrouve en partie derrière ce biais la pression du droit anglo-saxon, autour de la notion du « plaider coupable », récemment importé dans notre droit et qui fait les beaux jours des séries télévisées. Si le prévenu va à Canossa et accepte l’interprétation du juge, c’est qu’il est alors en voie de rédemption, et sa peine peut être allégée ; s’il persiste au contraire dans l’erreur, perseverare étant on le sait diabolicum, le châtiment se doit d’être exemplaire, car, n’ayant pas compris sa faute, il serait naturellement enclin à la reproduire : « dans le cadre de ce système de défense […] qui tend à contester […] les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive est objectivement caractérisé ».
Et si le fait que le prévenu puisse exercer des recours – appel, cassation ou Cour européenne des droits de l’homme – devant d’autres juges, qui pourraient eux aussi avoir une autre interprétation des faits que la sienne et infirmer son jugement ne choque pas le juge, c’est sans doute, plus ou moins consciemment, parce que ce seraient alors d’autres juges qui s’exprimeraient, et que ces hommes de l’art ne sauraient avoir, eux, une « conception narrative » de la vérité, quand bien même se rallieraient-ils… à celle du prévenu. Et c’est au contraire une circonstance aggravante pour le juge que de constater que ces prévenus qui se refusent à admettre la vérité ainsi révélée par les magistrats sont des personnes « qui ont pour les principales une formation de juriste ou d’avocat » : ils démontreraient en restant dans l’erreur « une conception peu démocratique de l’exercice politique ainsi que des exigences et responsabilités qui s’y attachent » – c’est-à-dire sans doute se refuser de monter à l’échafaud en remerciant les juges de leur clairvoyance.
Dans sa tâche d’interprétation, le juge fait par ailleurs feu de tout bois puisqu’il utilise même… des textes postérieurs aux faits. « Si la peine d’inéligibilité n’était pas obligatoire à l’époque des faits dont les prévenus sont déclarés coupables – écrit-il ainsi le plus sérieusement du monde –, les lois postérieures illustrent néanmoins la volonté du législateur de mieux sanctionner les manquements à la probité pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics », et de conclure qu’« elles méritent à ce titre d’être évoquées ». Le nouveau biais inconscient ici est ce progressisme juridique selon lequel le droit irait toujours ascendant vers des lendemains qui chantent. Dans cette approche, on peut prendre alors en compte les textes postérieurs pour comprendre la logique des législateurs antérieurs – ce qu’ils n’ont pas voulu dire, ou plutôt pas pu dire alors. C’est un biais révélateur, le juge ne concevant plus le droit que sous le mode appliqué dans nombre de jurisprudences du « cliquet anti-retour », interdisant la remise en cause des « progrès » antérieurs vers ce qui n’est jamais que ce qu’il souhaite lui pour notre société. Mais c’est un biais cependant aberrant intellectuellement : on se demande par exemple dans ce cadre comment un juge futur prendrait en compte un retournement du législateur – ici l’éventuel texte qui pourrait être voté par le Parlement pour revenir sur certaines dispositions de la loi Sapin 2…
Il y avait pourtant des voies médianes à trouver au sujet de cette désormais fameuse exécution provisoire de la peine, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 28 mars 2025 en avait évoqué une. Ses décisions s’imposant à tous, le tribunal la cite : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Et puis ? Et puis rien, exit ici la supériorité d’un juge constitutionnel dont les décisions s’imposent à tous, ou même le fameux « dialogue des juges », car le tribunal correctionnel ne prendra en compte que la « juste conciliation » avec « les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de bonne administration de la justice ». Un « ordre public » qui deviendra, une fois politisé dans cette décision, « ordre public démocratique », et qui subirait un « trouble majeur » si était « candidat, par exemple et notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité, pour des faits de détournements de fonds publics et pourrait l’être par la suite définitivement ». Est-ce que disparaît ainsi toute proportionnalité avec la liberté de l’électeur ? En fait, ce dernier semble n’être pensé – autre biais inconscient du juge – que comme ayant nécessairement la même interprétation que ce dernier de ce que peut ou doit être « l’ordre public démocratique ».
Ce qui nous amène à un autre biais que révèle la prétention des juges à affirmer dans leur décision reposer sur un « consensus social ». « Le tribunal – lit-on avec une certaine surprise – ne doit, ni ne peut non plus en la matière, quand il s’agit d’interpréter la loi, ignorer l’exigence de recherche d’un consensus social (qui ne peut se confondre avec le consensus d’une classe, quand bien même s’agirait-il de la classe politique par exemple) ». On serait bien en peine d’une part, devant sa fragmentation actuelle, de définir le consensus de cette « classe politique » contre les agissements de laquelle le tribunal – comme n’importe quel leader populiste de base – entend mettre en garde les Français. Mais là encore, comment ne pas voir l’aveuglement du juge : si les jugements sont certes toujours rendus « au nom du peuple français », quid du « consensus social » pour nombre de décisions prises ces dernières années dans certains domaines, au premier rang desquels ceux de la sécurité où de l’immigration ? Mais dans le cas d’un hiatus le juge est sans doute, comme le souhaitent certains commentateurs, l’avant-garde éclairée de la « démocratie continue », parlant au nom de sa sanior pars…
… mais il veut qu’on se rallie à sa vérité
Cet aveuglement le conduit même à révéler ses présupposés politiques malgré lui. Selon le tribunal par exemple, « l’atteinte aux intérêts de l’Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme mais avec détermination, par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes ». Or, non seulement cet argument ne tient pas, mais il offense jusqu’au sens commun. Car enfin, si effectivement le Rassemblement national, parti eurosceptique, a fait preuve de « détermination » en utilisant les fonds du Parlement européen pour son propre fonctionnement, on ne peut véritablement s’en étonner. Toute autre est par exemple la position du Modem, parti lui europhile qui s’est trouvé rigoureusement dans la même situation, et c’est dans ce dernier cas qu’il aurait fallu parler de « cynisme » – sinon de trahison de l’idéal européen. Mais le biais intellectuel des juges les conduit à ne voir de cynisme – qui, cela va de soi, sera un élément d’aggravation de l’inconduite supposée – que chez les eurosceptiques.
Au fil de cette décision, particulièrement symbolique, on voit que le juge entend non seulement faire prévaloir son interprétation juridique des faits – ce que l’on ne saurait lui refuser, c’est effectivement son rôle et, nul n’en disconviendra, la tâche est délicate – mais aussi sanctionner le prévenu qui ne se rallie pas à sa « vérité » – et plus durement encore si c’est un politique ayant des notions de droit ; on note ensuite que pour démontrer l’existence de cette « vérité » il recherche la volonté des législateurs anciens… dans les lois de leurs successeurs ; que pour condamner comme il l’entend il se refuse au « dialogue des juges » et à la supériorité du juge constitutionnel quand cela ne lui convient pas ; qu’il prétend représenter un « consensus social » qu’il viole régulièrement ; et qu’il trouve des circonstances aggravantes dans certains choix politiques des prévenus.
Il est tentant, nous le disions en introduction, de parler face à cela de « gouvernement des juges », de « décision politique », de dénoncer donc un choix délibéré des juges, qu’il soit téléguidé ou non. Mais les non-dits de cette décision et les biais intellectuels qu’ils révèlent laissent entrevoir autre chose, qui pourrait être pire. Il est à craindre en effet que certains juges ne soient simplement « en roue libre », aveuglés par cet entre-soi oligarchique dont nous venons de relever certains éléments : le progressisme, le refus du débat, les œillères idéologiques et la certitude de représenter le « consensus social ». Et ce conformisme, au regard de ce que qu’est aujourd’hui le pouvoir du juge, est sans doute plus inquiétant pour le fonctionnement de nos démocraties qu’un supposé complot.