France
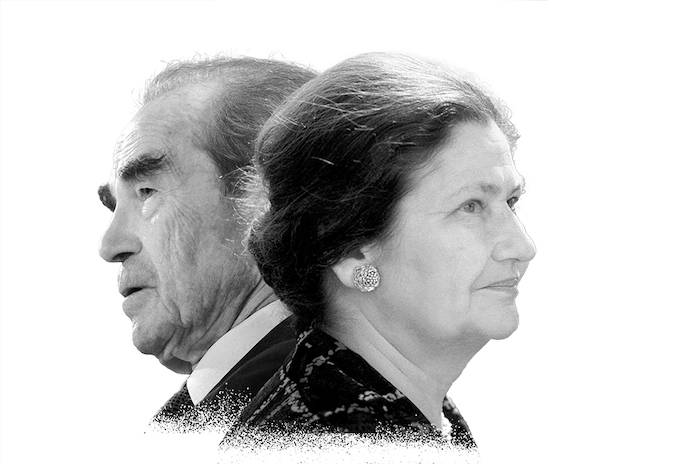
Intrinsèquement pervers
Quelle idéologie, quel régime politique mérite cette qualification rien moins que flatteuse ?
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Venant d’être licenciée sans ménagement par la nouvelle direction d’un grand quotidien d’informations, Ann Mitchell (Barbara Stanwyck) se venge par un dernier article en inventant de toute pièce John Doe, un homme menaçant de mettre fin à ses jours le soir de Noël, aux fins de dénoncer la société matérialiste, son égoïsme et ses injustices.

Les ventes explosent et la journaliste opère son retour pour orchestrer ce canular. Jetant son dévolu sur John Willoughby (Gary Cooper), un ancien joueur de base-ball devenu vagabond, celui-ci, initialement réticent, prête sans réserve – en dépit des incessantes objurgations de son meilleur ami « le colonel » (Walter Brennan) – ses traits à John Doe, favorisant à travers tout le pays la création de comités de bienfaisance et d’entraide. Ce dernier s’aperçoit qu’il est instrumentalisé par Ann servant les objectifs de son nouveau patron, D. B. Norton (Edward Arnold), qui veut conquérir la Maison-Blanche. Distribué par la Warner Bros, cette œuvre magistrale et méconnue de Franck Capra (qui avait tourné en 1936 L’Extravagant Mr. Deeds, et auquel on devra Mr Smith au Sénat en 1939, Arsenic et vieilles dentelles en 1944 et La Vie est belle en 1946) devrait être enseignée et analysée dans les écoles de communication. On y retrouve un condensé explosif propre à faire parler d’Edward Bernays (Propaganda), de Gustave Le Bon (La Psychologie des foules) et de George Orwell (Le Quai de Wigan), Christopher Lasch, Jean-Claude Michéa, Jacques Ellul, Charles Péguy et bien d’autres. Film « populiste » au sens littéral de l’acception, L’Homme de la rue (Meet John Doe, 1941) est au 7e Art ce qu’Hôtel du nord d’Eugène Dabit est à la littérature (tout en ayant été finement adapté pour le grand écran par Marcel Carné en 1938 avec les immortels Arletty et Louis Jouvet). Véritable ode à la décence ordinaire, cette morale commune pré-politique des petites gens, loin des calculs cyniques des entrepreneurs en domination bourgeoise, le film se veut aussi une satire sociale acerbe brocardant la propension de ces mêmes gens de peu à succomber aux sirènes enivrantes de la propagande.
En arrière-plan, c’est toute une critique radicale de la société américaine qui ne jure plus que par la modernité, l’industrie des loisirs, l’emprise des médias de masse et l’individualisme structurel. Capra échappe à tout procès en manichéisme, n’étant pas dupe de la fragilité de la pâte humaine, aussi malléable et crédule que capable de grands sursauts rédempteurs (la fin du film, un soir de Noël, transporte d’espérance, lorsque Barbara Stanwyck invite à imiter le Christ ou quand James Gleason rappelle que le peuple se dressera toujours contre les puissants). Le cinéaste joue habilement sur les polarités, chacun des protagonistes principaux étant assorti de sa part d’ombre et de lumière. Ainsi, le magnat de la presse, superbement campé par Edward Arnold, businessman sans scrupule, est-il doublé par le personnage du directeur de son journal incarné par un James Gleason, figure expiatrice de son indécrottable patron ; quant à Gary Cooper, cet « homme de la rue », naïf de l’histoire se prenant finalement à un jeu auquel il ne cesse sincèrement de croire, il est affublé d’un Walter Brennan on ne peut plus clairvoyant sur cette « civilisation des charognards » qui porte le fer au cœur de la décence ordinaire. « C’est cette décence, nous dit le philosophe Bruce Bégout, que l’homme peut perdre lorsqu’il abandonne le terrain de la vie ordinaire et se lance dans des stratégies de distinction sociale et de domination, en particulier l’intellectuel de parti, prompt à justifier toutes les bassesses et les crimes politiques au nom d’un idéal, voire à les commettre lui-même, en raison de sa volonté de “tenir le fouet’’ ». Stanwyck – qui tournera pas moins de six films sous la direction de Capra – crève l’écran dans ce rôle de femme indépendante et ambitieuse que le souvenir de ses modestes origines ramènera sur le chemin de la rédemption. Déjà une grande actrice, elle annonce ses rôles futurs de femme venimeuses (Assurance sur la mort, de Billy Wilder, 1944) ou à poigne (Quarante tueurs, de Samuel Fuller, 1957). Un film captivant et sans temps morts !