France

Le wokisme ou la raison sans éthique, Descartes et la morale du doute
Et si l’oubli – pour ne pas dire la désertion – du sens commun érigé en axiomatique servait à expliquer les plus grands de nos maux actuels ?
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
La Pléiade publie une nouvelle édition de Descartes, un événement qui donne l’occasion de parler de ce « cavalier français qui partit d’un si bon pas », comme a si bien dit Charles Péguy. D’autant que René Descartes, le plus grand philosophe français, reste presque totalement méconnu.
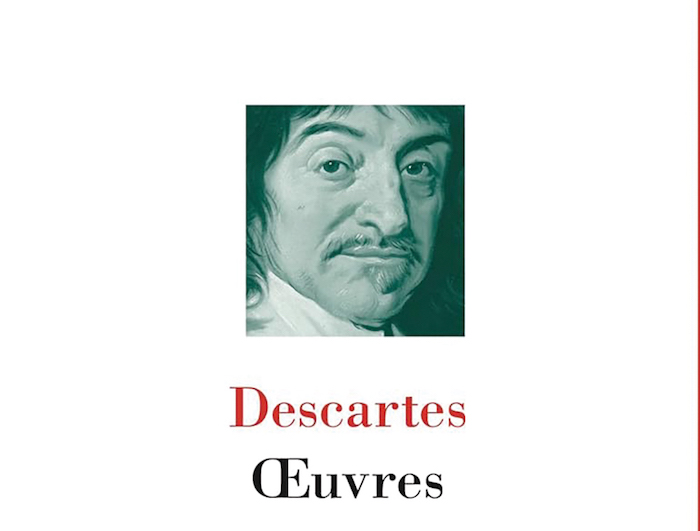
On a fabriqué à sa place une marionnette, que les uns manipulent en criaillant qu’elle est leur idole, et que les autres agitent afin de lui faire endosser tous les maux qui les obligent à se gratter frénétiquement. Mais il y a aussi les modestes, qui inlassablement le lisent, comme Louis Rouquayrol, dont le Descartes et la culture des esprits (qui vient de paraître aux éditions Honoré Champion) est une tentative pour comprendre ce qu’est le « bon sens », dont le philosophe soutient qu’il est le bien de chacun. 300 pages pour expliquer une expression : voilà ce qu’est le vrai labeur intellectuel, qui produit un ouvrage qui n’a rien, évidemment, d’un livre de divertissement. C’est qu’une expression, qui peut être employée avec bien des nuances, ne sort pas du néant, appelée par celui qui l’emploie, pas plus qu’elle n’atteindrait directement l’intelligence de ceux qui l’entendent. On croit naïvement qu’on sait ce que veut dire une expression aussi courante, on le croit si bien qu’on n’essaie même plus de fixer notre attention sur sa signification, sur les raisons qui font qu’on croit la comprendre.
Retournons-nous donc sur notre histoire personnelle, en nous aidant aussi bien de Descartes que de son commentateur. On ne naît pas avec un dictionnaire dans la tête. On ne savait rien, même pas parler, en débarquant parmi les hommes. Il a fallu des années d’imprégnation, puis d’apprentissage pour user de notre langue maternelle à peu près correctement, mais selon l’usage limité de la tribu. Nos parents, nos proches parlaient une langue dont nous nous sommes imbibés, dont nous avons peu à peu compris les mots en les entendant employés dans les situations de la vie ordinaire. Nos maîtres d’école ont ensuite enrichi notre vocabulaire par des leçons plus ou moins bien faites, sur des programmes façonnés par des fonctionnaires sans doute bien intentionnés, mais aussi souvent maladroits, eux-mêmes façonnés par ceux qui les ont éduqués, dans un esprit modelé par des a priori, une idéologie, des habitudes, des ignorances, des croyances… Quand avons-nous reçu l’expression le bon sens, comment l’avons-nous comprise, enregistrée, utilisée ? Cette histoire est noyée dans les brouillards de la mémoire profonde, tandis que l’expression est entrée dans notre usage ordinaire, largement irréfléchi. Quand Descartes a vu cela, il s’en est inquiété, se demandant comment on pouvait penser droitement avec des mots reçus dans de telles conditions. Car ce sont les mots qui permettent la pensée, ces mots qui forment un héritage à l’état brut, accepté sans examen sérieux, ces mots que nous combinons selon une grammaire dont nous n’avons pas plus pris la peine de vérifier la validité. Constatant cela, Descartes a voulu tout reprendre avec sérieux. Travail colossal, on l’imagine, avec ses incertitudes, ses variations, ses repentirs et ses précisions, qui ne sont pas seulement apportées aux autres, mais qui se sont imposées à sa propre démarche intellectuelle.
Louis Rouqueyrol a refait le même chemin pour nous expliquer ce que Descartes entend par le bon sens, en tenant compte des textes les plus variés. Le bon sens est d’abord une bonne direction, car il faut prendre la bonne direction, d’où la formule de Péguy, qui n’est pas une belle image, mais un condensé de réflexion approfondie. Avoir du bon sens, c’est d’abord avoir l’intuition de la juste direction à prendre. Le sot part au hasard, le mouton suit le troupeau, quand bien même il irait se noyer à sa suite dans la mer mauvaise. L’homme avisé prend la bonne direction, et peut y marcher « d’un si bon pas » puisqu’il sait où il va. Pourquoi Descartes est-il présenté comme un cavalier ? Parce qu’un cavalier fait confiance à son cheval. Il ne va pas au hasard ou selon ses caprices, il fait confiance à son cheval, c’est-à-dire à la nature. Parce qu’il y a du bon sens inscrit dans la nature. Un cheval sait la route de son écurie. Un ours sait où passent les saumons. Un trappeur sait où trouver du bois sec. Mais que fait un ours que montre un saltimbanque ? Il danse lourdement sur place pour amuser les badauds. Que fait un écolier mal appris ? Il est ce sot animal qui ravage les jardins soignés, comme dans la fable de La Fontaine. La Fontaine met le pédant et l’écolier dans le même sac, parce qu’il est un disciple de Montaigne, et par suite de Descartes, qu’il sait comme lui que les enfants sont abêtis par les pédants qui ne débitent que des discours déplacés, hors de la situation vécue, pour la raison qu’ils ne savent plus regarder, observer, déduire de ce qu’ils voient, ce qui constitue la situation dans laquelle il faut agir avec bon sens, dans un juste rapport avec les éléments constitutifs de la situation, dans laquelle il faut, en un mot, être raisonnable.
Nos députés sont de beaux modèles de ces écoliers assotés, puisqu’ils ne savent que brailler des discours, se chamailler, pendant que les murs tombent. Si Descartes revenait, il reconnaîtrait tout de suite en eux ces gens qui exercent le pouvoir dans « les états populaires », à savoir « ceux qui sont les plus effrontés, et qui savent crier le plus haut, encore qu’ils aient le moins de raison » (lettre à Elisabeth de Suède, 10 mai 1647). Descartes, on le voit, peut nous rappeler de belles choses. Non pas le Descartes qui serait mécaniste, mauvais chrétien, matérialiste, j’en passe et des meilleures de celles que les sots et les pédants ont inventées et proclamées avec superbe. Mais le Descartes qui s’est expliqué sur le bon sens, la méthode pour bien penser, et qui a montré comment il s’en servait, le Descartes qui a étudié les illuminés allemands, l’Anglais Bacon, Ramus, un autre Anglais, Herbert de Cherbury, que Mersenne venait de traduire en 1639 et qui l’intéresse fort, car il pratique lui aussi le doute méthodique, et propose donc de revenir au bon sens naturel.
Descartes sait que le péché originel nous a rendu misérables, mais il sait aussi que Dieu n’a pas privé sa créature de ce qui la rendait semblable à lui, le don de la sagesse, qui lui permet de cultiver la terre, à la sueur de son front, en luttant contre les ronces, mais avec la capacité de la rendre féconde malgré tout, pourvu qu’il ait le courage et l’humilité d’obéir à sa nature, donc à la nature dont il est un élément.
On ne se met pas au travail de la même façon selon qu’on cherche du bois pour se chauffer, pour se construire un lit, ou pour sculpter une Sainte Vierge. On ne réfléchit pas de la même façon selon qu’on cherche des curiosités amusantes, des finesses pour embobeliner nos semblables moins subtils, ou qu’on cherche la vérité. Descartes voulait chercher la vérité pour lui-même, mais aussi apprendre à ses frères humains à la chercher aisément et sans risque de s’égarer, afin qu’on pût établir une paix intellectuelle entre les hommes. Il a vu comment ses petits camarades étaient idiotifiés par les maîtres d’école, il a constaté que certains chercheurs imbibés de sottise n’aimaient que les difficultés insolubles et les inventions les plus folles, il a observé que les savants énervés construisaient des systèmes abstraits, biscornus et sans utilité, bref, des ponts dans les nuées. Il a remarqué aussi que les artisans réussissaient sans trop de difficultés à pratiquer leurs métiers et à produire les choses nécessaires, que les paysans savaient faire produire à leurs champs les plantes nourricières, que les artistes produisaient de belles œuvres, alors que ces gens de métiers n’étaient ni savants ni philosophes à la façon dont s’enorgueillissent de l’être des clercs rouges d’orgueil.
On oublie toujours que Descartes, abandonnant ses maîtres, ainsi que tous les philosophes et savants abscons, a examiné avec une curiosité véritable « les techniques […] des artisans qui tissent des toiles et des tapis, ou celles des femmes qui piquent à l’aiguille, ou tricotent des fils pour en faire des tissus de structures infiniment variées », qu’il a vu que « c’est merveille comme tous ces exercices développent l’esprit, […que ] c’est à les observer minutieusement que se réduit presque toute la sagacité humaine. » (Règles pour la direction de l’esprit, règle X). En vérité, Descartes a douté de ce qu’il avait reçu de manière passive, et sans exercer le contrôle de la raison, comme tout enfant acquiert l’essentiel de son bagage intellectuel. Mais il n’a jamais douté de ce qu’il était, de la nature que Dieu lui avait donnée, des facultés dont il était doté. Un artisan à son établi, une femme à son ménage, un paysan à son champ, tous sont obligés de faire appel à leur esprit avec ordre et méthode s’ils veulent exercer leurs talents. Et comme ils usent de la même capacité de penser justement, on peut apprendre à leur école la bonne méthode pour chercher la vérité dans n’importe quelle science. Descartes nous apprend à penser sans orgueil, avec la même humilité que le croquant laboure. Et il veut que nous ne perdions jamais de vue cette règle, comme il nous l’enseigne en racontant sa propre vie de chercheur réglé, ainsi qu’il le fait dans le Discours de la méthode, qui est une autobiographie.