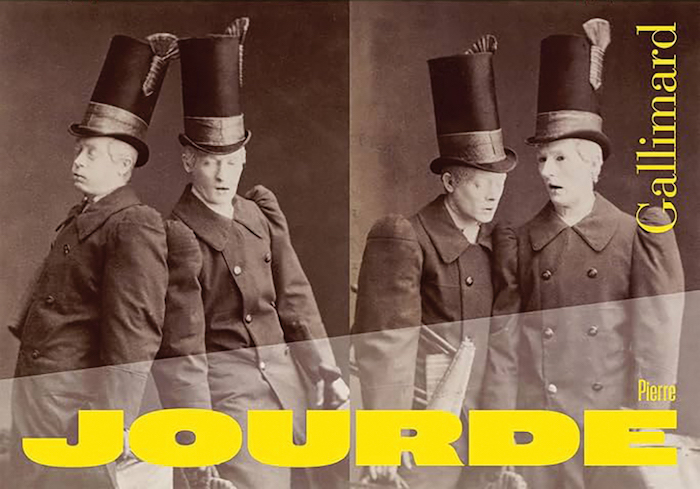On sait la place éminente que le cheval a tenue en Europe au point que l’histoire et la fable surabondent d’histoires exaltant les vertus de la bête et du cavalier.
Sa tête étrange (regardez tous les yeux !), ses yeux vifs, ses galops fous mais aussi ses allures si réglées, sa docilité incroyable si on songe aux charges de cavalerie… Mais aussi la vénération dont il fait l’objet, et son commerce insensé, tout étonne. Versailles a décidé de lui consacrer une exposition-somme, un peu à la manière de Jean Clair, mais en axant tout sur le cheval de cour : magnifiques chevaux de trait tirant des carrosses féériques ou compagnon de joute, danseur dressé aux évolutions les plus compliquées (irréel Cerbero exécutant une capriole) ou camarade allant jusqu’au dernier sacrifice, habillé d’or et méritant ses propres portraits, le cheval impose sa figure dans tout le palais.
C’est ainsi qu’au bout de la galerie des Glaces, droit sorti du château de Konopiště en République Tchèque, le Portrait du jeune prince Léopold de Médicis (v. 1625) offre le spectacle surprenant d’un enfant de huit ans juché sur un cheval à la crinière si longue qu’elle est ramassée et attachée par une boucle sur la croupe. Surgie de nulle part, cette toile n’est pas la première surprise du visiteur qui a d’abord été accueilli par une longue série de portraits équins grandeur nature, Charles XI de Suède ayant fait peindre vingt ans durant ses chevaux préférés. Il aura aussi croisé La Reine Victoria à Osborne, sur son poney Flora (1865), en grand deuil, décachetant son courrier et le jetant à terre sous le regard de son valet et de ses chiens, juste à côté de Napoléon III à Sedan sur son pur-sang Phoebus (1877), toile crépusculaire à souhait.
Les chanfreins de métal qui protègent les chevaux leur donnent des airs fantastiques, comme celui conçu par Romain des Ursins pour le futur roi Henri II ou le Chanfrein aveugle, pour une joute, pièce allemande de 1490, où le cheval ne voit rien lorsqu’il se rue vers l’adversaire ; un Album de tournois et de parades de Nuremberg montre des chevaux ainsi aveuglés, harnachés comme leurs cavaliers dont l’un arbore sur son casque une cage à oiseaux garnie de volatiles ! Mais les pièces cuirassées renvoient aussi aux planches anatomiques incroyables du Parfait cavalier ou la vraye connaissance du cheval (1647) où des chevaux à l’air furieux sont couronnés de leurs propres cerveaux jaillis de leurs fronts. On croirait voir les chevaux qui dévorent Diomède dans la toile de Gustave Moreau (1865).
L’alliance de l’homme et du cheval
C’est tout l’intérêt de l’exposition de rassembler des œuvres si diverses et d’en démontrer la convergence, l’unité, qui n’est pas purement fortuite : le cheval est vraiment l’objet d’une passion continue et l’exposition aurait pu aller au-delà de l’ironique Livraison à cheval des premières voitures au Grand Palais pour le Salon de l’automobile (v. 1930). Pour autant, les œuvres se partagent en deux grands ensembles : celles où le cheval est vraiment le sujet (Alfred de Dreux, Géricault, Delacroix, Potter, après les chevaux de Charles XI), celles où il n’est qu’un élément du décor, comme dans les courses de têtes et de bagues, courses d’apparat et de divertissement, version affadie des joutes : les Timbalier et trompette amériquains des fêtes de 1662, ou Mme la Chambellane von Racknitz à la course de bague des Dames, le 6 juin 1709, de Mock (1710).
C’est peut-être dans les peintures les plus guerrières que le cheval réussit à réunir les deux ensembles, avec quelques toiles admirables, mais aussi une série de dessins de Le Brun étudiant des chevaux morts ou mourants (qu’on comparera aux planches anatomiques des vétérinaires, horriblement exactes). Dans deux salles consécutives, « Le cheval, roi de guerre » et « La mort du cheval », sont réunis les tableaux les plus saisissants, les plus narratifs, les plus cinématographiques : Rezonville, 16 août 1870, la charge des cuirassiers, où on a l’impression de voir le travelling de la caméra et où comprend mieux que les “détails” anecdotiques sont comme des gros plans insérés, La Pucelle, de Craig (1907), comme un buisson de lances rouges explosant l’espace, et Le précipice du Waterloo, d’Ulpiano Checa (1895) : certainement pas la toile la plus belle, la plus aboutie, au plus beau pedigree, mais le spectacle de ces cuirassiers et de leurs montures tombant avec les mêmes yeux exorbités, sous un ciel blafard, sans héroïsme aucun, “trahis” par le terrain, signe l’alliance de l’homme et du cheval plus sûrement que les costumes emplumés du Prince de Condé et de sa monture, prétendu empereur des Turcs. Buffon évoquait le cheval qui « se livrant sans réserve, sert de toutes ses forces, s’excède et même meurt pour mieux obéir ».
Cheval en majesté. Château de Versailles, jusqu’au 3 novembre 2024.
Illustration : La Pucelle, Frank Craig (1874-1918), 1907
© Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn, Patrice Schmidt