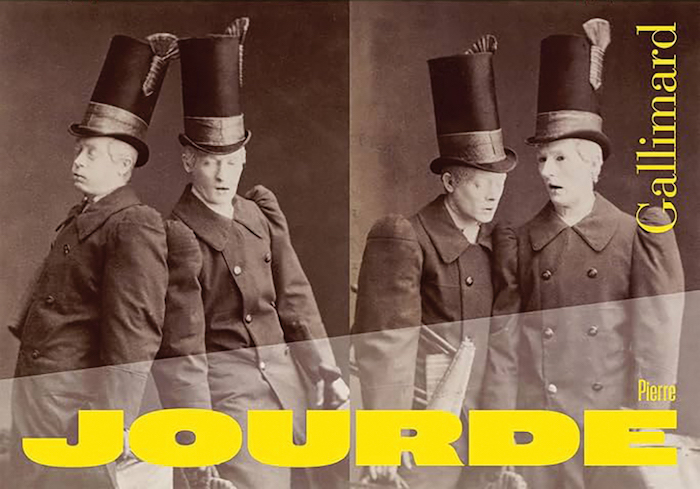Marie-Hélène Moreau réalise, dans Ceux qui comptent, un tour de force : elle arrive à rendre intéressants – que dis-je, intéressants ? passionnants ! – des personnages médiocres.
Nous sommes dans une multinationale. L’un de ces personnages est un comptable consciencieux, mais sans envergure, qui voit une promotion lui passer sous le nez ; un autre est une RH qui découvre qu’on lui a dégonflé les pneus de sa voiture ; un troisième, chef de service, se demande assez souvent pourquoi on l’a nommé là, etc., jusqu’à un petit arriviste, qui s’avère plutôt salaud. Mais ces médiocres, on va les connaître de l’intérieur, le roman n’est fait que de leurs monologues intérieurs. Du coup on se passionne pour ces petites détresses, ces petites ambitions, ces petites rivalités, ces malaises, ces « pétages de câbles », car nos personnages pensent comme ils parlent, ce sont de petits cadres, ils mêlent anglicismes, tournures relâchées et jargon chic. La satire de ce langage, et du panier de crabes qu’est une multinationale, est discrète. Marie-Hélène Moreau ne force pas le trait, ça parle de soi-même. En fin de compte, on a droit à une tragédie racinienne contemporaine où le dénouement navrant n’est que le résultat d’un rapport de forces.
Marie-Hélène Moreau, Ceux qui comptent. La mouette de Minerve, 2023, 258 p. ; 16 €