Louis Bertrand (1866-1941) est-il un écrivain oublié ? La liste des ouvrages consacrés à cet académicien français prouve que son œuvre ne l’est pas : on étudie l’écrivain pour son style comme pour sa participation à l’algérianisme ; l’écrivain catholique ensuite ; l’homme qui passe d’une révolte individualiste à la promotion de l’ordre national ; enfin le chantre de la latinité qui se rallie à une politique de collaboration avec l’Allemagne. C’est l’objet de ce beau travail collectif.
Comme le note Étienne Meignan, « systématiser les idées de Louis Bertrand [… ] est un exercice difficile » tant ses analyses évoluent. Il faut sans doute tenir compte ici de sa personnalité. Louis Bertrand semble s’être toujours fait une certaine idée de lui-même, et n’hésita jamais à avoir des jugements très tranchés sur les différents courants politiques de son temps ou d’autres écrivains, français ou étrangers. C’est d’ailleurs le cas dans sa thèse de doctorat, relue par Alain Lanavère, dans laquelle il rompt quelques lances avec le milieu universitaire, ce qui lui en fermera les portes.
Au point de s’illusionner sur lui-même ? Parfois sans doute. Bertrand se rebelle contre ces touristes pressés qui disent avoir compris l’Algérie en quelques jours, mais lui-même n’écrira-t-il pas sur une Libye italienne où il n’aura fait que passer ? Il semble aussi avoir cru qu’il pouvait jouer un rôle presque politique, et dans Mes ambassades évoque ses séjours en Espagne durant le premier conflit mondial, ou plus tard en Italie. Mais il n’est en fait bien souvent que manipulé, et fait simplement partie de ces intellectuels que l’on sent proches, pour qui on organise des voyages, et qui, revenus convaincus, défendent les intérêts des pays visités.
Venus constituer un nouveau peuple
Comment ne pas évoquer aussi pour comprendre les choix de Bertrand le choc ressenti par cet homme du Nord face à la lumière du Sud ? La Moselle de son enfance ? Une désolation infinie, une tristesse glaciale, le lac de boue des rues durant l’hiver. Certes, le même auteur évoquera aussi la résistance de cette France des marches aux invasions venues de l’Est, mais on est loin du culte de la petite patrie barrésienne. Il y aura d’ailleurs toujours une opposition entre Bertrand et Barrès : succédant à ce dernier au même fauteuil de l’Académie, notre auteur fera le service minimum dans son discours d’hommage…
Etienne Meignan analyse le classicisme prôné par Bertrand, qui aurait été oublié par l’école romantique comme par les naturalistes. L’académicien regrette aussi l’influence sur le public français d’une littérature étrangère qu’il méprise là encore bien vite – les « grossières histoires d’un simple animalier comme Rudyard Kipling » –, et se plaît à défendre Salammbô. Est-ce parce qu’on y sent le souvenir de la découverte de l’Orient par le Normand Flaubert ? Laure Meesemaecker examine en tout cas la manière dont Bertrand fait de ce dernier celui qui introduit dans la littérature romanesque l’image d’une Afrique latine en train de se reconstruire.
Cette Afrique de Bertrand n’est-elle pas un mythe ? Il est vrai que la découverte des ruines des cités romaines perdues dans les plateaux algériens ou les sables libyens ne peut que marquer, mais Bertrand estime que la colonisation nouvelle va contribuer à la restauration de cette civilisation sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Avec qui ? Jacques Frémeaux s’intéresse à cette Algérie. Ceux que rencontre Bertrand dans les quartiers populaires où il réside sont tous ces Méditerranéens venus constituer un nouveau peuple dont l’énergie conquérante devrait revitaliser la France – car il n’est pas question de l’en séparer. Conséquence au plan littéraire, France-Marie Frémeaux évoque l’algérianisme, courant né en 1920 pour créer un lien « entre l’âme française et les pays colonisés », mais qui serait, selon ses promoteurs mêmes, autant le moyen par lequel cette race neuve prendrait conscience d’elle-même qu’une école littéraire.
Culte de la latinité et classicisme littéraire
Une civilisation en même temps chrétienne. Comme d’autres – on pourrait citer Ernest Psichari ou Charles de Foucauld –, ce contact avec l’Orient pousse Bertrand à retrouver son identité spirituelle propre. Il écrit son Saint-Augustin puis Sanguis martyrum, un roman historique évoquant ce christianisme des confins. Pour lui, la religion est bien l’âme d’une nation, un élément essentiel dans la construction d’une société qui ne peut se fédérer autour des seuls éléments matériels, contrairement aux thèses marxistes qu’il dénonce.
Retour donc à la Rome antique christianisée. Même si Bertrand approuve la politique menée par Lyautey au Maroc, appuyée sur la tradition nationale musulmane, il ne manifeste pas d’intérêt particulier pour les éléments « si typiques » de la vie des musulmans que d’autres visiteurs se plaisent à mettre en exergue, préférant s’intéresser au petit peuple mêlé des Européens algérois. Et contrairement aux frères Tharaud, qui, comme le rappelle Olivier Dard, pensent possible de réconcilier notre civilisation et l’islam, Bertrand ne croit pas que ce dernier ne puisse jamais être autre chose qu’une arme utilisée par les populations locales pour lutter contre le colonisateur occidental.
Nous voici en tout cas loin du jeune Bertrand, individualiste, cosmopolite, dreyfusard, pour qui les nationalistes étaient « des crétins ». Culte de la latinité et classicisme littéraire obligent, notre auteur rejoint peu à peu les thèses maurrassiennes sur l’existence d’un ordre nécessaire qui ne peut être que national, ce qu’Éric Georgin montre dans une analyse fouillée.
Sponsorisée par Goebbels et dénoncée par Maurras
Curieux nationaliste pourtant, qui ne semble jamais penser que le peuple français soit à même d’opérer par lui-même et seul le sursaut nécessaire à sa survie, et qui voit la chance de la France dans la reconstruction en Algérie d’une latinité à laquelle participent Maltais, Italiens, Espagnols surtout, mélange d’où devait naître la nouvelle race de conquérants.
Le même Bertrand envisage ensuite souvent le renouveau français autour d’une alliance dont on se demande si l’on ne s’y fond pas. Elle est d’abord méditerranéenne, avec l’Italie et cette Espagne qui le marquera toujours, pour s’opposer à l’Allemagne. Au temps de l’Italie fasciste, Christophe Poupeau retrouve cette même admiration de la romanité et ce même projet d’une union méditerranéenne. Bertrand adhère donc au comité France-Italie et accepte une invitation en Libye, persuadé de bâtir par ses textes une solidarité nouvelle entre les deux États – mais, en partie au moins, manipulé aussi par un régime qui veut apparaître sur la scène internationale comme un colonisateur civilisé.
Manipulation, c’est plus encore le cas pour l’Allemagne, comme le montre Michel Grünewald. Jeune, Bertrand dénonçait la fascination d’une partie des intellectuels français pour un germanisme qui n’aurait jamais été que l’avatar de cet asiatisme destructeur qui culmine avec la Première Guerre mondiale. Pour autant, dans l’Europe des années 30, c’est la menace communiste qui devient pour ce catholique nationaliste le nouvel asiatisme, implanté en URSS mais qui peut s’étendre demain, et qu’il a vu à l’œuvre en Espagne, et l’Allemagne devient un élément du rempart à dresser contre lui. Bertrand entre alors en contact avec cette « Action internationale des nationalistes » sponsorisée par Goebbels et dénoncée par un Maurras qui voyait bien l’entreprise de subversion. Pris dans le mouvement, Bertrand évoque la « main tendue » de ce caporal qui voudrait la paix, s’oppose à la guerre, mais sa mort, en 1941, interdit de savoir ce qu’aurait pu être son évolution durant la période… Cette diversité de l’œuvre de Bertrand mérite, on le comprend, le sérieux des auteurs de cet ouvrage : elle est l’expression d’aspirations, de doutes et d’espoirs de son époque, qui semblent de plus en plus difficiles à comprendre en un temps où règne un manichéisme réducteur.
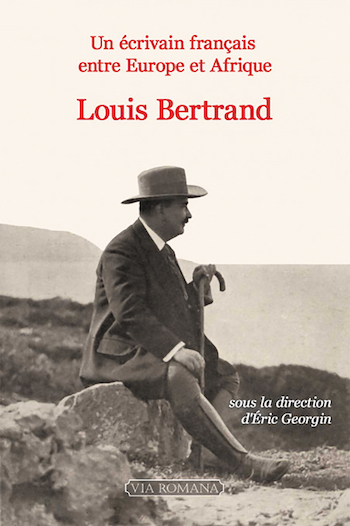 Éric Georgin (dir.), Un écrivain français entre Europe et Afrique : Louis Bertrand, éditions Via Romana, 2022, 280 p. , 25 €.
Éric Georgin (dir.), Un écrivain français entre Europe et Afrique : Louis Bertrand, éditions Via Romana, 2022, 280 p. , 25 €.
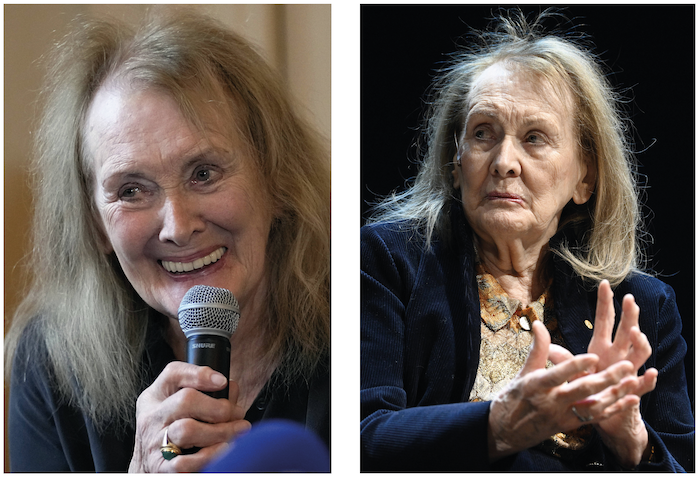


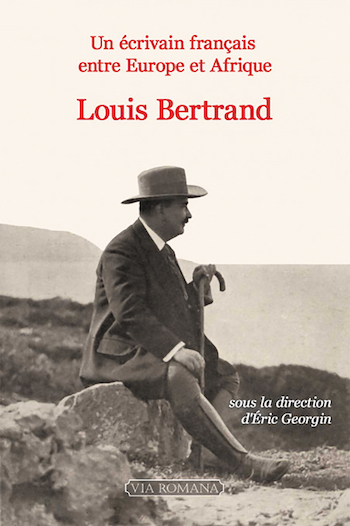 Éric Georgin (dir.), Un écrivain français entre Europe et Afrique : Louis Bertrand, éditions Via Romana, 2022, 280 p. , 25 €.
Éric Georgin (dir.), Un écrivain français entre Europe et Afrique : Louis Bertrand, éditions Via Romana, 2022, 280 p. , 25 €.


