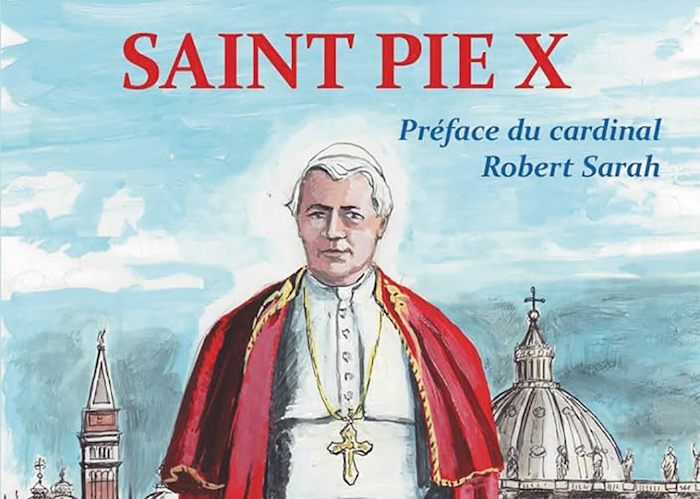Charles Péguy est mort il y a exactement cent ans. Il avait 41 ans. Quatorze ans plus tôt, en 1900, il entamait une œuvre qui allait marquer à jamais l’esprit français. Le jour même où cette œuvre s’est close, le monde a basculé.
La balle allemande qui a tué Péguy le 5 septembre 1914 savait ce qu’elle faisait. Elle signait le certificat de naissance de ce « monde moderne » dont Charles Péguy avait, le premier, annoncé la venue et, le premier encore, dénoncé la férocité. L’Allemagne, mue par des ambitions nationales directement sortie d’un XIXe siècle particulièrement stupide, se faisait sans le savoir l’accoucheuse de ce monde moderne. Un accouchement dans le fer et le sang, marqué par l’éclatement de la Grande Guerre (1914), rapidement suivi du génocide arménien (1915), de la révolution russe (1917) puis de la prise de pouvoir d’Hitler (1933). Comme le disait Engels, le compagnon de Marx, la violence avait accouché de l’histoire.
Mais le véritable moteur de ces évènements était tapi dans l’ombre. Ce n’était pas les Francs-maçons ou les Juifs, les Protestants ou les métèques, moins encore les réactionnaires, les militaristes ou les cléricaux. Le moteur des moteurs, c’était l’argent. Et cela, c’est Péguy qui le premier l’a dit d’une manière claire et appropriée, et que nous pouvons encore entendre aujourd’hui comme une authentique prophétie énoncée dans un langage proche du nôtre. D’autres, certes, en ont eu l’intuition plus tôt. Le plus célèbre est naturellement Marx, qui a intuitivement perçu le rôle moteur de l’argent dans l’histoire. Mais la subtilité de ses analyses mêlées à l’idéologie révolutionnaire l’ont entraîné, et avec lui ses épigones, aux tragiques dérives que l’on sait. Parmi ceux qui ont le plus lucidement pressenti le rôle funeste de l’argent, il faut naturellement citer Maurras, qui avait lui aussi prophétiquement situé cet ordre de réalité dans L’Avenir de l’intelligence dès 1903 : « L’or, divisible à l’infini, est aussi diviseur immense ; nulle patrie n’y résista. » Mais, on le sait, c’est en soldat que Maurras est entré en politique, sa place était sur la dentelle du rempart, à donner et prendre des coups. Lui aussi tombera au front, non d’une balle allemande mais d’une sentence judiciaire française. Deux fois, le « monde moderne » se sera vengé. Mais selon des modalités bien différentes. Maurras continue de traîner son long purgatoire. à Péguy, au contraire, son sacrifice a apporté la gloire.
« Tu les vois mes gars ? Avec ça, on va refaire 93… »
Le destin de Charles Péguy est éclatant de simplicité. Il s’identifie à la revue qu’il avait créée, les Cahiers de la Quinzaine. On considère classiquement, et c’est justifié, que le xxe siècle n’a commencé qu’en 1914. Ce qui laisse comme en suspens ces quatorze années où le siècle précédent n’en finit pas de finir. On pourrait parfaitement les qualifier d’« années Péguy ». Le premier numéro des Cahiers est sorti en janvier 1900 – et le dernier en août 1914 : parfaite coïncidence des dates. Et tandis que le monde, allant à son destin, préparait l’avènement de la modernité, Péguy, œuvre après œuvre, Cahier après Cahier, assumait son propre destin, arrachant à chaque étape, comme le sculpteur se colletant avec la pierre, de nouveaux pans de lucidité, de vérité. Sa transformation spirituelle, ravivant en lui ses racines catholiques, est inséparable de son développement politique qui fit resurgir ses racines nationales. A-t-il évolué ? « Nous avons constamment suivi, nous avons constamment tenu, dira-t-il en 1911, la même voie droite et c’est cette même voie droite qui nous a conduit où nous sommes. Ce n’est point une évolution, comme on dit un peu sottement, employant inconsidérément, par un abus lui-même incessant, un des mots du langage moderne qui est devenu lui-même le plus lâche, c’est un approfondissement. » à Villeroy, près de la Marne, la nuit précédant sa mort, dans une chapelle de campagne, avec un simple bouquet de fleurs des champs, il est venu faire offrande à la Vierge de ces quatorze années de combat. Et d’approfondissement. Un combat incessant, un combat de chaque instant, qui fut d’abord un combat contre lui-même.
Péguy était habité par ce qu’il appelait la mystique révolutionnaire : « Je suis un vieux républicain, je suis un vieux révolutionnaire » dit-il encore en 1913 dans L’Argent. « Sa tête est Révolution », dira de lui Maurras, formule sur laquelle il y a beaucoup à dire, mais que Péguy lui-même n’aurait pas désavouée. La mystique révolutionnaire était pour lui dans la continuité de la mystique d’Ancien Régime et, comme elle, menacée de se dégrader en politique. Elle s’incarnait essentiellement dans le sursaut national face à l’envahisseur, il ne voyait pas de solution de continuité entre Bouvines et Valmy. En 1914, partant au front à la tête de sa section, il disait : « Tu les vois, mes gars ? Avec ça, on va refaire 93… » Dès 1912, dans une lettre à Alexandre Millerand, alors ministre de la Guerre, il écrit qu’il rêvait d’aller défiler avec ses gars à Weimar, en Thuringe, dans la ville de Goethe ! Pour lui, 1793 s’identifiait aux soldats de l’an II, à la Marseillaise de Rude sur l’Arc de Triomphe.
« Le terrible tambour couvrant sa voix »
Mais dans cette vision superbement romantique de la Révolution, il y a quand même un problème, rarement souligné. Au cours de cette si mystique Révolution, il y a eu un épisode qu’on peine à qualifier de mystique et qu’on appelle communément la Terreur. Une grande absente des Cahiers de la Quinzaine. Une absence qui s’apparente à un tabou. Notamment, dans les Cahiers, pas un mot sur la décapitation de Louis XVI. Péguy n’aurait-il pu, par exemple, écrire ceci : « C’est un répugnant scandale d’avoir présenté, comme un grand moment de notre histoire, l’assassinat public d’un homme faible et bon… Les révolutionnaires peuvent se réclamer de l’évangile. En fait, ils portent au Christianisme un coup terrible, dont il ne s’est pas encore relevé… La douceur, la perfection que cet homme, de sensibilité pourtant moyenne, apporte à ses derniers moments, ses remarques indifférentes sur tout ce qui est du monde extérieur et, pour finir, sa brève défaillance sur l’échafaud solitaire, devant ce terrible tambour qui couvrait sa voix, si loin de ce peuple dont il espérait se faire entendre, tout cela laisse imaginer que ce n’est pas Capet qui meurt mais Louis de droit divin, et avec lui, d’une certaine manière, la Chrétienté temporelle. » Le terrible tambour couvrant « cette grande voix », Péguy l’a bien réclamé, mais à propos de Jaurès ! Ces lignes, il aura fallu attendre quarante ans, et deux guerres mondiales, pour qu’un homme « de gauche », Albert Camus, les écrive. Fort connues, elles sont tirées de L’Homme révolté (1951). Si nous les rappelons aujourd’hui, ce n’est que pour tenter d’imaginer la lecture qu’en aurait faite Péguy : personne ne peut prétendre qu’elles l’auraient laissé indifférent. On sait l’expérience personnelle qu’a eue Camus du terrorisme : « à l’heure où nous parlons, dira-t-il en 1957, on jette des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans l’un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ». Qu’est-ce que la même expérience aurait suscité chez Péguy ? Quel « approfondissement » aurait-elle entraîné ? Est-il pensable que sa réaction eût été différente de celle de l’auteur de L’Homme révolté ?
La terreur en question
Ce qui a manqué à Péguy – il est difficile de le lui reprocher – c’est d’avoir lu François Furet. Et aussi Reynald Secher. On ne parlait pas encore de « génocide » à l’époque, mais l’affaire vendéenne était quand même bien connue : pourtant, pas un mot non plus dans les Cahiers… étrange silence. Mis en face du totalitarisme en marche, l’aurait-il assimilé à un simple épisode de dégradation de la mystique en politique ? Comment ne pas imaginer que, s’il avait vécu quelques décennies de plus, Péguy aurait connu, sur ce sujet, le même « approfondissement » que Camus ? C’est à 20 ans que l’auteur des Justes a été durablement bouleversé par la lecture des Possédés de Dostoïevski, qui lui a précisément inspiré cette pièce, Les Justes (1949) : on y voit des terroristes russes mettre en balance le « juste » et nécessaire assassinat du grand-duc Serge et la mort inéluctable de deux enfants innocents qui en résulterait. Avoir lu Les Possédés, voilà encore une expérience qui a manqué à Péguy : on peut pourtant penser à quel point elle aurait été décisive. Surtout, il n’a pu voir fondre la terreur soviétique sur la Russie. Il n’y a pourtant pas totalement échappé. En 1905, le « dimanche rouge de Saint-Pétersbourg » – répression sanglante d’une manifestation populaire, deux ans après le tragique pogrom de Kichinev, l’actuelle Chisinau en Moldavie – lui a inspiré ce texte terrible sur le totalitarisme en marche : « Quand toute une partie de l’humanité, une partie considérable, s’avance douloureusement dans les voies de la mort et de la liberté, quand toute une énorme révolution tend aux plus douloureux enfantements des libertés les plus indispensables par on ne sait combien de sanglants et d’atroces avortements, guerres de peuples, guerres de races, guerres de classes, guerres civiles et plus que civiles, guerres militaires, massacres et boucheries, incendies et tortures, démagogies sanglantes et crimes insensés, horreurs inimaginables, massacres des Polonais, massacres des Juifs, des massacres près de qui ceux de Kichinef n’auront été qu’un incident sans gravité, massacres des Russes, massacres des intellectuels, massacres des paysans, massacres des ouvriers, massacres des bourgeois, monstruosités de tout ordre et de toute barbarie, – et quand nous, peuples libres, peuples libéraux, peuples de liberté, France, Angleterre, Italie, Amérique même, tenues sous la brutalité de la menace militaire allemande, nous sommes contraints et maintenus dans l’impossibilité de rien faire, absolument rien, de ce qu’eussent fait nos pères antérieurs, il y a au moins une pudeur qui interdit le commentaire. » C’est tiré du Cahier 5 de la 7e série, dans un texte intitulé Courrier de Russie, qui laisse à imaginer ce qu’aurait pu dire Péguy devant le Goulag et la Shoah. Aurait-il, comme Camus, fait le lien avec Robespierre ? Impossible de l’affirmer, bien sûr. Mais nous sommes en droit de le croire.
A l’occasion de ce centenaire, on aura parlé des rapports de Charles Péguy avec bien des gens : Jaurès, Bergson, Maritain, Bernanos, Deleuze même… Mais pas un mot sur le plus fondamental des débats : Péguy et Maurras. Un homme s’y est essayé, en 1984, Pierre Boutang. Trente-cinq pages de sa monographie sur Maurras sont consacrées à cette rencontre. Ce serait une œuvre de piété péguyste, plus encore que maurrassienne, de saisir cette occasion de les lire ou relire.