Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
L’Indochine. Ses rizières et ses calcaires ; ses peuples des plaines et ceux des montagnes ; ses fleuves s’écoulant lentement et ses ports de tous les trafics. L’Indochine, et sa guerre.

Une guerre qui a bien moins marqué la population française que celle d’Algérie, qui la suivra, sans doute parce que les calcaires de la RC4 ne parlaient à personne ou presque, pas plus que ces noms aux consonances exotiques – Cao Bang, Kien An, Donh Khé, à l’exception de Diên Biên Phu. Si certains évoquent de temporaires victoires, ils ne sont bientôt plus que les étapes du chemin de croix de nos troupes, mais qui se soucie vraiment en France de ces troupes professionnelles, de ces légionnaires, de ces coloniaux ?
« L’Indo » va par contre profondément marquer ceux qui y font la guerre, et les leçons qu’ils en tireront détermineront une partie de leur choix lors de la guerre d’Algérie. De leurs choix tactiques, bien sûr, après cette confrontation directe avec la « guerre révolutionnaire » : de la contre-insurrection à la guerre psychologique, les doctrines appliquées quelques années plus tard dans les mechtas ou à Alger sont nées en Indochine – et parfois jusque dans ces camps de prisonniers où le communisme cherchait à briser les hommes. Mais de cette guerre et des conséquences de cette défaite viendront aussi certains choix faits en 1961, quand des militaires choisiront de renoncer à leur devoir d’obéissance pour rester fidèles aux serments faits aux populations locales, le souvenir de l’abandon des partisans et des populations d’Indochine leur étant toujours une souffrance.
Comment faire comprendre « l’Indo », comment saisir ce que furent ces presque dix années de guerre, de 1945 à 1954 ? On peut pour cela écrire un roman – Les Centurions –, ou tourner un film – La 317e section. En un millier de pages, La guerre d’Indochine – Dictionnaire est fidèle à son titre : c’est bien un dictionnaire traitant de la guerre d’Indochine, un dictionnaire technique et, comme tel, un outil de travail incomparable ; mais c’est aussi « l’Indo » qui émerge lentement, par petites touches, au travers des notices de ce dictionnaire, et c’est comme tel une œuvre de mémoire. D’« Adaptation » à « Zone nord », les quarante-six auteurs réunis ici évoquent en effet toutes les perspectives qui, croisées, donnent à voir et à comprendre le moment : les lieux, les hommes, les matériels, le contexte politique, le cadre international, les mots, les chansons…
Les hommes ? Ce sont les militaires, bien sûr, formés au moins autant dans la Résistance que dans l’armée d’active. Ceux qui moururent, au combat – le 1er BEP perd 94,4 % de son effectif à Coc Xa –, ou dans les camps de prisonniers – le taux de mortalité y aura été, en moyenne, de 42 % –, épuisés par les conditions des marches ou de l’internement. Ceux aussi qui survécurent et combattirent souvent plus tard en Algérie. On croise donc, au fil des notices, Jeanpierre, Cabiro, Raffali ou Vandenberghe, les deux de Lattre et de Castries, Château-Jobert, Faulques, Hogart ou Galula. L’État-Major, les futurs théoriciens de la guerre révolutionnaire, les chefs de commandos et les « maréchaux de la légion » pour reprendre un titre à Pierre Sergent, alors présent comme officier au 1er BEP, comme Erwan Bergot, qui n’avait pas encore donné son nom à un beau prix littéraire.
Les hommes, ce sont aussi ceux qui, d’une manière ou d’une autre, vont rendre compte du conflit, ce sont ces correspondants ou écrivains frappés, comme les militaires, par cette nostalgie si particulière qu’est le « mal jaune ». Voici Lucien Bodard et Jean Hougron, Jean Lartéguy et Pierre Mac Orlan, Pierre Schoendoerffer aussi, bien sûr – avec pour ce dernier deux entrées particulières, pour Le Crabe-Tambour et La 317e section. On traite encore dans ce dictionnaire de littérature, de chansons ou de cinéma – même si, et ce sera bien un des nos rares regrets, on n’y fait pas mention du superbe « docufiction » de Patrick Jeudy, Les quatre lieutenants français.
Les hommes, ce sont encore les Indochinois, leurs peuples, ceux des montagnes, « Là haut », comme ceux des plaines ou du Mékong. Ce sont les Méos, les Moï, les Thaï. Ce sont leurs sectes (Cao Daï, Hoa Hao), leurs pirates, leurs commandos. Et du mélange de ces deux groupes, l’indochinois et l’occidental, naît par exemple le sabir utilisé par les troupes – congaï, Can-Bo, Nha Que –, comme ce folklore – la « rue sans joie », le « parc à buffles » –, que magnifie le rythme lent des chansons de Pierre Mac Orlan, Marie Dominique, ou Opium, avec sa « mystérieuse et sournoise » jonque chinoise où l’on vient rêver dans les volutes de fumée.
Savent-ils bien ce qu’ils font là, ces hommes qui marchent et qui meurent en Indochine ? Le dictionnaire, lui, nous rappelle le contexte géopolitique, le rôle de la Chine, mais aussi celui, bien ambigu, des États-Unis. Il nous rappelle aussi le contexte politique national de l’intervention, les prises de position des intellectuels, les atermoiements des chrétiens progressistes, le rôle du parti communiste, bien sûr, et, parmi ses membres, réserve une notice au sinistre Georges Boudarel, « instructeur politique » au camp 113 devenu ensuite… spécialiste du Vietnam dans l’université française.
Mais de tout cela, ils ne savent sans doute pas grand chose ceux qui passent de « Camargue » en « Citron », de « Mandarin » en « Thérèse » ou en « Vautour », au gré de l’inspiration de l’État-Major pour nommer les opérations dans lesquelles ils sont engagés. Le dictionnaire évoque avec précision nombre de leurs unités d’appartenance, de leurs engins (engins fluviaux, Morane 500, DC3), et quelques-uns de ces postes qui jalonnaient les itinéraires, routiers ou fluviaux, et étaient autant de cibles. Mais nos hommes se contentent chaque jour de marcher, sur les diguettes des rizières ou dans la jungle. Ou d’attendre, dans leurs petites casemates, au milieu des supplétifs indigènes, un ennemi qui ne vient pas pendant des mois, mais peut les submerger en quelques heures.
Ailleurs, on se pose la question des tactiques à employer face à cet ennemi diffus, qui a vite compris qu’il doit refuser un affrontement direct qui lui est défavorable, et qui, sans états d’âme, sait ne pas s’embarrasser de ses blessés comme le firent, pour leur perte, les colonnes françaises de la RC4. Repli sur le « delta utile », ou contrôle des frontières lointaines ? Emploi de l’artillerie, et des bombardements, ou éparpillements de petits groupes de commandos ? Peut-on amener le vietminh au combat par des forces projetées implantées dans des « hérissons » et le briser ainsi ? À Na San, en novembre 1952, Giap échoue dans son attaque et perd 3.500 hommes. Mais un an et demi après, en mars 1954, ses pertes énormes – entre 10.000 et 20.000 tués et blessés – lui permettent de l’emporter dans une autre cuvette, celle de Diên Biên Phu. Pour nos troupes, on comptera 7 000 tués, blessés ou disparus sur Anne-Marie, Béatrice, Claudine, Dominique, Éliane, Gabrielle, Huguette, Isabelle ou Junon ; et près de 10 000 prisonniers, dont 60 % mourront dans les camps.
Trois mois après la chute de ce camp retranché dont Jean-Pax Méfret chantera plus tard le souvenir – le texte de sa chanson est dans la notice –, le 21 juillet 1954, le cessez-le feu est signé à Genève. Sur le Pasteur, les survivants voient s’éloigner un rivage qu’ils n’oublieront pas. C’est tout le mérite, nous le disions, de ce superbe ouvrage, riche, clair, précis, dont le foisonnement se découvre par petites touches, que, non content de nous offrir des éléments de compréhension et d’analyse géopolitique et stratégique d’un conflit important, il puisse aussi nous en rendre l’ambiance et parvenir à nous faire comprendre ce qui se cache derrière « l’Indo », ce mot de passe de toute une génération.
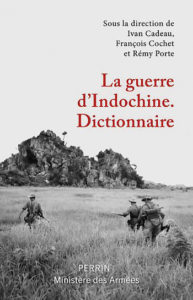 Sous la direction d’Ivan Cadeau, François Cochet et Rémy Porte, La guerre d’Indochine. Dictionnaire, Paris, Perrin/ministère des Armées, 2021, 35 €.
Sous la direction d’Ivan Cadeau, François Cochet et Rémy Porte, La guerre d’Indochine. Dictionnaire, Paris, Perrin/ministère des Armées, 2021, 35 €.