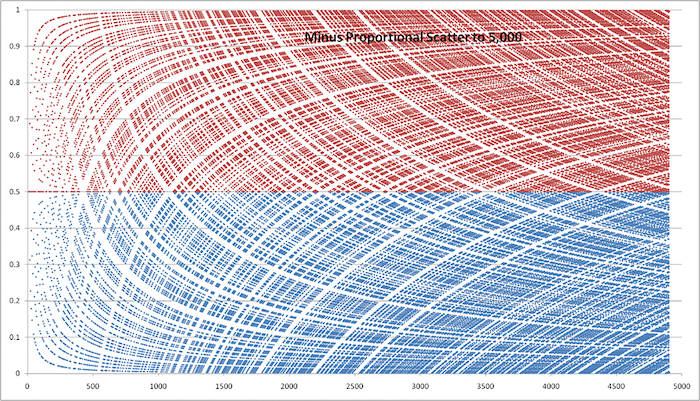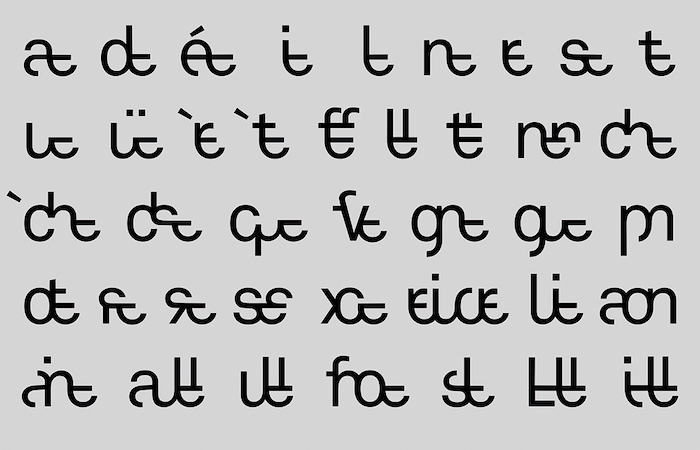Le mouvement Black Lives Matter en France suppose qu’on peut importer en France des concepts américains sans pertinence historique locale – ce qui ne signifie pas qu’ils ne soient pas dangereux pour le corps social français. On voit aussi à la lumière de ce mouvement que le séparatisme n’est pas exclusivement le fait de l’Islam mais aussi celui de la pensée postcoloniale et indigéniste qui se diffuse au sein des structures officielles (université, musées, etc.).
L’ethnie plus que la race
Partons du commencement : la question noire. Y a-t-il une question noire en France ? Les Noirs aux États-Unis sont présents sur le sol depuis les premiers moments de ce pays. Issus de l’esclavage, ils ont développé une culture originale mais ont oublié leur culture d’origine : s’ils sont des « afro-descendants » ou des « Afro-Américains », ils n’ont plus grand chose d’africain. En France, c’est le contraire. L’immigration de personnes noires est beaucoup plus récente et, de fait, les questions ethniques ou culturelles y subsistent – à la différence des États-Unis où elles n’ont aucun sens.
C’est ce que confirme un article du New-York Times du 15 juillet 2020, « Une prise de conscience raciale en France, où le sujet reste tabou ». « En France, en grandissant, Maboula Soumahoro ne s’était jamais considérée comme Noire. Chez elle, ses parents immigrés mettaient l’accent sur la culture Dioula, du nom d’un groupe ethnique musulman de Côte d’Ivoire. Dans son quartier, elle s’identifiait comme Ivoirienne auprès des autres enfants d’immigrés africains. »
Il n’y a rien de plus logique. En France, les femmes noires portent des boubous ou des robes en wax. C’est le signe d’une immigration récente. De même, on y trouve des restaurants sénégalais, ivoiriens, éthiopiens, car les personnes présentes en France ne sont pas des « afro-descendants », ils ne sont pas « d’origine africaine » comme aux États-Unis, mais viennent d’un pays et relèvent d’une ethnie. De fait, il n’y a donc pas de solidarité noire comme aux États-Unis. C’est ainsi que, jeune, Maboula Soumahoro s’identifiait comme Ivoirienne auprès des autres enfants d’immigrés africains. Identification qui serait impossible aux États-Unis.
L’influence américaine
La suite de l’article est passionnante car on y voit que Maboula n’a pas été imprégnée d’une culture française mais américaine. Elle nous parle de Whitney Houston, de Michael Jackson, du Cosby Show et du hip-hop en indiquant au journaliste que cela lui avait « fait rêver d’être cool comme des Africains-Américains ». Dès lors, elle se mit à ressentir une affinité raciale avec ses amis. C’est là un phénomène qui s’observe fréquemment : les jeunes issus de l’immigration ont souvent une attitude ambivalente vis à vis de leur pays d’origine. Les jeunes d’origine maghrébine dénigrent volontiers les blédards, et ceux issus d’immigration subsaharienne font de même. Si les parents ont souvent un positionnement ethnique (les parents de Maboula se définissent comme relevant de l’ethnie Dioula), leurs enfants adoptent un positionnement racial : Maboula se pensera ivoirienne avant finalement de se rêver Afro-Américaine.
Davantage que l’importation du mouvement Black Lives Matter, ce qui participe de l’importation en France de la question raciale, c’est évidemment la musique, l’esthétique, le cinéma. Bref : la culture afro-américaine. Il n’est qu’à voir les tonnerres d’applaudissements acclamant la sortie de Black Panther, film sans intérêt. Pour quelqu’un qui se rêve américain, ressentir dans sa chair une indignation pour la mort d’un quidam à Minneapolis, partager le même hashtag que Jay-Z ou Beyonce, c’est entériner une acculturation américaine. Le New-York Times confirme sans en avoir honte le moins du monde que cette importation est le résultat d’une politique volontaire de la part des États-Unis.
Aujourd’hui, ceux qui remettent en cause cet idéal avec sans doute le plus de véhémence sont des Français noirs dont la conscience raciale s’est éveillée ces dernière décennies — aidés en cela par la culture populaire des États-Unis, par ses penseurs, voire même par ses diplomates à Paris qui repéraient et encourageaient des jeunes leaders français et noirs il y a une dizaine d’années.
Au-delà de la culture populaire, on cite donc le soutien des diplomates américains. C’est un fait établi. Plus loin, le New-York Times enfonce le clou et le confirme une nouvelle fois : « L’ambassade américaine à Paris s’est mise à tendre la main aux minorités ethniques et raciales françaises après les attaques du 11 septembre, dans le cadre d’une politique internationale pour “gagner les cœurs et les esprits”. L’ambassade proposait des programmes éducatifs sur des sujets comme la discrimination positive — un concept tabou en France — et réussissait à atteindre pour la première fois un public de Français non-blancs, explique Randianina Peccoud, qui supervisa ces progammes à l’ambassade et qui a pris sa retraite l’année dernière. »
L’ingérence américaine
Le débat public donne depuis longtemps la parole à des militants qui cherchent à importer en France les conceptions raciales et communautaires qui ont cours aux États-Unis. C’est par exemple le cas de Maboula Soumahoro, diplômée de Columbia, spécialisée en « French diaspora studies », proche du Parti des Indigènes de la République et régulièrement invitée sur France Culture. C’est le cas de Rokhaya Diallo qui déclarait en 2010 que « La France a beaucoup à apprendre des États-Unis en matière de diversité ». On oublie cependant de rappeler que madame Diallo était allée aux États-Unis grâce à l’International Visitor Leadership Program (IVLP), un programme américain créé après-guerre et qui permet à de « jeunes leaders dans leurs domaines » d’être accueillis dans le Nouveau Monde. Le rappeur Ekoué Labitey ou Fayçal Douhane, le sous-préfet de Seine-Saint-Denis, avaient eux aussi bénéficié de ce dispositif. Vous l’ignorez peut être mais, chaque année, la totalité du budget des public affairs de l’ambassade américaine en France est consacré aux banlieues françaises. Cela représente trente personnes chargées des affaires culturelles et des relations presse qui sont employées pour assurer aux États-Unis une place dans l’imaginaire des banlieues. Cette information ne vient pas de blogs conspirationnistes mais d’un article remarquablement bien documenté que Thomas Poupeau avait publié le 30 décembre 2019 dans Le Parisien.
Les investisseurs américains ne sont pas à la traîne de l’ambassade. C’est ainsi que la banque d’affaire américaine JP Morgan va investir 30 millions de dollars sur cinq ans dans les quartiers populaires d’Île-de-France, dont 26 pour le seul 93. La nouvelle avait fait l’objet d’un article dans Marianne en janvier 2019 signé d’Erwan Seznec. On y apprenait qu’il existe un programme baptisé Advancing Cities, doté de 500 millions dollars, et qui permettait à la banque de faciliter l’accès des quartiers populaires aux opportunités économiques. Les investissements de JP Morgan bénéficient notamment à Mozaïk RH, un cabinet de recrutement créé par le français Saïd Hammouche et destiné à faire des jeunes de banlieues des startupers à l’américaine. Ces projets soutenus par l’ambassade américaine rejoignent les aspirations d’un Majid El Jarroudi, un entrepreneur français, qui a fondé l’Agence pour la Diversité, et voit dans le 93 un « département monde », connectés avec tous les pays, et dont le multiculturalisme est un atout qu’il faudrait encourager pour booster l’économie française. Passé à En Marche, Majid El Jarroudi eut l’oreille d’Emmanuel Macron qui, en septembre 2017, vantait le « territoire le plus jeune et le plus innovant de France ». Les investissements massifs – chiffrés en milliards – qui doivent avoir lieu pour les Jeux Olympiques découlent de cette conception d’un territoire que l’on rêve une enclave américaine à côté de Paris. En mai 2018, La Croix s’enthousiasmait avec Macron qui, lorsqu’il annonça ses mesures en faveur des quartiers prioritaires, révéla que la banlieue serait une zone test de la fameuse start-up nation.
Argent, coteries, programmes, investissement, rencontres… les Américains ne peuvent pas se permettre de bombarder la Syrie sans avoir une bonne image dans les banlieues. Ils préfèrent investir et soigner l’image de la Maison Blanche. Ne se cachant pas de voir le 93 comme un territoire musulman, ils ont décidé, à la suite du 11 septembre, d’en faire un territoire à conquérir. Plus de dix ans après, les États-Unis récoltent les fruits de leurs investissements. Camelia Jordana chante un slogan des Black Panthers dans une manifestation parisienne, des jeunes français s’agenouillent et s’approprient les slogans américains, nos intellectuels de gauche s’engouffrent dans les concepts d’importation comme celui de l’appropriation culturelle, du privilège blanc, de la blanchité, du “blackface” et la commune libre de Tolbiac a voulu importer l’aberrante expérience universitaire d’Evergreen au cœur du 13e arrondissement. Bref : ce n’est pas le séparatisme islamique qui est le seul problème mais l’importation artificielle et concertée de questions raciales avec le soutien des autorités françaises à l’arrivée massive du postcolonial.
Illustration : Assa Traoré, l’Angela Davis au rabais, en pleine représentation d’afro-américanisme victimaire.
Le costume des militants anti-négrophobie
Lors de son action du 12 juin au Quai Branly – une tentative de vol pour rendre aux Africains ce que les colonisateurs leur ont volé (sic) –, Mwazulu Diyabanza, « syndicaliste panafricain et révolutionnaire engagé dans la cause de la liberté du peuple noir et de la libération de sa mère-patrie Afrique », portait un abacost et un béret des Black Panthers. Ces signes qu’il envoie à sa communauté ne nous parlent pas mais ils sont pourtant très éloquents.
L’abacost est un costume dont le nom vient de « à bas le costume ». C’est au Zaïre, à partir des années 1970, que Mobutu imposa le port de ce vêtement. L’ex-militaire devenu dictateur, qui régna sur la République démocratique du Congo durant plus de trente ans, souhaitait bannir de son pays le costume, alors considéré comme un symbole de la colonisation. On inventa donc un veston sans col et à manches courtes ou longues. Jusqu’en 1990, le port de l’abacost était obligatoire au Congo, en remplacement du costume. Porter une cravate faisait également de vous un « mundele ndombi », expression que l’on peut rapprocher du « nègre de salon » de Malcom X[1]. Aujourd’hui, l’abacost est un costume qui véhicule une imagerie anticoloniale et anticapitaliste.
Le béret noir faisait partie des accessoires des Black Panthers. Ce fut dans les années 1960 que deux leaders du mouvement, Huey P. Newton et Bobby Seale, visionnèrent un film sur les résistants français de la Seconde Guerre mondiale. Séduits par leurs bérets, ils adoptent le couvre-chef en 1966. L’esthétique paramilitaire cultivée par les membres du « Black Panther Party for Self-Defense » est déjà une mise en scène politique. Le béret noir renvoie à la logique de « l’autodéfense ». Proche des idées du nationalisme noir de Malcolm X, révolutionnaires, anti-capitalistes et anti-impérialisme, les Black Panthers se constituent des milices afin de lutter contre les violences policières. Si le combat de Martin Luther King était pacifique, la prise d’armes des Black Panthers en constitue le contrepoint radical. Ils furent ainsi à l’origine de « Patrouilles d’alerte des citoyens noirs » et d’affrontement avec la police.
À la sortie de la garde à vue de Franco Lollia, porte-parole des Brigades anti-négrophobie (BAN), Mwazulu Diyabanza portait à nouveau un abacost de couleur jaune quand Franco Lollia, lui, portait une panthère noire sur son t-shirt des BAN. De son côté, lors de ses apparitions, Egountchi Behanzin, le chef de la Ligue de défense noire africaine (LDNA) privilégie le port du dashiki, veste yoruba que portaient également les militants du Parti des Black Panthers. Des figures historiques du parti comme Huey P. Newton et Stokely Carmichael ont parfois associé le dashiki à une veste en cuir noir. Le vêtement renvoie un message politique : celui du nationalisme culturel. Il s’agit d’une invention proche de l’abacost de Mobutu mais relevant de la Diaspora, l’ensemble des populations noires descendantes d’esclaves ou immigrées.
[1]. Cet usage politique du vêtement explique que la diaspora congolaise qui s’opposait à Mobutu ait imaginé une autre façon de se vêtir. C’est ainsi que certains ont voulu privilégier le costume occidental des grands couturiers, et notamment les tissus les plus bariolés et luxueux. Ils font partie de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, plus connue sous l’acronyme SAPE. Les sapeurs ont voulu montrer qu’on pouvait avoir une identité africaine tout en s’appropriant les vêtements des blancs. Ces dandys se croisent à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement.