Tribunes

Que faire ?
Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
L’affaire Matzneff pourrait être l’occasion de redécouvrir la différence essentielle qui existe entre la liberté et la licence
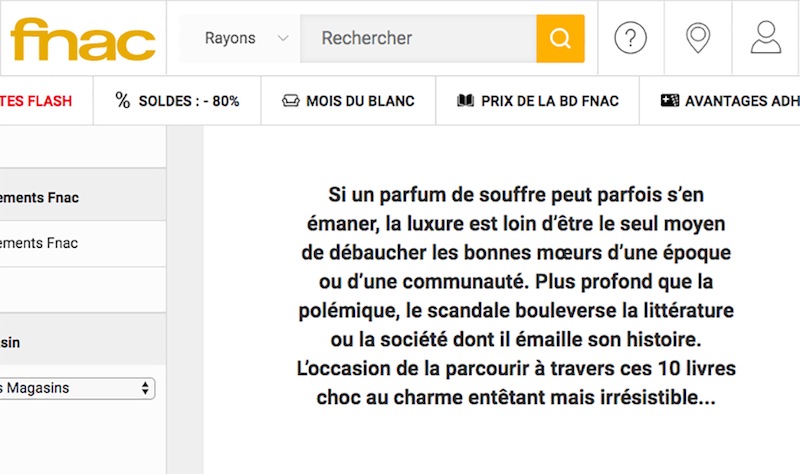
L’affaire Matzneff, qui depuis quelques semaines a mis en ébullition les trois rues qui font le tout-Paris, aurait pu être l’occasion de remettre en question un préjugé particulièrement bien ancré et délétère, à savoir l’idée que les « artistes » devraient bénéficier d’une liberté d’expression quasi-illimitée.
La particularité de l’affaire Matzneff, en effet, est que l’intéressé ne s’est pas contenté – de son propre aveu – de se rendre coupable (au minimum) d’atteintes sexuelles sur mineur (un délit puni théoriquement de sept ans de prison et 100 000 euros d’amende) mais aussi qu’il s’est publiquement vanté de ses délits et ce à de multiples reprises et sous de multiples formes, notamment dans ses livres. Avec Gabriel Matzneff il n’est donc pas seulement question de pédophilie mais aussi d’apologie de la pédophilie.
Et le problème n’est donc pas seulement que, jusqu’à maintenant, il n’a jamais été inquiété pour des délits qui étaient de notoriété publique, il est également que ses écrits faisant l’apologie de la pédophilie ont été publiés, diffusés, qu’ils ont contribué à sa notoriété en tant qu’écrivain, et qu’ils continuent à être défendus au nom de la « liberté artistique ». Condamnons l’homme, s’il est avéré qu’il a commis des crimes, mais ne touchons pas à ses écrits. Telle est à peu près aujourd’hui, me semble-t-il, la position par défaut chez la plupart de ceux qui se soucient du sort de l’auteur des Moins de seize ans – un très petit nombre de gens, il est vrai, mais les questions de principe que posent cette affaire sont d’intérêt public.
Cette position repose sur l’idée que les productions « artistiques » se situeraient par-delà Bien et Mal et ne devraient être jugées que sur des critères « artistiques » (quoi qu’ils puissent être) et non pas en fonction de considérations morales et politiques. Ou, pour le dire autrement, il est illégitime pour le législateur de chercher à protéger ce que l’on n’ose plus appeler (et ce seul fait est révélateur) « les bonnes mœurs » contre ce qui pourrait les attaquer.
Une telle position est extrêmement contestable, et mériterait pour le moins d’être interrogée. Rappelons quelques points saillants à ce sujet, pour lancer le débat.
Premièrement, jusqu’à une époque somme toute très récente, en Occident, le régime ordinaire était celui de la censure, c’est-à-dire qu’il était communément admis que les gouvernants pouvaient légitimement interdire l’expression des opinions qu’ils estimaient dangereuses pour la collectivité, pour une raison ou pour une autre. Et cette position n’était pas défendue seulement par les gouvernants – qui après tout, en cette matière, sont juges et parties – mais aussi par les plus grands philosophes, ceux dont l’on pourrait penser qu’ils devraient être le plus attachés à cette liberté. Socrate lui-même – saint patron des martyrs de la liberté de paroles – n’a jamais remis en question le bien-fondé des lois en vertu desquelles il a été condamné.
Deuxièmement, le principe de la liberté de paroles qui s’est peu à peu imposé en Occident à partir de la fin du XVIIIe siècle n’a jamais été conçue comme une liberté illimitée. Les inventeurs du concept de la « liberté de paroles » n’avaient nullement renié l’idée qu’il appartient au législateur de réguler l’expression publique des opinions. Ils comprenaient simplement cette régulation d’une manière différente de celle des partisans de « l’Ancien Régime ». Et, notamment, la répression des abus a posteriori leur semblait préférable à la censure préalable.
Au lieu de devoir solliciter la permission de censeurs avant de publier, censeurs qui opéreront dans le secret de leur cabinet et sans règles fixes et connues de tous, les citoyens peuvent s’adresser librement à leurs compatriotes mais pourront être punis après un procès public et équitable, et de préférence par un jury composé de leurs pairs, s’ils ont franchi les limites tracées par la loi.
Ces limites sont, dans les grandes lignes, celles nécessaires pour protéger les droits et l’honneur d’autrui et sauvegarder l’ordre public.
Ainsi, en France, la grande loi de 1881 qui fixait le régime de la liberté de la presse et qui, pendant longtemps, est restée le cadre essentiel délimitant la liberté de paroles, assure aux individus une protection contre l’injure et la calomnie. La législation prohibe également l’atteinte à la vie privée et réprime les discours incitant à la commission d’infractions ou mettant en danger la vie et la sécurité des personnes. Elle protège enfin, ou elle protégeait, ce que l’on appelait encore à cette époque la moralité publique.
Ces limites ne sont pas propres à la France. Les auteurs du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis n’avaient pas une conception différente de la liberté de paroles de celle des auteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et les lois et la jurisprudence américaines traçaient, grosso modo, les mêmes limites à cette liberté que les lois et la jurisprudence françaises sous la Troisième République.
Troisièmement, ces limites s’appliquent à toutes les formes de publication ou d’expression publiques, y compris donc bien sûr les œuvres littéraires, cinématographiques ou autres. Les œuvres d’art ont une puissante influence sur notre sensibilité, sur nos opinions, sur nos mœurs (ce que Tocqueville appelait « les habitudes du cœur »), ce serait donc une pure folie que de les situer par-delà Bien et Mal, car elles ont de fait, ou peuvent avoir, des effets moraux et politiques très importants. Les artistes ne peuvent pas réclamer de la communauté politique dans laquelle ils vivent un droit illimité à publier ce qu’ils veulent, y compris si ce qu’ils publient attaque les fondements moraux ou politique de cette communauté.
Quatrièmement, contrairement à ce qui passe aujourd’hui pour une vérité d’évidence, les « bonnes mœurs » ne sont pas particulièrement difficiles à définir dans leurs grandes lignes. Les bonnes mœurs sont celles qui font d’un être humain un être civilisé et qui lui permettent de faire un citoyen acceptable dans un régime libre. Qu’est-ce donc que les « bonnes mœurs » ? Le respect de la loi, le respect des droits et de la dignité d’autrui, le respect de la parole donnée, le sens du devoir, la capacité, lorsque cela est nécessaire, à subordonner ses intérêts particuliers au bien commun. Bref, le noyau des « bonnes mœurs » est tout simplement la modération ou, pour reprendre la phrase célèbre du père d’Albert Camus : « Un homme, ça s’empêche ». Par conséquent tout ce qui promeut ouvertement l’immodération attaque les bonnes mœurs. Cela est particulièrement vrai en matière de sexualité, car la sexualité est une passion puissante, et très séduisante, qui peut provoquer des dégâts considérables, individuels et collectifs, lorsqu’elle est débridée.
À partir de quand avons-nous oublié cela ? Quand avons-nous cessé de comprendre qu’honorer certains comportements, certaines mœurs, certaines manières d’être en les représentant de manière artistique et séduisante revenait implicitement à les glorifier et à les promouvoir ? Rome n’a pas été détruite en un jour, et il y eut des étapes, qu’il n’est ni possible ni utile de retracer ici.
Comme presque toujours en la matière, les germes de décomposition furent introduits non pas par le grand public mais par des membres de ce que l’on peut appeler la république des lettres : ceux qui tirent l’essentiel de leurs revenus et de leur réputation de leur plume, ou aujourd’hui de son équivalent numérique.
Selon la loi psychologique qui veut que plus un phénomène désagréable diminue et plus ce qu’il en reste est perçu comme insupportable, nombre d’artistes et « d’intellectuels » se mirent à aspirer à une liberté dépourvue de responsabilité. Ils firent campagne pour que les nécessités de l’ordre public et les normes de la moralité s’effacent devant le droit imprescriptible de « l’artiste » ou du « penseur » à s’exprimer sans aucune retenue. Aujourd’hui comme hier une bonne partie des membres de cette république des lettres répondaient aussi à la description que faisait Rousseau de ses amis « philosophes », lorsqu’il remarquait qu’il suffirait de les reléguer parmi les athées pour les ramener au pied des autels. C’est-à-dire que bien des auteurs aspiraient ardemment à pouvoir ouvertement choquer le bourgeois sans avoir à subir les foudres de la loi bourgeoise, à la fois pour des motifs de vanité et par intérêt bien compris, car il y avait là un marché prometteur à investir.
Cette campagne a été couronnée de succès et, en gros, depuis les années 1960, les littérateurs, entre autres, ont bénéficié d’une liberté de publication pratiquement absolue. Même les écrits du marquis de Sade peuvent désormais être publiés et diffusés sans contrainte, et, si Sade peut être publié, assurément tout peut être publié. Mieux, Sade a intégré la collection de La Pléiade en 1990 : l’apologie du crime et de la dépravation, sous ses formes les plus extrêmes, peut désormais trôner en édition de prestige dans toutes les bibliothèques.
Les littérateurs, les « artistes » de manière générale, ont été satisfaits, de même, peut-être, que ceux dont la littérature (ou l’art) est la passion dominante dans l’existence. Mais collectivement, qu’y avons-nous gagné ? Se pourrait-il qu’il existe un rapport entre cette licence quasi-totale accordée aux « artistes » et les flots de vulgarité, d’obscénité et de brutalité qui nous assaillent quotidiennement, dans la littérature, la musique, le cinéma, la télévision, sur internet, par tous les moyens disponibles ? Et se pourrait-il qu’il existe un rapport entre ce flot incessant de vulgarité, d’obscénité, de brutalité et certaines caractéristiques problématiques de nos sociétés ? Par exemple l’effondrement de la structure familiale, la disparition de la civilité ordinaire, la diffusion de l’hédonisme le plus vulgaire, qui se marque entre autres dans l’usage toujours plus répandu des stupéfiants, des rapports entre les sexes souvent consternants de vulgarité, de violence et de superficialité, et ainsi de suite ?
Se pourrait-il même qu’il existe un rapport entre cette démission de la loi – entre la transformation de la liberté en licence – et la demande croissante de censure que nous voyons monter au sein de la société civile et qui, à la différence du régime légal de responsabilité a posteriori, s’exerce de manière arbitraire et sans recours possible ?
Serions-nous, par hasard, en train de vérifier la vérité de cet axiome de la science politique : la licence mène au chaos, et le chaos mène à la tyrannie ?
L’art lui-même y-a-t-il gagné ? C’est un préjugé courant d’affirmer que la censure est mauvaise pour les arts ; mais si cela était le cas, l’héritage artistique de l’humanité devrait être bien faible et nous devrions vivre dans un âge d’or artistique. Le moins que l’on puisse dire est qu’une telle description semble en léger décalage avec la réalité que nous connaissons. Toutes ces questions mériteraient d’être considérées à nouveau.
La liberté ne va pas sans responsabilité, et ceux qui entreprennent de s’adresser au grand public prennent une grande responsabilité. Les limites posées traditionnellement à la liberté d’expression, en dépit de leurs inévitables inconvénients – bien réels – étaient du moins un hommage rendu à la puissance des idées et à la puissance de l’art : les idées ont des conséquences, les œuvres d’art ont des conséquences. Nos artistes et nos intellectuels l’ont trop souvent oublié dans un passé récent et trop souvent se sont conduits de manière frivole et inconséquente. Il serait sans doute temps pour nous de prendre l’art à nouveau au sérieux et de redécouvrir pourquoi une liberté bien tempérée est infiniment préférable, à tous points de vue, à une liberté sans frein.

« Sade, l’écrivain et philosophe libertin, est plus vivant que jamais. En témoigne, si besoin en était, son inscription, à la faveur de ce bicentenaire, au très officiel registre des célébrations nationales de l’année 2014. » Télérama.