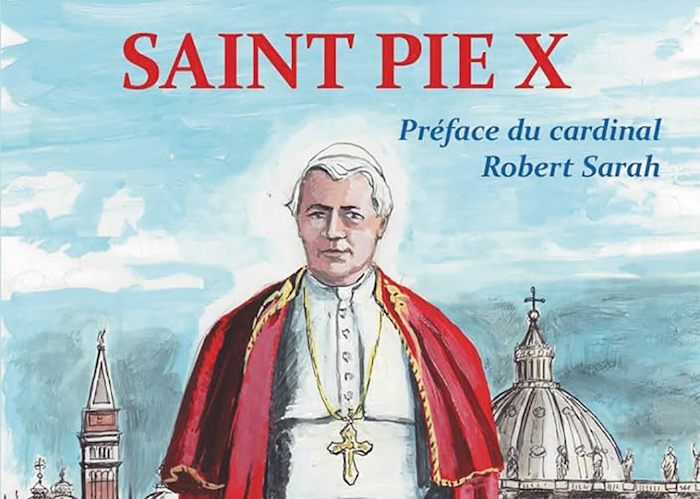Né en mars 1830 peu avant une révolution, Numa-Denys Fustel de Coulanges mourut en 1889 durant le centenaire d’une autre. La révolution, ou son spectre, marqua son existence. Son père, fils de l’ancienne aristocratie militaire, mourut en 1832, probablement sur les barricades, dans le camp insurgé. Sa mère était issue de cette petite bourgeoisie bénéficiaire discrète des événements du demi-siècle précédent.
Numa-Denys grandit dans le Paris de Louis-Philippe traversé par l’émeute. C’est en victime d’un coup d’État, celui de Louis-Napoléon, qu’il passa ses années d’élève à l’École normale supérieure, dans un contexte de surveillance des études par le pouvoir.
Contemporain d’historiens romantiques théoriciens des ruptures et des révolutions, comme Augustin Thierry et surtout Michelet, il aurait pu se mettre à leur école. Ce fut l’inverse.
Un historien précurseur du temps long et des continuités
Dès ses thèses latine (sur le culte de Vesta à Rome), et française (sur le parcours de l’auteur grec Polybe), Fustel apparut en chercheur du temps long, des continuités et des signes d’unité. Son goût pour la superstructure plutôt que l’événementiel quotidien, pour les institutions sociales et religieuses davantage que les batailles l’éloignait du fracas de ce qu’il appela les « fausses révolutions ».
L’historien François Hartog remarquait que cette manière de penser l’histoire le plaçait en porte à faux avec ses contemporains. Fustel était à la fois solitaire et représentatif d’une école historique montante, libérale, républicaine, et critique sur la démocratie et les événements révolutionnaires.
Deux événements permettent de déterminer ce paradoxe.
Le premier, en 1864, est la publication de La Cité antique. Fustel, professeur à l’université de Strasbourg depuis quatre ans, publiait un essai historique sur les institutions de la cité grecque et latine. La thèse était simple : la cité antique fonde son principe sur une idée religieuse. Les mutations de celle-ci expliquent celles de la cité. La disparition du culte ancien éclaire la décadence de la cité et son évolution vers un monde chrétien au sortir de l’antiquité. La méthode est à la fois implacable, fondée sur l’étude de tous les textes sources disponibles en 1860-1864, et déroutante, puisqu’à partir de ces textes de l’époque classique ou hellénistique, Fustel cherche des explications dont l’origine est antérieure à l’époque archaïque. De ces documents épars, il tire un système à la régularité impeccable. Bien accueillie, La Cité antique donne à son auteur une renommée qui le fait remarquer des milieux ministériels et lui procure, en 1869, la place de conférencier de l’impératrice Eugénie. Pourtant, Fustel est presque seul dans la voie qu’il a tracée, et ses contradicteurs, sans jamais le vaincre sur le terrain du débat, ne cesseront, jusqu’à sa mort, de considérer ce livre comme un « chef d’œuvre de méthode » mais pensant faux. La Cité antique ne peut plus être aujourd’hui qu’un monument littéraire, témoignage d’une façon d’écrire l’histoire au XIXe siècle. La mécanique des cultes et des institutions est parfaitement décrite, mais l’archéologie a depuis nuancé l’esprit de système de l’ouvrage, en y apportant de nombreuses exceptions. Trois apports majeurs demeurent ; avoir décelé et mis en avant le caractère religieux des sociétés antiques, avoir démontré le caractère chimérique des thèses historiques sur un communisme primitif, avoir établi une étude historique longue mettant en avant les continuités des sociétés humaines plutôt que les cassures, et en ce sens, en avance sur son temps, préfigurant l’œuvre d’un Fernand Braudel.
Un historien libéral et patriote
Le second événement fait au contraire de Fustel de Coulanges un auteur représentatif d’un milieu. En 1870, la guerre saisit l’historien à Paris. De constitution fragile, il ne peut prendre les armes. Fidèle à la ville de sa naissance, il y monte la faction comme garde national quelque temps, puis se consacre à une écriture actuelle, délaissant temporairement ses études historiques. La défaite de 1871 suivie de la Commune de Paris sont pour lui deux drames intimes. Il se considère comme mobilisé de l’arrière et, avec d’autres, déploie une activité fébrile, entre 1870 et 1872, au sein de la Revue des Deux Mondes, dirigée par Frédéric Buloz. On retrouve dans ces années un trio qui se répond et s’enrichit ; Fustel de Coulanges, Renan et Taine. Les trois auteurs communient à une même idée ; l’adhésion de raison à la République par esprit libéral, le goût pour les institutions aristocratiques, le rejet de la démocratie facteur de guerre civile et la condamnation des idéaux non pas tant de 1789 que de 1793, clef de compréhension de nos échecs du XIXe siècle, dont l’Année terrible de 1870-1871 serait le dernier en date. Les trois auteurs vivent la perte de l’Alsace comme une blessure. Fustel de Coulanges y a vécu dix ans, Taine et Renan ont admiré les auteurs allemands devenus leurs ennemis. De cette période naquit, sous la plume de Fustel de Coulanges, une série d’articles incisifs sur l’adhésion française de l’Alsace, sur l’histoire de la justice et le sentiment aristocratique, ainsi qu’un essai inachevé et inédit sur la guerre de 1870 et la Commune. Ici, Fustel de Coulanges est un libéral de son temps, un artisan du redressement de la France, à l’image de l’École libre des Sciences politiques, fondée dans ces années d’intense bouillonnement par Émile Boutmy, en vue de donner au pays une nouvelle élite pour la revanche.
Le grand œuvre solitaire de L’Histoire des institutions de l’ancienne France
En 1872 il décide de ne plus traiter de questions d’actualité et de revenir aux études purement historiques. Mais la France est devenue le cœur de ses préoccupations et il envisage d’en peindre une histoire institutionnelle complète, à l’image de La Cité antique. En 1875 sort le premier volume de L’Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. De nouveau, le succès de librairie est au rendez-vous dans les milieux éclairés, et ce d’autant plus que l’auteur, après un temps de suspicion, à cause de son activité au service de l’impératrice, a repris un cursus honorum qui le conduira à tenir la première chaire d’histoire médiévale de la Sorbonne, à enseigner à l’École normale supérieure avant de la diriger. Mais l’accueil du livre par la corporation des historiens de l’université est plus mitigé. Fustel de Coulanges établit une généalogie sans rupture qui nous conduit de l’aristocratie gauloise et du grand domaine agricole gallo-romain à la société féodale. Ne laissant de nouveau aucune source au hasard, il suit les mutations des actes notariés et de la jurisprudence pour nous présenter ce monde sans cesse mouvant, mais dont les enchaînements de cause à effet apparaissent avec netteté. Au passage, c’est le germanisme, thèse selon laquelle la France féodale devait tout aux invasions barbares du Ve siècle, qui vole en éclat. Cette thèse avait développé une vision fracturée et binaire de la société. D’une certaine manière, ses premiers linéaments avaient contribué aux hargnes sociales de la période révolutionnaire. Fustel de Coulanges, en y mettant fin, se fait l’artisan d’une réconciliation nationale. Ses adversaires de la Sorbonne, emmenés par Gabriel Monod, lui reprochent son esprit de système ou telle analyse faussée de documents, l’accusent de romanisme, donc de l’excès inverse du germanisme, selon lequel l’invasion n’aurait eu aucune influence sur nos racines. Piqué au vif, Fustel de Coulanges répond point par point, publie toutes ses sources dans une réédition monumentale du volume de 1875. Son œuvre ne trouve pas de conclusion. Il meurt à la tâche, en 1889. Son disciple loyal mais critique, Camille Jullian, achève la mise en forme et la publication de cette fresque en six volumes, de la Gaule indépendante à l’effacement des Carolingiens.
Un oublié à redécouvrir
Fustel de Coulanges mort, ses adversaires lui dressèrent une couronne pour un enterrement de première classe dans les limbes. Il était magnifique mais s’était trompé… Avec le recul, d’autres historiens reprirent ses thèses médiévales, notamment Ferdinand Lot et Marc Bloch. Son esprit de système le desservit, ainsi qu’une certaine cécité en histoire médiévale, n’abordant presque pas la question religieuse. Mais son étude minutieuse des textes, dans la lignée des bénédictins de Saint-Maur, loin d’en faire un étranger parmi les historiens, préfigurait les réflexions sur l’histoire longue, comme Braudel le fera pour la Méditerranée, ou Furet pour la Révolution. Homme de tradition en histoire, libéral en politique, soucieux de montrer l’unité d’un corps en mouvement, davantage que les ruptures superficielles, Fustel de Coulanges fut aussi un débatteur et un pédagogue. Ce goût du débat lui venait de l’étude critique et psychologique des documents qui lui faisait poser le doute en point de départ, pour chercher la vérité et s’y tenir comme les fondations élèvent la maison. Tenant ferme cette méthode de rigueur et ce goût de la vérité, il s’opposa, parfois férocement, à ses confrères, comme l’Allemand Mommsen, sur la justice franque, le droit de propriété antique ou la loi salique. Son goût pour la pédagogie était lié à celui de la vérité. Il fut l’un des premiers à faire travailler ses élèves en conférences, ancêtres des travaux dirigés de la faculté contemporaine, tout comme il imagina l’architecture des classes préparatoires, destinées à donner la culture générale suffisante en vue d’une meilleure compréhension des questions particulières de telle ou telle discipline dans la suite de l’existence.
Il avait adopté la devise de son maître à l’ENS, Adolphe Chéruel : Quaero, « je cherche », et c’est pourquoi il mérite, aujourd’hui, d’être réédité et lu. La science historique a progressé. Ses œuvres sont des points d’étapes. Mais elles sont aussi comme ces lacs de montagne auprès desquels on aime à se retirer pour contempler l’immensité, porte ouverte vers l’éternel.
Par Gabriel Privat
« Voilà pourquoi nous soutenons la guerre contre la Prusse. Bretons et Bourguignons, Parisiens et Marseillais, nous combattons contre vous au sujet de l’Alsace ; mais, que nul ne s’y trompe ; nous ne combattons pas pour la contraindre, nous combattons pour vous empêcher de la contraindre. »
Réponse à M. Mommsen, professeur à Berlin. Paris, 27 octobre 1870