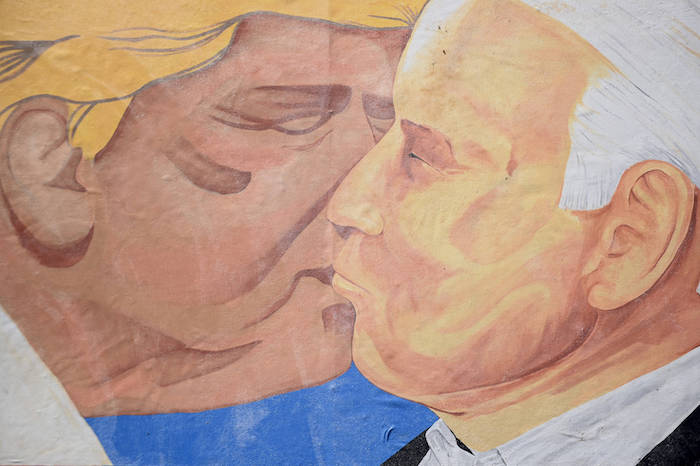La fin de l’année 2018 nous voit dans une situation inédite : tous les grands pays occidentaux vont mal en même temps. On renonce à suivre les méandres de la politique britannique à propos du Brexit. Personne ne peut dire qui gouvernera l’Allemagne dans les prochaines années, et comment. Aux États-Unis, le président Trump renvoie ou pousse à la démission ses collaborateurs les plus proches, les uns après les autres, et multiplie les décisions disruptives, mettant fin à une phase commencée en 1947, qui garantissait un minimum de continuité pour les grandes orientations de la politique américaine quel que fût le président. Quant à la France, elle n’est plus actuellement en état de faire des prévisions budgétaires sérieuses, y compris pour le financement de ses forces armées, et la crise dite des Gilets jaunes peut même conduire à une remise en cause de la lecture actuelle de la constitution de la Ve République et des pouvoirs de son président en matière de défense et de politique extérieure. Il suffit de lire la presse étrangère pour savoir à quel point notre situation inquiète nos partenaires.
Un monde qui change, pas comme prévu.
C’est encore l’Italie qui m’inspire le moins d’inquiétude : son gouvernement a une majorité du pays derrière lui ; son économie est, sur certains points (endettement, chômage des jeunes), en moins bonne posture que la nôtre, sur d’autres, en revanche, mieux placée (excédent de la balance commerciale, qualité des liaisons Internet sur l’ensemble du territoire et progrès de l’économie numérique, etc.). Et Rome vient de démontrer sa capacité à négocier avec Bruxelles sans céder sur l’essentiel.
Après le triomphalisme occidental des années 1990, comment en est-on arrivé là ? Incontestablement, la crise financière de 2008, dont nous ne sommes pas encore vraiment sortis, a joué un rôle considérable, en secouant jusqu’au tréfonds nos économies et en détruisant la confiance des populations dans l’économie libérale (cf. le livre récent d’Adam Tooze, Crashed. Comment une décennie de crise financière a changé le monde, éd.des Belles Lettres). Autre facteur de déséquilibre : la mondialisation et les nouveaux clivages qu’elle provoque au sein des sociétés occidentales, clivages aboutissant à de véritables ruptures du pacte social sous le poids de la concurrence des pays à bas salaires et de l’immigration.
Le modèle social de l’Occident d’après 1945, qui garantissait de fait l’emploi, assurait l’accès aux soins, encourageait l’accès à l’Enseignement supérieur et facilitait l’accès au logement, atteint ses limites à cause de trois contradictions internes non résolues, en dehors même de ces facteurs. Dans le domaine de la santé, les systèmes publics ont du mal à étaler l’explosion des dépenses, tandis que les secteurs privés (par exemple aux États-Unis et en Grande-Bretagne) deviennent hors de prix. Même chose pour l’Enseignement supérieur : ou bien il est gratuit – ou à peu près – mais on n’arrive plus à l’assurer correctement, en tout cas dans la tradition universitaire établie depuis le XIXe siècle, ou bien il est payant, comme dans les pays anglo-saxons, mais à un prix tel que l’endettement qu’il provoque chez les étudiants est devenu une cause de faiblesse systémique des banques (c’est le cas des États-Unis). Quant au logement, il devient inabordable dans les centres-villes, mais l’évolution des prix de l’énergie rend la construction en périphérie, la solution des années 1950-1980, moins attrayante pour les classes moyennes – les Gilets jaunes en témoignent. Nous sommes parvenus à la fin d’un cycle.
À ce modèle socio-économique correspondait dans tous les pays occidentaux, malgré toutes les différences constitutionnelles, un modèle politique rompant avec les idéologies des années 30 (fascisme, national-socialisme, communisme) et reposant sur l’alternance dans chaque pays de deux grands partis (ou coalitions) de gouvernement faisant évoluer l’application de cet ensemble démocratique, libéral et social, mais sans le remettre en cause. Ce modèle politique a lui aussi éclaté : les partis se multiplient ; les grands partis à vocation majoritaire sont très affaiblis ; on voit revenir, sinon de façon identique, du moins, si on va au fond des choses, de façon comparable et avec la même longueur d’onde dans le spectre, des descendants des grandes idéologies d’avant-guerre, de la gauche à la droite. On peut incriminer, outre la crise générale, les dérives de la démocratie d’opinion, celle des sondages permanents, et le mythe d’une “démocratie participative numérique” que rendraient possible les nouveaux moyens de communication.
Et, plus profondément, encore on constate la remise en cause de l’État-nation, présenté comme une structure politique dépassée, remise en cause idéologiquement et pratiquement par la mondialisation et par l’une de ses manifestations les plus visibles : l’immigration de masse. Il n’y a plus de politique possible dans ces conditions.
Trouver une solution
Tout est donc bloqué, de Washington à Paris en passant par Londres et Madrid, et il n’est pas possible, je ne dis pas de résoudre, mais même de poser clairement les dilemmes du monde occidental actuel. Et il n’est pas possible non plus d’avoir une stratégie cohérente face au reste du monde, de Moscou à Ryad en passant par Téhéran et Pékin. Et que ce soit collectivement ou au niveau de chaque pays occidental. En effet, une stratégie suppose la capacité de poser un diagnostic, d’évaluer les solutions possibles, d’en choisir une en tenant compte de leurs avantages et inconvénients respectifs, et, une fois le choix fait, de s’y tenir. En 1946, le diplomate George Kennan avait envoyé de Moscou au State Department un long télégramme resté fameux, qui nommait et caractérisait le conflit Est-Ouest, expliquait les motivations de la politique soviétique, et proposait une stratégie à long terme qui a été poursuivie peu ou prou jusqu’à son succès en 1990, avec le soutien de la grande majorité de la classe politique américaine et de ses électeurs. On en est loin aujourd’hui.
En face, la Russie pousse ses pions géopolitiques de la Baltique au Caucase et au Proche-Orient ; la Chine pousse les siens, économiques autant que géopolitiques, partout dans le monde, et d’autres pays, comme la Turquie, comptent bien profiter de cette situation d’auto-élimination occidentale. Il est de plus en plus clair que les pays européens vont réagir en ordre dispersé, l’Union étant par construction incapable d’avoir une réelle stratégie (on vient d’apprendre que les services chinois ont pénétré une bonne partie de ses serveurs informatiques en entrant dans le système par le ministère des Affaires étrangères chypriote, apparemment moins bien protégé…). Et la tentation chez certains de chercher à s’entendre avec Moscou, Pékin ou Ankara va encore croître. L’Europe risque de tomber sous toutes sortes d’influences extérieures.
Que faire ? C’est l’urgence qui commande, car les aiguilles tournent. Il faut trouver une solution pour le Brexit, quelle qu’elle soit, qui soit la moins négative possible pour les intérêts stratégiques et économiques de l’Europe, et ne se contente pas de démontrer que « quitter l’Union comporte un prix… ». Il faut également reprendre le contrôle de l’immigration. Ensuite, et la nouvelle bourrasque financière qui se prépare nous y invite, il faut trouver des solutions pour la zone euro, là aussi quelles qu’elles soient, qui tiennent compte du fait que si les Allemands ont horreur de l’inflation, les Français et les Européens du Sud ont, eux, horreur de la déflation, qu’on leur impose en fait depuis 1992. L’orthodoxie monétaire est seconde (je ne dis pas secondaire) si on considère que l’Union européenne dans son ensemble réalise de moins bonnes performances économiques depuis l’introduction de l’euro, par rapport à la période antérieure et par comparaison avec les autres grandes zones économiques dans le monde.
La reprise en main de l’immigration et la refonte de la politique monétaire au service de l’économie sont les seuls moyens de rétablir le minimum de confiance nécessaire de la part des peuples et de lancer les réformes et réorientations nécessaires dans tous les pays occidentaux pour répondre aux défis structurels actuels, y compris par rapport à la mondialisation. À condition, bien sûr, d’être d’accord avec les prémisses : l’Occident en général et l’Europe en particulier ont une réalité historique et culturelle, et les États-nations qui les composent ont leur légitimité. Et tous ont encore un rôle à jouer dans le monde.