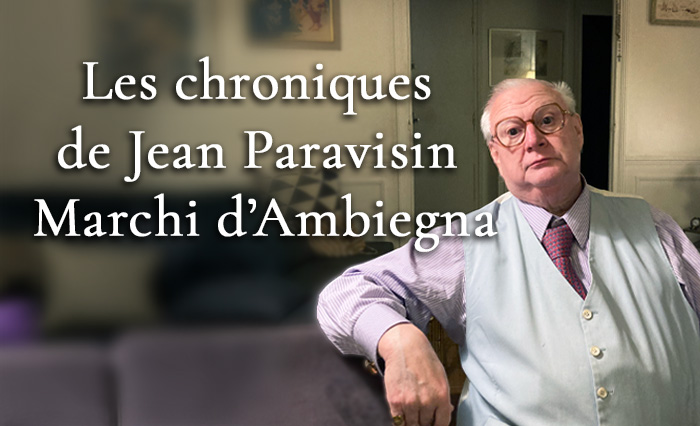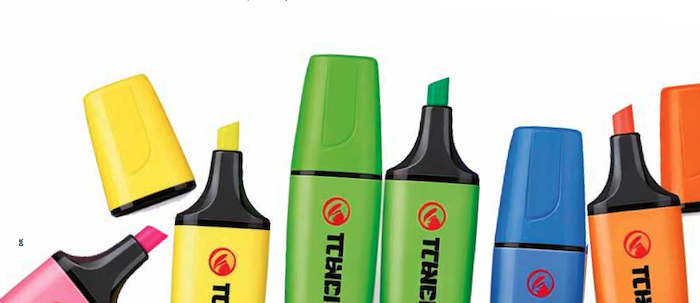Il y a des mots qui, déplacés d’un milieu à l’autre, changent de sens comme un drapeau change de main au cours d’une bataille. « Beauf », par exemple. On se souvient des planches de Reiser, des vociférations de Jean Yanne, de l’odeur du formica et du pavillon en meulière. Le beauf, c’était le beau-frère médiocre : sentencieux, vaguement cocardier, amateur de saucisses grillées, de bibelots criards et d’avis définitifs sur tout. Un être rivé au conforme, à l’évident, à l’étroit. Bref : le règne du quelconque.
Or voici qu’un jeune homme, sorti d’un quartier périphérique, au phrasé convenable mais légèrement éraillé par l’accent de sa banlieue, se permet de désigner comme « beauf » un garçon élégant, soigneusement vêtu, qui écoute presque exclusivement de la musique classique. Vertige. Le mot ne désigne plus l’esprit obtus, mais celui qui cultive un goût. Le beauf, désormais, ce serait celui qui ose préférer Bach à la playlist du moment, celui qui lit, réfléchit, choisit — et qui ne se sent pas tenu d’appartenir à une bande.
Nous assistons ici à une inversion absolue des valeurs. Ce n’est plus le vulgaire qui est montré du doigt, mais l’homme cultivé. Le jeune homme ne juge pas : il suspecte. Il n’analyse pas : il condamne. Il ne cherche pas à comprendre : il écarte. Ce qu’il désigne par « beauf », c’est celui qui préfère le monde intérieur au monde de l’adhésion immédiate. Celui qui se donne le luxe d’exister hors du troupeau.
Et c’est là que se révèle le véritable ressort de cette affaire : le ressentiment. Nietzsche l’a décrit : lorsque l’on se sait démuni devant la hauteur, on renverse l’échelle plutôt que d’essayer de l’escalader. On déclare « ridicule » ce que l’on ne peut atteindre. On proclame « ringard » ce que l’on ne comprend pas. On dit « beauf » à propos de ce que l’on envie, secrètement, désespérément.
Sortir de la beaufitude n’a jamais été aussi simple
Pourtant, sortir de la beaufitude n’a jamais été aussi simple. Il suffit — oui, il suffit — de lire. Lire hardiment, c’est-à-dire accepter d’être décentré par une phrase, un rythme, une idée. Lire deux siècles de littérature, depuis Montaigne jusqu’à Valéry, en passant par Pascal, Chateaubriand, Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert. Là sont les nourritures. Non pas les vies d’athlètes, d’influenceuses, de chanteurs d’émissions du samedi soir, ni les autobiographies industrielles des hommes politiques. Cela, c’est le bruit du temps qui se jette sur lui-même. Le beauf s’y repaît ; il y reconnaît son image ; il s’y rassure. Mais la littérature, la vraie, émancipe. Elle élève. Elle déplace l’axe de la vie, elle force l’âme à regarder plus haut qu’elle-même.
Encore faut-il y avoir accès dans son état intact. Non pas dans ces éditions modernes où l’on réécrit, lisse, caviarde, modernise, expurge, sous prétexte de rendre « accessible » — ce qui signifie toujours : adapter au niveau du plus faible. Les nouveaux réformateurs de l’orthographe — ces Érostrates du langage, brûleurs de temples au nom de la simplification — ne se contentent pas de corriger : ils colonisent. Ils substituent leur médiocrité au génie des siècles.
Il faut donc lire dans les éditions d’époque, ou du moins dans des éditions respectueuses de la langue telle qu’elle fut écrite, et non telle qu’on la veut rendre conforme aux sensibilités changeantes. La clef de la liberté intellectuelle est là. Celui qui lit ainsi, qui se nourrit à la source même, sort du troupeau. Il conquiert une souveraineté intérieure.
C’est pourquoi le vrai beauf aujourd’hui n’est plus celui qui s’achète des nains de jardin. Le vrai beauf est celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas, celui qui ne veut pas savoir, celui qui se satisfait de ce que la meute approuve. Les cancres triomphent tant qu’on leur laisse le pouvoir de dire ce qui est « cool » et ce qui ne l’est pas. Mais la culture n’est pas un sondage. La culture ne se vote pas. Elle se conquiert. Et l’élégance, désormais, est un acte de résistance.