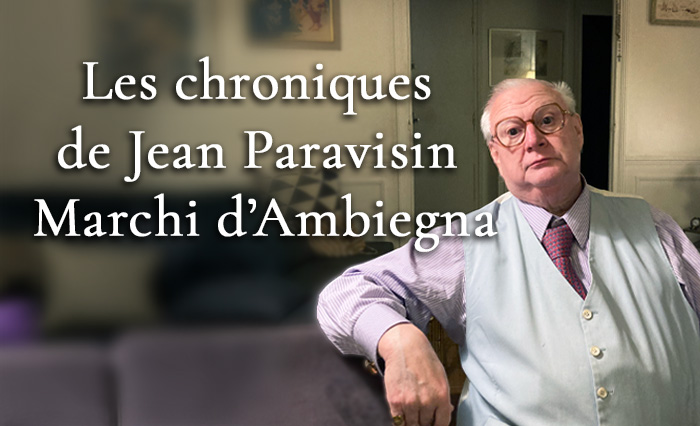Une partie de l’opinion, agitée par la passion de l’avilissement, s’emploie aujourd’hui à rétablir, sous des formes plus sournoises, l’ancienne mort civile. Il ne suffit plus que l’on critique un homme public, ni même que l’on juge ses actes : il faut désormais l’effacer, le nier comme sujet, interdire que l’on parle de lui autrement qu’en termes de mépris. L’on ne se contente plus de débattre : l’on exige l’ostracisme.
L’épisode récent de la visite du ministre Darmanin à l’ancien Président Sarkozy en fournit l’illustration la plus nette. Ce geste simple, sans solennité, n’était rien d’autre qu’un acte d’humanité élémentaire : aller voir un homme qui traverse l’épreuve. Rien de plus.
Or, c’est précisément cela qui a été dénoncé. Non par les agitateurs anonymes dont l’excitation constitue désormais une respiration naturelle, mais par des avocats eux-mêmes. Ceux-là, qui devraient être les premiers gardiens de la présomption d’innocence, feignent de l’oublier dès qu’il s’agit de rejoindre la meute. Ils savent pourtant que tant qu’une condamnation n’est pas définitive, un homme demeure réputé innocent. Ils le savent et ils passent outre. Par complaisance. Par confort. Par faiblesse.
Nous en sommes donc arrivés à ceci : l’humanité devient suspecte. La mesure, l’attention, la simple courtoisie sont perçues comme une faute morale. On ne veut plus juger : on veut exclure. On ne veut plus penser : on veut détruire. L’esprit de meute a remplacé l’esprit du droit.
Rappel historique
La mort civile, cet outil juridique destiné à retrancher un homme de la communauté sans le mettre au tombeau, fut abolie par Napoléon III, souverain humain et juste qui comprit que la civilisation ne consiste pas à prolonger l’humiliation au-delà de la sanction. Jusqu’alors, l’on pouvait vivre, respirer, marcher dans les rues — mais comme si l’on n’existait plus : privé de nom, de droits, de transmission, l’individu devenait une ombre vivante, exclue de la cité. Nous avons aboli la peine dans les textes, mais la haine cherche aujourd’hui à la rétablir en pratique. Non plus par décret impérial, mais par meute, par piétinement collectif, par l’indignation facile des médiocres rassemblés.
On ne dresse plus de pilori en bois sur la place publique : c’est l’opinion qui en fait office, et la flétrissure se grave désormais dans les réseaux, les commentaires, les airs entendus. La sentence juridique a disparu. La jouissance de l’infamie, elle, demeure. Lorsqu’un avocat renonce à la présomption d’innocence, lorsqu’il applaudit à la relégation d’un homme encore justiciable, il ne trahit pas celui qu’il attaque : il trahit la Justice elle-même.
Et lorsque l’opinion en vient à considérer la compassion comme un manquement, c’est la société toute entière qui s’habitue au ban comme mode ordinaire de gouvernement moral. Peu importe que l’on aime ou non l’homme visé. Cette question n’a aucune importance ici. Comment peut-on vouloir rejoindre une meute aussi crasseuse ? Est-ce vraiment là que les propagateurs de l’ignoble se sentent à leur place — comme des poussières d’étron serrées dans l’écrin que transporte la boue ?
Politique Magazine existe uniquement car il est payé intégralement par ses lecteurs, sans aucun financement public. Dans la situation financière de la France, alors que tous les prix explosent, face à la concurrence des titres subventionnés par l’État républicain (des millions et des millions à des titres comme Libération, Le Monde, Télérama…), Politique Magazine, comme tous les médias dissidents, ne peut continuer à publier que grâce aux abonnements et aux dons de ses lecteurs, si modestes soient-ils. La rédaction vous remercie par avance.