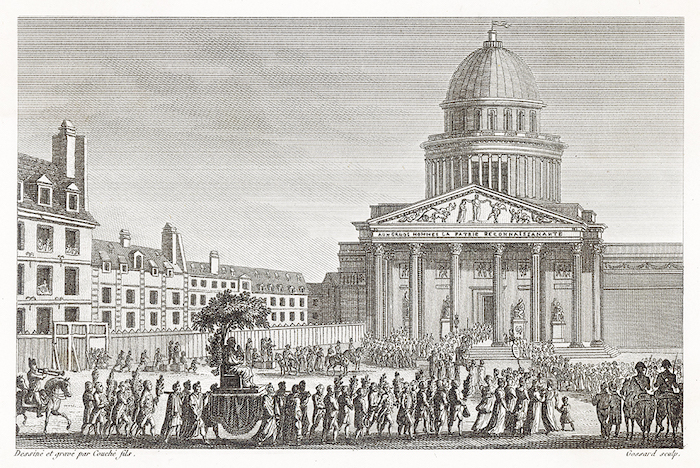Après les intégrales de Jozef De Beenhouwer (2001), de Suzanne Grützmann (2007), les sélections de Yoshiko Iwai (1999) ou Veronica Jochum (2007), celle de Sophia Vaillant rassemble les œuvres pianistiques « officielles » de Clara Schumann et nous invite à redécouvrir une créatrice d’envergure.
Éminent et exigeant professeur de piano, Friedrich Wieck eut pour ambition de faire de sa fille une virtuose. Il lui enseigna le répertoire en vogue, des pièces signées Kalkbrenner, Henselt, Pleyel, Thalberg ou Herz. Enfant surdouée, Clara, née le 13 septembre 1819 à Leipzig, se produisit en concert dès l’âge de à six ans et rencontra son premier succès à neuf ans.
L’enfant prodige
À onze ans, elle effectua une tournée de sept mois, organisée par son père, à travers l’Europe. Le talent de l’adolescente éblouit le vieux Goethe, enthousiasma Chopin. Les critiques étaient dithyrambiques. « Nous avons entendu la petite Wieck à Leipzig. C’est une véritable merveille. Pour la première fois de ma vie, je me suis surpris à admirer avec enthousiasme un talent précoce. Exécution parfaite, mesure irréprochable, force, clarté, difficultés de tout genre surmontées avec bonheur. […] Le piano sous ses doigts prend de la couleur et de la vie » attesta le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach en 1831. Elle connut un vrai triomphe à Paris. Sa facilité à mémoriser la musique marquait les auditeurs et elle fut parmi les premiers interprètes à jouer systématiquement par cœur.
Elle effectua des tournées en Angleterre, en France, en Russie jusqu’en 1891, date de son dernier concert. Entre 1831 et 1889, elle assura plus de 1 500 prestations, défendant les œuvres de son mari, Robert Schumann, de Brahms, de Chopin et de Mendelssohn. Son répertoire comprenait plus de 300 œuvres de 37 compositeurs. En 1846, elle ajouta le 4e Concerto de Beethoven à son répertoire en y intégrant ses propres cadences mêlant fougue et subtilité. Elle fut nommée Virtuose de la Chambre Royale et Impériale d’Autriche, la plus haute distinction viennoise attribuée à un musicien.
Clara Wieck demeure l’une des plus importantes pianistes du XIXe siècle, possédant des capacités techniques extraordinaires. « Elle seule fut tenue pour l’égal des plus grands pianistes masculins, Thalberg, Chopin, Liszt et Mendelssohn.1 » Le critique musical Henri Blanchard la surnommait « le lion musical du moment, le Thalberg féminin du piano. » Clara sut s’imposer dans le monde musical presque exclusivement masculin de l’époque Biedermeier.
Le « lunatique conteur d’histoires »
En 1827, elle rencontra Robert Schumann, qui étudiait auprès de son père. Leur amitié complice ne tarda guère à rapprocher ces deux êtres d’exception. À seize ans, « j’ai compris que j’aimais passionnément Robert. Ce jour-là, j’ai commencé à sentir ce que je jouais. Tout le monde a dit que si mon jeu devenait expressif, c’était dû, sans doute, à une profonde émotion. » Friedrich Wieck s’opposa vigoureusement au mariage de sa fille déjà célèbre avec un musicien inconnu.
« J’ai besoin d’une vie sans soucis afin d’exercer mon art en toute tranquillité. […] Vois si tu penses pouvoir m’offrir une existence telle que je la souhaite2 » s’inquiétait la jeune femme avant le mariage finalement célébré en 1840 à Schönefeld. Bien que parfaitement conscient des dons formidables de son épouse, Robert ne s’émancipait en rien de la mentalité ambiante : « Clara sait bien qu’être mère est là sa principale mission ». Elle dut s’occuper non seulement des tâches domestiques, que son père lui avait épargnées durant sa jeunesse, mais également de ses huit enfants et d’un mari dont les revenus ne suffisaient pas à subvenir aux besoins de la famille. Aussi continuait-elle à donner des concerts.
Les Schumann formèrent toutefois un couple mythique communiant par la musique. « Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique » lui écrivait Robert. « C’est dans l’ineffable sonore qu’ils furent des égaux, vibrant sur la même longueur d’onde, échangeant des signaux énigmatiques aux sources improbables.3 »
« La pratique de l’art est l’air que je respire »
Clara laissa environ 45 œuvres dont la majeure partie ne fut jamais jouée de son vivant. Franz Liszt ne s’y était pas trompé : « Il y a chez elle une supériorité réelle, un sentiment profond et vrai, une élévation constante. » Elle livra ses premières partitions dès l’âge de dix ans : Quatre Polonaises op.1, naturellement influencées par Chopin, Quatre pièces caractéristiques op. 5 en lesquelles s’immiscent sorcières et revenants. C’est Felix Mendelssohn, nouveau directeur musical du Gewandhaus de Leipzig, qui dirigea la création de son Concerto pour piano, le 9 novembre 1835, avec la compositrice de 16 ans en soliste. Entre 1834 et 1836, elle composa les Soirées musicales op.6 contemporaines des Davidsbündlertänze de son bien-aimé. Les Variations sur un thème de Robert Schumann op. 20, composées en 1853, un an avant que celui-ci ne sombre dans la folie, constituent un exemple supplémentaire des affinités hors norme liant les deux artistes. L’écriture très virtuose nous rappelle les œuvres de son mari. Un Trio avec piano op.17 (1846) et d’émouvants Lieder (sur Heine, Rückert, Rollet, …) complètent sa production.
Les doutes qu’elle émit au sujet de sa vocation nous étonnent aujourd’hui : « Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n’a été capable de le faire, pourquoi serais-je une exception ? Il serait arrogant de croire cela, c’est une impression que seul mon père m’a autrefois donnée.4 » L’avenir lui rendra justice.
« À vrai dire, mon bonheur s’est éteint avec lui »
En 1854, Robert fut interné à l’asile pour aliénés du Dr Richarz, près de Bonn. Une Romance en si mineur, composée l’année de la mort de son mari, en 1856, fut la dernière œuvre de Clara qui renonça dès lors à écrire. Décédée le 20 mai 1896 à Francfort-sur-le-Main, elle est enterrée aux côtés de son époux dans le Vieux-Cimetière de Bonn.
Dans la quasi intégrale qu’elle a récemment enregistrée, Sophia Vaillant délivre une lecture juste, précise et nuancée de l’univers schumanien. La danse imprègne toutes les pages de prime jeunesse destinées au salon plus qu’au concert (Quatre Polonaises, Neuf caprices en forme de Valse, Quatre pièces caractéristiques, Six soirées musicales) et jouées ici avec la fraicheur et le panache qui leur siéent. La solide technique de la pianiste, acquise auprès de Geneviève Ibanez et Pierre Pontier, impressionne dans les pièces plus tardives, comme les Trois préludes et fugues, les Variations sur un thème de Robert Schumann et les Trois romances. Très respectueuse du texte, Sophia Vaillant en souligne l’audace de conception. Elle nous détaille ces partitions avec une impérieuse fermeté qui force l’admiration mais que nous aurions aimée agrémentée de-ci de-là d’un peu plus de liberté poétique ou d’un soupçon de fantaisie – romantisme oblige.
Clara Schumann, Un destin romantique, Sophia Vaillant, piano, coffret de 3 CD, Indésens Calliope Records.