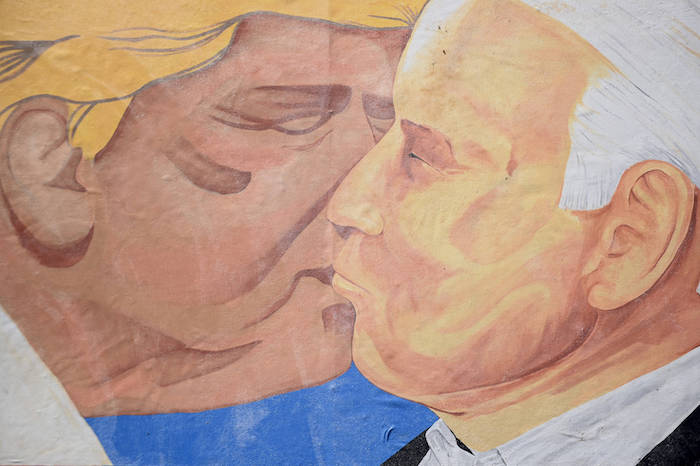En août 1914, Poincaré proclama : « La mobilisation n’est pas la guerre ». On sait ce qu’il en advint. Un an après le début de la guerre en Ukraine, incontestablement, les gouvernements occidentaux et les opinions publiques se mobilisent (avec des nuances que nous allons voir) et Kiev reçoit des armements nombreux et une aide considérable, surtout si on tient compte de la pauvreté des arsenaux occidentaux trente ans après la fin de la Guerre froide.
Mais cette (relative) mobilisation ne signifie ni la victoire, ni la fin de la guerre, et encore moins la paix (qui n’a plus vraiment régné dans ces régions de l’Europe du Centre-Est depuis 1914). Il est très difficile de prévoir la suite des évènements sur le terrain. La Russie n’est ni ruinée par les sanctions, ni à bout de force sur le plan militaire, contrairement à ce que beaucoup avaient annoncé un peu vite. Une seule chose est désormais sûre : la guerre en Ukraine s’inscrit désormais dans la série des grands conflits européens, avec un très haut degré de violence, et son potentiel d’escalade, géographique ou par les types d’armes utilisés, est loin d’être épuisé. Ce seul fait modifie la situation en profondeur. La guerre crée une nouvelle réalité. On ne reviendra pas au monde d’avant le 24 février 2022.
Mais il faut quand même essayer de penser à la suite. Poutine ne renonce pas, et la grande majorité de l’opinion russe continue à le soutenir. Son objectif paraît avoir changé depuis février 2022 : il ne s’agit plus de mettre en place à Kiev un régime vassal, il s’agit de confirmer l’annexion de la Crimée et celle du Donbass, et des régions intermédiaires. Étant donné l’histoire, le caractère largement russophone de ces régions, l’état de l’opinion russe, etc., il est fort peu probable qu’un éventuel successeur de Poutine renonce de lui-même à cet objectif.
En face, Kiev veut la victoire et la reconquête de tous les territoires perdus, y compris la Crimée. Les Polonais, les Baltes, les Britanniques soutiennent cette position. Certains vont d’ailleurs même plus loin et imaginent un changement de régime à Moscou, voire l’éclatement de la Fédération de Russie. Les Allemands sont divisés : les Verts sont sur la même ligne que Kiev, le chancelier Scholz est soumis à de considérables pressions de la part de Washington et des pays de l’Est de l’Europe. Il manœuvre. Je pense que sa position rejoint celle de Paris, autant qu’on peut la comprendre : donner les moyens à l’Ukraine de négocier le moment venu en position de force, mais en admettant qu’il faudra bien le moment venu négocier. L’opinion allemande, profondément divisée, me paraît malgré tout être majoritairement sur la même ligne que le chancelier.
La position floue des États-Unis
La position américaine, évidemment centrale, est particulièrement complexe. D’une part il est maintenant admis que les Américains ont commencé à renforcer militairement l’Ukraine dès 2014, préparant des bases, des dépôts, des plans d’opérations (Financial Times du 9 janvier). Mais d’autre part on sait désormais (Neue Zürcher Zeitung du 2 février) que par deux fois, en avril 2022 et à la mi-janvier, les Américains ont tenté une médiation entre Kiev et Moscou. Et après l’échec de cette dernière, ils ont manœuvré le chancelier Scholz afin que celui-ci annonce la fourniture de Léopard 2 à l’Ukraine, alors qu’il ne voulait pas le faire avant un engagement américain de livraison. Mais finalement, Washington n’a annoncé qu’ensuite une petite livraison de 31 Abrams, dans des mois, et a bloqué toute idée de livrer des avions à l’Ukraine.
Au même moment, un rapport de la Rand Corporation (think tank proche du Pentagone), Avoiding a Long War, suscitait un considérable émoi : il y est clairement dit qu’une guerre longue n’est pas dans l’intérêt des Etats-Unis.
Comment expliquer ces positions, assez éloignées des déclarations enflammées du Président Biden ? D’abord il est possible que les services américains soient plus inquiets de la situation militaire réelle de l’Ukraine que ne le pensent les médias occidentaux. D’autre part il est clair que la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des Représentants va réduire les crédits à l’Ukraine, elle ne s’en cache pas. Washington ne dissimule pas aux Ukrainiens qu’il faudra sortir de l’impasse au plus tard l’été prochain. Et enfin, et peut-être surtout, on concentre de plus en plus les efforts stratégiques contre la Chine. La Russie, dans cette perspective, devient secondaire.
Il reste qu’il est difficile d’imaginer actuellement une solution négociée : un accord territorial définitif établissant une nouvelle frontière n’a aucune chance de voir le jour maintenant ni à moyen terme. Plus envisageable théoriquement serait un accord provisoire, garanti par des organisations internationales ou par des puissances tierces comportant la fin des opérations et une « déconfliction » progressive permettant la vie des populations, et renvoyant les solutions définitives à plus tard. Mais cela ressemble beaucoup aux accords de Minsk de 2014 et 2015, qui ont échoué ! Et la déclaration de Mme Merkel, le 8 décembre 2022, selon laquelle il ne s’était jamais agi que de gagner du temps pour permettre à l’Ukraine de s’armer, ne renforce pas la crédibilité d’une telle solution (à supposer qu’elle dise vrai, ce que j’ai du mal à croire) !
Que reste-t-il ? Une situation de type coréen, c’est-à-dire un conflit gelé, soit accompagné d’un armistice en bonne et due forme, soit d’un arrêt de facto des opérations. Cela éviterait à Kiev comme à Moscou de devoir acter des changements territoriaux ou renoncer officiellement à certains de leurs objectifs.
L’Union européenne, appendice de Washington
Mais pour le moment les protagonistes n’ont aucune intention de geler le conflit. C’est pourquoi il faut s’intéresser à une formule qui commence à circuler, dite Intermarium, qui va de la Baltique à la Mer Noire. La Pologne, la Finlande, les Pays baltes, l’Ukraine, appuyés et armés par la Grande-Bretagne et les États-Unis, constitueraient une barrière face à la Russie (comme la République polono-lithuanienne du XVIIe siècle, qui comprenait l’Ukraine). Dans l’esprit de ses défenseurs, cette formule pourrait rassurer les Ukrainiens, faire reculer les Russes ou tout au moins les forcer à accepter un gel du conflit. En même temps, expliquent les promoteurs, cela pourrait soulager les Américains en Europe pour mieux leur permettre de renforcer leur situation stratégique dans l’Indo-Pacifique, permettant ainsi de résoudre l’une des grandes contradictions actuelles de l’Alliance atlantique.
On pourra évidemment se demander si cette formule, dont le nom même, Intermarium, apparu dans la « Pologne des Colonels » dans les années 30 et reprise par la suite par divers services secrets occidentaux, est peu engageant pour un Russe, ne pousserait pas au contraire Moscou à une nouvelle escalade du conflit ? Mais il est clair qu’elle permettrait à Washington de retrouver une certaine cohérence stratégique : la Russie serait tenue en respect, essentiellement par les Européens, ou du moins ceux d’entre eux que les Américains considèrent comme les plus utilisables, pendant que les États-Unis pourraient concentrer leurs efforts face à la Chine.
L’Allemagne serait déchirée, entre le soutien qu’elle ne peut refuser à la Pologne et aux Pays baltes et le souci de conserver le marché chinois, essentiel pour elle. Elle s’en tirerait par des contorsions qui, au fond, ne gêneraient nullement Washington mais contribuerait à empêcher l’émergence d’une véritable identité européenne de sécurité et de défense. Dans cette perspective, l’Union européenne, dont les équilibres internes seraient profondément transformés, deviendrait de plus en plus un appendice de l’Alliance atlantique, et la France, l’Italie, l’Espagne seraient de plus en plus marginalisées. Il est clair que l’intérêt de ces dernières, ainsi, me semble-t-il, que celui des populations concernées si tragiquement éprouvées, serait de renouer à un moment donné, même si cela ne pourra pas être le cas rapidement, avec un processus du type accords de Minsk.
Fondamentalement, le problème est le même que celui de l’ex-Yougoslavie : les frontières issues de la guerre de 1914 et des traités de paix, même si on s’y accroche juridiquement quand les grandes entités (Yougoslavie, URSS) s’effondrent, ne sont pas viables. C’est la position à laquelle, après des hésitations initiales, on s’était arrêté dans le conflit yougoslave : les frontières internes des différentes composantes devenaient les frontières intangibles des nouveaux États, quels que fussent les problèmes de minorités. Mais, à la longue, on ne force pas à vivre ensemble des gens qui ne le veulent pas. Un organisme existe, qui pourrait être un forum utile, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), créée en 1990, au moment de la fin de la Guerre froide. On notera que la Russie, exclue de sa réunion annuelle l’an dernier, a demandé à pouvoir y participer cette année. Soyons clair : l’OSCE n’a pas les moyens de régler à elle seule la crise. Mais on pourrait s’y parler.